Né en Espagne en 1963, Yann Martel habite Saskatoon et écrit en anglais, langue dans laquelle il a fait ses classes d’enfant nomade. Ses parents, diplomates retraités, ont longtemps traduit ses œuvres en français.
Dès que le nom de Yann Martel est mentionné, tout un chacun pense à L’histoire de Pi, un ovni paru en anglais le 11 septembre 2001, ça ne s’invente pas, et en français deux ans plus tard. Une véritable bombe, sans vilain jeu de mots, dont plus de treize millions d’exemplaires ont été vendus dans une cinquantaine de pays. Le livre a remporté de nombreux prix prestigieux dont le Man Booker Prize et son adaptation cinématographique par le réalisateur Ang Lee a récolté quatre Oscars en 2013.
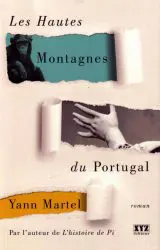 Martel n’est cependant pas l’auteur d’un seul livre. Si ses premiers romans, Paul en Finlande – gagnant du Journey Prize – et Self ont moins retenu l’attention, il en va autrement des œuvres qui ont suivi L’histoire de Pi, soit le controversé Béatrice et Virgile et le tout récent Les Hautes Montagnes du Portugal, promis dit-on à un grand succès critique et d’estime.
Martel n’est cependant pas l’auteur d’un seul livre. Si ses premiers romans, Paul en Finlande – gagnant du Journey Prize – et Self ont moins retenu l’attention, il en va autrement des œuvres qui ont suivi L’histoire de Pi, soit le controversé Béatrice et Virgile et le tout récent Les Hautes Montagnes du Portugal, promis dit-on à un grand succès critique et d’estime.
Plusieurs ont apprécié l’humour de 101 lettres à un premier ministre, Mais que lit Stephen Harper ?, un recueil des suggestions de lecture que l’auteur a envoyées au leader conservateur deux fois par mois pendant quatre ans, demeurées lettres mortes, c’est le cas de le dire, à l’exception de rarissimes accusés de réception. En 2009, Martel met fin à ses efforts d’éducation et se concentre sur ses propres écrits.
« La foi est la réponse à la mort »
Le personnage de Piscine Molitor Patel – mieux connu sous le nom de Pi – permet de saisir l’importance que revêtent la et même les religions chez Yann Martel. Le jeune protagoniste d’une hallucinante histoire de survie se passionne pour les trois religions qu’il pratique. Né à Pondichéry et vivant dans un zoo, il est élevé dans l’hindouisme et aime Krishna : « J’étais un hindou heureux ». Sa rencontre avec le catholicisme a lieu alors qu’il est enfant. « Quelle sorte de dieu est-ce cela ? Qu’y a-t-il d’inspirant chez Lui ? » Peu après, il fréquente la Grande Mosquée et en apprécie le dogme. « Je mets au défi qui que ce soit de comprendre l’islam, son esprit, et de ne pas l’aimer. C’est une superbe religion de fraternité et de dévotion. »
Pendant les 227 jours où le jeune Pi dérive en chaloupe sur l’océan Pacifique, en compagnie du tigre Richard Parker, et même une fois installé à Toronto, il demeure un fervent pratiquant des trois religions qu’il a embrassées. « Ces rites m’apportaient du réconfort, c’était certain. Mais c’était dur, oh que c’était dur ! »
Né à la fin de la Révolution tranquille qui, au Québec, a vidé les églises, Yann Martel a étudié à l’étranger, au gré des déplacements de ses parents. Il n’a pas connu la pression de la religion, ni à l’école ni à la maison. « La religion [était] quelque chose qu’on [voyait] dans le National Geographic », a-t-il déjà déclaré. L’écrivain ne se prononce pas sur la valeur d’une de ces croyances, mais il semble partager la soif de spiritualité de Pi, ce qui se confirme dans ses autres romans.
Une quête existentielle
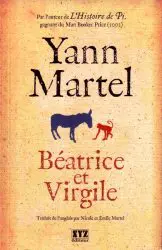
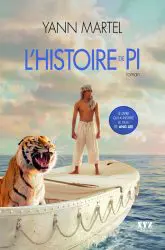 Béatrice et Virgile, œuvre inclassable et décriée, met en scène des animaux empaillés, mais parlants, et en vérité fort loquaces. L’ânesse Béatrice et le singe hurleur Virgile servent une allégorie sur la tragique extermination des Juifs dans les camps nazis. « Alors comment allons-nous parler des Horreurs ? » La parabole de la Shoah a été perçue comme sacrilège par certains et par d’autres, comme une fable cruelle, aux toutes dernières pages insupportables. Béatrice et Virgile oblige le lecteur à s’interroger sur le sens de la vie, de sa vie. Le livre étonne, déroute, dérange, mais provoque une indéniable réflexion.
Béatrice et Virgile, œuvre inclassable et décriée, met en scène des animaux empaillés, mais parlants, et en vérité fort loquaces. L’ânesse Béatrice et le singe hurleur Virgile servent une allégorie sur la tragique extermination des Juifs dans les camps nazis. « Alors comment allons-nous parler des Horreurs ? » La parabole de la Shoah a été perçue comme sacrilège par certains et par d’autres, comme une fable cruelle, aux toutes dernières pages insupportables. Béatrice et Virgile oblige le lecteur à s’interroger sur le sens de la vie, de sa vie. Le livre étonne, déroute, dérange, mais provoque une indéniable réflexion.
Les Hautes Montagnes du Portugal reprend les thèmes de L’histoire de Pi : l’amour, la perte des êtres chers, la religion en consolation d’un deuil insupportable. Le roman gigogne est divisé en trois parties qui se télescopent les unes les autres. La quête d’autre chose, la recherche d’un dieu ou la soif inextinguible d’une foi quelconque sont au cœur de ces trois histoires qui au fond n’en sont qu’une.
Yann Martel ne saurait signer un récit sans animaux, et notre ancêtre le singe est ici omniprésent. « Nous sommes des singes qui se sont élevés, et non pas des anges déchus. » Les primates apparaissent dans chacune des parties de l’œuvre, en une sorte de crescendo. Il y a le singe crucifié, puis le singe mort-vivant, enfoui au plus secret de l’être, et enfin, le singe compagnon de voyage.
Dans la première histoire, on accompagne Tomás, un être désespéré, fou de douleur, à la recherche d’une énigmatique relique. Ensuite, on prête l’oreille aux propos du pathologiste Eusebio, lequel dialogue avec les morts et émet des hypothèses sur les grands mystères de la vie. Dans la dernière partie, on voyage avec Peter, qui cherche à donner un sens nouveau à notre humanité. Le remède à leur douleur commune réside dans leur cheminement vers les Hautes Montagnes, ce qu’ils exécutent tour à tour, au fil des ans, marchant dans les pas de leurs prédécesseurs. Leur pèlerinage de Compostelle part de Lisbonne – ou de Bragance – et aboutit à Tuizelo, situé à l’extrémité du Portugal, là où les trois récits convergent. La route enfante-t-elle la guérison ?
L’allégorie de la fable
Tel Ésope ou La Fontaine, Yann Martel utilise la fable animalière, comme si elle pouvait alléger ses récits épiques. Ni les personnages ni les animaux qui y foisonnent n’ont pourtant la vie facile. Leur quête existentielle est exigeante.
C’est au fond de son embarcation à la dérive que Pi apprend à vivre en pacifique coexistence avec un cruel ennemi, ce qui le rend inventif et le sauve du désespoir. Le tigre et lui partagent un territoire commun, et font preuve de grande tolérance. Il n’y a guère de cohabitation plus exigeante que celle-là.
Les tortures de Béatrice et Virgile – évocation des guides du ciel et de l’enfer dans La divine comédie de Dante – sont-elles plus acceptables parce qu’il s’agit de bêtes empaillées par un taxidermiste fou, vraisemblablement un collaborateur nazi ? « Un coup en exige un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. » L’horreur demeure l’horreur, quel qu’en soit le lieu ou le sujet.
Dans Les Hautes Montagnes du Portugal, le père Ulisses, autre nom évocateur, est excommunié par son évêque pour avoir condamné l’esclavage. « Je lui ai dit que j’étais allé à la rencontre de l’être inférieur, pour découvrir qu’il était notre égal. […] Il m’a crié qu’il existe des hiérarchies d’anges […] et qu’il existe donc des hiérarchies ici sur terre. » Malade et abandonné, le prêtre veut témoigner « de l’horreur que nous avons causée » et crée un étrange artefact qui « brille, hurle, aboie, rugit. C’est vraiment le Fils de Dieu qui crie haut et fort ».
Les questionnements de Yann Martel sur la divinité, la religion et la foi passent aussi par l’humour et souvent par l’inattendu. Dans le même roman des Hautes Montagnes du Portugal, l’épouse du pathologiste analyse l’œuvre de l’immense Agatha Christie et conclut : « Ses romans sont des évangiles de l’absence. […] Jésus est présent par fragments seulement, par traces. […] Il est là, dans le nom de famille même de l’auteur ». Une théorie des plus rafraîchissantes.
Même récit, troisième volet. Sans trop le réaliser, le chimpanzé Odo provoque un débat sur l’écologie et les espèces aujourd’hui menacées ou disparues, tel le rhinocéros ibérique qui a vraiment existé. Une énième quête, déjà au cœur de L’histoire de Pi, pour sauver de l’homme un monde en perdition.
À la maison1
 La famille de Yann Martel, parents et enfants, a vécu en Alaska, puis en Colombie-Britannique, avant d’habiter le Costa Rica, le Mexique, l’Espagne et la France. Le voyage inscrit dans ses gènes, le jeune homme partira ensuite à la découverte de nouveaux horizons. Aujourd’hui, l’auteur de réputation mondiale continue son tour du monde selon les invitations qu’il reçoit lors de la sortie d’un de ses livres, donnant des entrevues dans l’un ou l’autre des pays où il est publié. L’écrivain aime la route.
La famille de Yann Martel, parents et enfants, a vécu en Alaska, puis en Colombie-Britannique, avant d’habiter le Costa Rica, le Mexique, l’Espagne et la France. Le voyage inscrit dans ses gènes, le jeune homme partira ensuite à la découverte de nouveaux horizons. Aujourd’hui, l’auteur de réputation mondiale continue son tour du monde selon les invitations qu’il reçoit lors de la sortie d’un de ses livres, donnant des entrevues dans l’un ou l’autre des pays où il est publié. L’écrivain aime la route.
S’il ne l’a pas encore visitée, Martel se rendra dans la région où se déroule son récit et y retournera si nécessaire. Il aime visualiser les paysages et les couleurs des lieux ; sentir les parfums, rencontrer les gens, entendre la langue et observer les us et coutumes. L’idée de L’histoire de Pi est née alors qu’il faisait un séjour de six mois en Inde. Pour écrire Béatrice et Virgile, Martel se rendra trois fois à Auschwitz, afin de s’imprégner dans ce lieu tristement célèbre de ce qu’était un camp de la mort. Jeune universitaire, l’auteur avait parcouru le Portugal sac au dos, mais il y retournera pour préparer Les Hautes Montagnes du Portugal.
Un séjour d’écrivain en résidence a mené Yann Martel à Saskatoon en 2003, où est venue le rejoindre celle qu’il avait rencontrée en Angleterre la même année, dans un festival de littérature. La Londonienne Alice Kuypers, auteure de plusieurs best-sellers, a ainsi pris mari et pays. Quand le couple ne voyage pas, il retrouve ses quatre jeunes enfants dans cette tranquille petite ville du centre de la Saskatchewan. À l’écart du fracas du monde, Martel et Kuypers écrivent.
Le conteur-nomade a trouvé maison au cœur des Prairies canadiennes. Il est chez lui dans ce paisible lieu isolé. Martel est l’antithèse de son personnage de prêtre exilé en Angola en 1631, dont le journal est à l’origine de la quête de Tomás dans Les Hautes Montagnes du Portugal. « Isso es minha casa. ‘Ceci est chez moi’. […] La page entière était couverte de ces mêmes mots. […] Le père Ulisses, de toute évidence, avait été tenaillé par un intense mal du pays. »
On n’est guère étonné d’apprendre que Yann Martel a étudié la philosophie, qu’il pratique le yoga, qu’il est végétarien, qu’il ne boit pas d’alcool ni ne fume ou qu’il a été bénévole dans un centre de soins palliatifs. Tout se tient. Il semble vivre le moment présent et n’accorder que l’attention nécessaire aux biens matériels. Grâce à ses droits d’auteur, il est financièrement à l’aise. « Je n’ai pas besoin de plus d’argent », a-t-il dit un jour. Cohérent, le romancier mène une vie simple et il n’écrit que pour son propre plaisir, un luxe inouï.
1. Après « Sans abri » et « Sur le chemin de la maison », « À la maison » est le titre donné à la troisième et dernière partie des Hautes Montagnes du Portugal.
Yann Martel a publié, entre autres :
Paul en Finlande, Boréal, 1993 ; Self, XYZ, 1998 ; L’histoire de Pi (The Man Booker Prize 2002 et prix Hugh MacLennan 2002 pour Life of Pi et prix Grand Public du Salon du livre de Montréal 2003), XYZ, 2003 ; Mais que lit Stephen Harper ? Suggestions de lectures à un premier ministre et aux lecteurs de toutes espèces, XYZ, 2009 ; Béatrice et Virgile, XYZ, 2010 ; 101 lettres à Stephen Harper, XYZ, 2011 ; Les Hautes Montagnes du Portugal, XYZ, 2016.
À jour juillet 2016
EXTRAITS
Nous sommes partis de Madras le 21 juin 1977, sur le Tsimtsum, un cargo japonais enregistré à Panama. Les officiers étaient japonais, l’équipage était taïwanais et c’était un gros navire impressionnant. […] Tandis que le cargo quittait le quai et qu’on le pilotait jusqu’à la mer, j’agitais furieusement les deux mains pour faire mes adieux à l’Inde. Le soleil brillait, le vent était stable et des mouettes criaient au-dessus de nous. J’étais très excité.
Ensuite, les choses ne se sont pas passées comme il était prévu. Que peut-on faire ? Il faut prendre la vie comme elle vient et en tirer le meilleur parti.
L’histoire de Pi, p. 103.
La mer était agitée, le ciel gris.
Je me lassai de mon infortune, aussi absurde que la météo. Mais la vie s’accrochait à moi. Le reste de cette histoire est tout de peine, de douleur et de résistance.
Ce qui est élevé abaisse, et ce qui est bas élève. Je vous le dis, si vous étiez dans une situation désespérée comme celle où je me trouvais, vos pensées aussi s’élèveraient. Plus on est dans l’abîme, plus notre esprit veut s’envoler. Quoi de plus naturel que, démuni et désespéré comme je l’étais, livré à une souffrance implacable, je me sois tourné vers Dieu ?
L’histoire de Pi, p. 297.
Et puis merde, Henry n’était même pas juif, alors pourquoi ne se mêlait-il pas de ses propres problèmes ? Tout est une affaire de contexte et, de toute évidence, le contexte n’était pas le bon. […] Henri réalisa alors quelle réponse il aurait dû donner à l’historien. Son livre […] montrait comment on lui avait arraché son âme et, attachée à elle, sa langue. Est-ce que tous les livres sur l’Holocauste ne touchaient pas le même sujet : l’aphasie ?
Béatrice et Virgile, p. 24.
VIRGILE : Selon moi, la foi, c’est comme être au soleil. Quand tu es au soleil, peux-tu éviter de créer une ombre ? Peux-tu te défaire de cette zone d’obscurité qui s’accroche à toi, qui épouse toujours ta forme, comme pour te rappeler continuellement à toi-même ? Non, tu ne peux pas. Cette ombre, c’est le doute. Et elle t’accompagne partout, pourvu que tu restes au soleil. Et qui ne souhaite pas être au soleil ?
BÉATRICE : Mais le soleil est parti, Virgile, il est parti !
(Elle fond en larmes et sanglote bruyamment.)
Béatrice et Virgile, p. 110.
Il pleure parce qu’il a perdu son emploi, et que fera-t-il désormais, comment gagnera-t-il sa vie ? […] Il pleure parce que son père lui manque. Il pleure parce que son fils et son amoureuse lui manquent. […] Il pleure parce que, parce que, parce que.
Il pleure comme un enfant, reprenant son souffle, pris de hoquets, le visage en larmes. Nous sommes des animaux apparus par pur hasard. Voilà ce que nous sommes, et nous n’avons que nous, rien d’autre – il n’y a pas de relation plus élevée.
« Sans abri », Les Hautes Montagnes du Portugal, p. 139.
Eusebio parle doucement. « Il n’est pas facile de vieillir, Senhora Castro. C’est là une terrible et incurable pathologie. Tout comme le grand amour. Au début, c’est bien. Une maladie des plus désirables. Sans laquelle on ne voudrait pas vivre. Elle est pareille à la levure qui corrompt le jus des raisins. On aime, on aime, on s’acharne à aimer – la période d’incubation peut être très longue –, et puis vient avec la mort le chagrin d’amour. Il faut toujours que l’amour trouve une fin non désirée. »
« Sur le chemin de la maison », Les Hautes Montagnes du Portugal, p. 190.
Quelques noms remontaient, une vague géographie s’esquissait, centrée autour d’un seul toponyme : Tuizelo. C’était de là qu’étaient originaires ses parents et c’est là qu’Odo et lui s’installeront.
Mais il ne connaît rien du pays. Il est Canadien jusqu’au bout des ongles. Tandis qu’ils roulent dans la lumière du jour qui va s’estompant, il remarque à quel point le paysage est beau, à quel point le monde rural est animé. Il y a partout des bêtes et de la volaille, des ruches et des vignes, des champs labourés et de petits bois signés. Il voit des gens qui transportent du bois de chauffage sur leur dos, des ânes qui transportent des paniers chargés sur le leur.
« À la maison », Les Hautes Montagnes du Portugal, p. 272.











