Ironie ou ineptie, me suis-je demandé en me lançant dans cette randonnée en plein air que nous propose Yan Hamel1, alors que personne ne peut sortir de chez soi ou, dans le meilleur des cas, que la pratique de la distanciation restreint nos déplacements à une misère.
Même l’âme la plus chagrine n’aurait pu imaginer que notre monde contemporain se pulvériserait en un battement de cils. Ou plutôt un éternuement. C’est alors que nous viennent en tête les paroles de Daniel Lavoie : Et si tout doit sauter / S’écrouler sous nos pieds, laissons-nous rêver. Quoi de mieux, toute confinée que l’on soit, qu’un rêve de liberté en forme de chronique lettrée, le nez au vent, les pieds sur terre, le mental en cavale, accompagnée de deux beaux esprits, Yan Hamel et sa Beauvoir.
Dès l’amorce de son chant à celle que Claude Lanzmann identifie comme cette lumière du monde qui s’appelle à jamais Simone de Beauvoir, l’auteur nous prévient qu’il tourne le dos aux guillemets, ces barbelés typographiques. Il nous explique que puisqu’il est impossible d’y contenir Beauvoir, il la citera en italique seulement. Cette licence grammaticale nous dispose dans l’instant à une lecture détendue, affranchie d’un corset dont il fait bon se débarrasser.
C’est à Sifnos, île du sud-ouest de l’archipel des Cyclades, que l’idée vint à Yan Hamel, spécialiste de la littérature et de la société françaises du XXe siècle, d’emprunter les sentiers écumés par la philosophe qui aspirait, dès son jeune âge, à être heureuse et à se donner le monde. Bardée de ces objectifs qu’elle soude au refus net que la vie eût d’autres volontés que les siennes, comment cette femme aurait-elle pu devenir le pot de chambre du sartrisme, comme certains maîtres penseurs l’ont perçue, et avoir contracté une espèce de mariage morganatique, où le prince Sartre l’aurait extirpée de sa condition intellectuelle inférieure
D’Uzerche à Théra
Sur les routes, les sentes ou les crêts, des pinèdes de l’Uzerche aux ruines de Théra, Yan Hamel quadrille les mémoires beauvariennes, mais pas question d’évoquer ses luttes pour l’avortement libre ou ses combats politiques aux côtés de Sartre. À peine est effleuré le phare dans la nuit que fut Le deuxième sexe. En revanche, il ne lâche pas d’une semelle l’intellectuelle qui marche au mépris des prédateurs qu’elle croise, la trekkeuse téméraire qui prend tous les risques, passe à deux doigts de se rompre les os, voire d’y laisser sa peau. Il retrace l’épicurienne qui décline dans son œuvre biographique les plaisirs de la table, ici un lapin chasseur, là des cailles aux raisins, dégustés dans une petite auberge d’un quelconque hameau, à l’heure du repos.
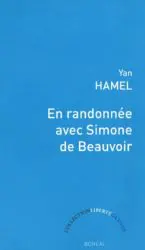 Projet littéraire ambitieux qui nous mène à tous vents, de la scène opératique – les mouvements vont du scherzo avec de très jeunes femmes au largo appassionato dans les bras de Nelson Algren – à la scène onirique où l’essayiste veut réveiller Jacques Brault, enfoncer une rose dans le cul de Paul Valéry, mais se retient et la garde pour Yvon Rivard qui en aura bien besoin quand Virginia Woolf cessera sous peu d’être sa pute. On se gardera d’en déduire quoi que ce soit, car comme il l’écrit : interpréter un rêve, c’est interpréter une interprétation.
Projet littéraire ambitieux qui nous mène à tous vents, de la scène opératique – les mouvements vont du scherzo avec de très jeunes femmes au largo appassionato dans les bras de Nelson Algren – à la scène onirique où l’essayiste veut réveiller Jacques Brault, enfoncer une rose dans le cul de Paul Valéry, mais se retient et la garde pour Yvon Rivard qui en aura bien besoin quand Virginia Woolf cessera sous peu d’être sa pute. On se gardera d’en déduire quoi que ce soit, car comme il l’écrit : interpréter un rêve, c’est interpréter une interprétation.
Tantôt adorateur, tantôt contempteur, l’auteur-randonneur s’emporte quelquefois et va loin. Je vous laisse en juger : Alors j’écris sur son œuvre vivante et sur son corps défunt. Je la lis, je la saisis par tous les côtés, méthodiquement ; je fourre à fond mes mots dans les siens, ou l’inverse ; je me la fais, et je la repasse sans cérémonie à qui veut la prendre, horrible et magnifique. De cet aveu, qu’il soit cependant compris que lui et elle partagent un langage commun, celui des sentiers. Chemin faisant, il nous donne à voir le feu intérieur de Beauvoir.
Amours contingentes, amours délictuelles
Sous la dialectique sophistiquée des amours contingentes se dissimule, parmi l’une d’elles, l’élève du lycée Molière, où enseigne Beauvoir. En 1943, l’Éducation nationale la suspend pour « incitation de mineure à la débauche ». L’incident met fin à sa carrière de pédagogue. L’auteur ne se dérobe pas devant le contentieux que le mouvement #MoiAussi a puissamment fait resurgir et qui pourrait se résumer ainsi : faut-il séparer l’artiste de son œuvre ?
Combien il s’avère difficile de répondre à une question, me semble-t-il, mal formulée. Ne conviendrait-il pas plutôt de reconnaître que l’œuvre est indissociable de l’artiste et, quand il – ou elle – a posé des gestes condamnables, que faire de l’une et de l’autre ? Yan Hamel ouvre une riche option de réflexion et sa proposition mérite d’être citée in extenso : Il me semble important, quitte à le critiquer, de garder une place pour ce qui eut lieu : ce scandale d’une femme qui osa outrepasser la morale et les bonnes mœurs pour se donner à elle-même les droits que, de tout temps, des hommes sans vergogne se sont arrogés. Ce débat éthique nécessitera une stricte analyse différenciée entre les sexes, laquelle, à ma connaissance, n’a pas été menée. Entre autres questions, il conviendra de poser celle-ci : quelle est la part de Sartre dans ces liaisons dangereuses, et a-t-il mérité le même opprobre ?
Tout compte fait
Le seul reproche, si cela en est un, c’est un certain élitisme de l’écrivain qui glisse de la critique sentie du tourisme de masse et son cheptel de visiteurs domestiqués vers celle des dilettantes en quête de quelque révélation. Il compare sans aménité le Jacquet croisé sur son chemin, un valet de pied, souillé et novice au randonneur averti. Je connais les soixante-quinze kilomètres de marche sportive, presque militaire, au rythme de six kilomètres-heure. Je connais la marche si libre qu’elle égare et peine à trouver son chemin du retour. Je connais un peu la randonnée, par exemple dans le massif du Vercors, quand le regard terrifié plonge dans le ravin, déchire le ventre et rend la peau plus blanche que neige. Ce que je sais aussi, c’est que la marche et la randonnée sauvent la vie. Celle du pèlerin vers Compostelle, de la randonneuse areligieuse ou du marcheur vagabond. Celle de Marco Stanley Fogg, personnage de Paul Auster dans son roman Moon Palace. Et distanciée – pandémie oblige –, la marche devient salutaire en ces temps troubles où presque toute autre activité affiche un signe de danger. En ce sens, s’il n’est pas prémonitoire, En randonnée avec Simone de Beauvoir arrive à point nommé.
À l’unisson, le Castor et son compagnon de route québécois prônent la randonnée libre, de préférence en solitaire, sans complaisance, rigoureuse comme les aventures et les égarements en littérature. Yan Hamel a beau dire et beau voir la complexité de cette femme d’exception, elle demeure au bout du périple une figure énigmatique à bien des égards. C’est heureux qu’il en soit ainsi, car nous vient le goût de replonger dans ses mots, sous l’éclairage subtil et intense du sherpa.
Tiens, je vais sur-le-champ chercher dans ma bibliothèque La force des choses pour son pouvoir intellectuel, et faire venir de ma librairie indépendante favorite Lettres à Nelson Algren pour celui d’Éros. Et je me plais à imaginer, avec ces salons de coiffure fermés, nous voir remettre au goût du jour le célèbre turban philosophique.
1. Yan Hamel, En randonnée avec Simone de Beauvoir, Boréal, Montréal, 2020, 216 p. ; 25,95 $.
EXTRAITS
L’inconscient collectif masculin veut adorer un objet de désir féminin qui reste à sa disposition ; il punit par l’enfermement, la mutilation ou la mort celles qui se donnent le droit d’être des sujets en mouvement, d’agir librement et, surtout, d’échapper à l’adoration mâle.
p. 129
Beauvoir a pu mépriser les lois non écrites de la société patriarcale, et affronter la punition qui lui était réservée par la sauvagerie masculine, afin que le monde devienne sien.
p. 141
Le Castor ignorait les demi-mesures. Un seul projet l’animait : tout embrasser, et témoigner de tout. Elle était sans dieu et antimétaphysicienne : l’univers ne décourageait pas son appétit. Elle était décidée à en dresser un inventaire complet.
p. 161
Une femme – une philosophe – en un montage de périodes lisses comme un bloc de glace sculpté dans les règles de l’art ne laisse rien sentir de ce travail ardu qu’exige l’écriture du rappel.
p. 179
Peu de femmes ont mieux su que Simone de Beauvoir montrer que philosopher, c’est apprendre à mourir. Mais avoir réfléchi des années durant à l’inévitable ne l’aura pas pour autant amenée à se donner à elle-même une mort à la hauteur de son parcours exceptionnel.
p. 209











