La guerre d’Espagne, comme la Deuxième Guerre mondiale dont elle fut à bien des égards la préfiguration, continue de hanter la mémoire collective. Et la littérature. À preuve le fort et émouvant récit Pas pleurer1 que Lydie Salvayre a recueilli de sa propre mère qui en fut le témoin et la victime.
Rappelons les événements principaux de ces années 1930 en Espagne, mouvementées, confuses et violentes qui conduisirent à une déflagration européenne, puis mondiale et qui eurent leur écho en particulier dans des romans qui les font revivre. L’Espagne est depuis 1931 une république mais faible, rongée par le nationalisme revendicateur dans plusieurs régions qui menace l’unité du pays, la crise économique et le chômage, séquelles de la grande crise de 1929. La domination de l’Église sur la société alimente en retour un violent anticléricalisme et contribue à entretenir un vif esprit révolutionnaire. Le climat est donc propice en Espagne, comme à la même époque en Allemagne et en Italie, à des soulèvements et à des prises de pouvoir fascistes.
Un pays coupé en deux
 En juillet 1936, le général Franco avec ses troupes tente un coup de force, qui échoue partiellement, car le gouvernement résiste. Rapidement le pays va se trouver coupé en deux, et le conflit s’étend par l’intervention des puissances étrangères. D’une part, les républicains constitués en armée populaire que rejoignent les mythiques Brigades internationales, volontaires venus de 53 pays mais dont le nombre ne dépassera pas environ 20 000. Parmi eux, des écrivains, André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Arthur Koestler comme journaliste. De l’autre, les putschistes bien entraînés et armés, grossis par la Phalange, mouvement fascisant engagé dans une « croisade » nationaliste encouragée par les dignitaires de l’Église. La Russie stalinienne envoie du matériel et des « conseillers » qui font bientôt faire « l’épuration » des trotskistes et des anarchistes. De leur côté, l’Italie de Mussolini et l’Allemagne de Hitler envoient à Franco des armes, des avions et des pilotes. Ce beau monde d’intervenants est évidemment moins soucieux de la destinée des Espagnols que des bénéfices à venir : on a pu dire que la guerre civile espagnole constituait un terrain de manœuvre, une répétition générale pour les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne de Chamberlain choisit de s’abstenir, de même que la France du socialiste Léon Blum, encore traumatisée par l’hécatombe de 14-18 et peu désireuse de se lancer dans une autre aventure guerrière. Elle fermera d’ailleurs sa frontière pyrénéenne, mais des fugitifs réussiront à passer.
En juillet 1936, le général Franco avec ses troupes tente un coup de force, qui échoue partiellement, car le gouvernement résiste. Rapidement le pays va se trouver coupé en deux, et le conflit s’étend par l’intervention des puissances étrangères. D’une part, les républicains constitués en armée populaire que rejoignent les mythiques Brigades internationales, volontaires venus de 53 pays mais dont le nombre ne dépassera pas environ 20 000. Parmi eux, des écrivains, André Malraux, Ernest Hemingway, George Orwell, Arthur Koestler comme journaliste. De l’autre, les putschistes bien entraînés et armés, grossis par la Phalange, mouvement fascisant engagé dans une « croisade » nationaliste encouragée par les dignitaires de l’Église. La Russie stalinienne envoie du matériel et des « conseillers » qui font bientôt faire « l’épuration » des trotskistes et des anarchistes. De leur côté, l’Italie de Mussolini et l’Allemagne de Hitler envoient à Franco des armes, des avions et des pilotes. Ce beau monde d’intervenants est évidemment moins soucieux de la destinée des Espagnols que des bénéfices à venir : on a pu dire que la guerre civile espagnole constituait un terrain de manœuvre, une répétition générale pour les belligérants de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne de Chamberlain choisit de s’abstenir, de même que la France du socialiste Léon Blum, encore traumatisée par l’hécatombe de 14-18 et peu désireuse de se lancer dans une autre aventure guerrière. Elle fermera d’ailleurs sa frontière pyrénéenne, mais des fugitifs réussiront à passer.
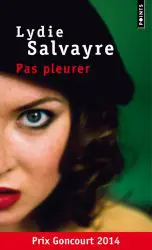 Plusieurs épisodes de cette guerre impitoyable, d’une extrême violence pour les combattants et pour les populations civiles, sont bien connus par la littérature et par l’art. Le bombardement de Guernica par les avions allemands a inspiré le célèbre tableau de Picasso. La bataille de Teruel finalement gagnée par les nationalistes est centrale dans L’espoir de Malraux, l’offensive de Ségovie sert de trame à Pour qui sonne le glas de Hemingway. La longue résistance de Barcelone et de la Catalogne offre la toile de fond à Pas pleurer. Tout aussi tristement célèbre, l’exécution de García Lorca deviendra le symbole de l’assassinat du Poète – et de la poésie – par les barbares.
Plusieurs épisodes de cette guerre impitoyable, d’une extrême violence pour les combattants et pour les populations civiles, sont bien connus par la littérature et par l’art. Le bombardement de Guernica par les avions allemands a inspiré le célèbre tableau de Picasso. La bataille de Teruel finalement gagnée par les nationalistes est centrale dans L’espoir de Malraux, l’offensive de Ségovie sert de trame à Pour qui sonne le glas de Hemingway. La longue résistance de Barcelone et de la Catalogne offre la toile de fond à Pas pleurer. Tout aussi tristement célèbre, l’exécution de García Lorca deviendra le symbole de l’assassinat du Poète – et de la poésie – par les barbares.
En réalité tous les « barbares » ne se trouvent pas d’un seul côté : républicains et nationalistes semblaient rivaliser dans les tueries, utilisant les méthodes des SS nazis et répétant une fois encore la fureur meurtrière qui s’est emparée des Blancs et des Rouges dans la Russie de 1917 ou plus tard des Serbes face aux Bosniaques dans l’ex-Yougoslavie (pour ne citer que des exemples européens). Quand Franco déclarera en 1939 : « la guerre est finie », le nombre des victimes impossible à établir sera évalué entre 400 000 et un million. Morts au cours des combats mais aussi, pour la première fois, civils dans les bombardements et les exécutions massives qui n’épargnent ni les jeunes, ni les vieux, ni les religieux, ni des personnalités politiques. Les « épurations » et les règlements de comptes habituels à la suite des guerres se prolongeront encore pendant des années.
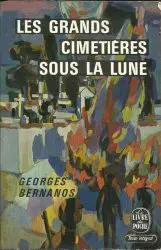 C’est là que nous voyons intervenir par le verbe et la plume Georges Bernanos. Les grands cimetières sous la lune – cités abondamment par Lydie Salvayre et qui constituent une des voix du récit – assemblent des textes pamphlétaires et des chroniques dans lesquels il ne faut guère chercher un ordre chronologique ni une démonstration articulée. Bernanos, dont on connaît les opinions monarchistes et catholiques, volontiers antiparlementaires et non dénuées d’une certaine méfiance envers les Juifs (il reconnaissait son maître en Édouard Drumont, l’auteur de La France juive), l’homme de droite convaincu, militant et flamboyant, vivait à Majorque au moment du pronunciamento de Franco. Il voyait d’un œil favorable la « croisade » catholico-nationaliste de la Phalange (à laquelle appartenait son propre fils). Brutalement la réalité lui saute au visage : les enlèvements et exécutions de malheureux déclarés « républicains » donc ennemis, sur dénonciation, par vengeance ou sans aucune raison, les évêques (dont il fournit la liste) cautionnant les tueries et bénissant les canons de Franco et de ses sbires. Bernanos horrifié dénonce les atrocités commises au nom de la croisade antibolchevique. Pour le lecteur d’aujourd’hui qui n’a pas une connaissance précise de la France politique d’avant-guerre, le livre est parfois peu intelligible, bien des références et allusions lui échappent, noyées dans un discours diffus et répétitif. Inlassablement Bernanos revient en effet sur ses motifs de détestation et de colère, emporté par un souffle infatigable, un verbe inépuisable – qui met à l’épreuve le lecteur. Tel un prophète biblique, avec des coups de griffe à Claudel, qui a écrit des poèmes sur cette guerre, et à bien d’autres contemporains qui ont vendu leur âme au diable, sans oublier bien sûr Mussolini et Hitler, mais ceux-ci n’ont pas encore donné toute leur mesure, il dénonce l’aveuglement, la lâcheté, l’hypocrisie, l’indifférence de beaucoup, les méfaits de l’Église devenue celle des puissants et des nantis, la Terreur régnante. Défenseur et admirateur du peuple qu’il connaît, de ces hommes qui furent de la chair à canon en 1914, des images de la guerre qu’il a faite lui reviennent avec la persistante nostalgie de l’Europe chrétienne de jadis (imaginée plus que réelle mais ici qu’importe !). Quelle force, quelle flamme, quelle fulgurance parfois dans la formule ! « La tragédie espagnole est un charnier », s’exclame-t-il (Les grands cimetières sous la lune, p. 191). Dans cette véritable profession de foi, il veut donner le témoignage d’un « homme libre », de sa passion à défendre la justice, l’honneur chrétien, « fusion mystérieuse de l’honneur humain et de la charité du Christ » (ibid., p. 416).
C’est là que nous voyons intervenir par le verbe et la plume Georges Bernanos. Les grands cimetières sous la lune – cités abondamment par Lydie Salvayre et qui constituent une des voix du récit – assemblent des textes pamphlétaires et des chroniques dans lesquels il ne faut guère chercher un ordre chronologique ni une démonstration articulée. Bernanos, dont on connaît les opinions monarchistes et catholiques, volontiers antiparlementaires et non dénuées d’une certaine méfiance envers les Juifs (il reconnaissait son maître en Édouard Drumont, l’auteur de La France juive), l’homme de droite convaincu, militant et flamboyant, vivait à Majorque au moment du pronunciamento de Franco. Il voyait d’un œil favorable la « croisade » catholico-nationaliste de la Phalange (à laquelle appartenait son propre fils). Brutalement la réalité lui saute au visage : les enlèvements et exécutions de malheureux déclarés « républicains » donc ennemis, sur dénonciation, par vengeance ou sans aucune raison, les évêques (dont il fournit la liste) cautionnant les tueries et bénissant les canons de Franco et de ses sbires. Bernanos horrifié dénonce les atrocités commises au nom de la croisade antibolchevique. Pour le lecteur d’aujourd’hui qui n’a pas une connaissance précise de la France politique d’avant-guerre, le livre est parfois peu intelligible, bien des références et allusions lui échappent, noyées dans un discours diffus et répétitif. Inlassablement Bernanos revient en effet sur ses motifs de détestation et de colère, emporté par un souffle infatigable, un verbe inépuisable – qui met à l’épreuve le lecteur. Tel un prophète biblique, avec des coups de griffe à Claudel, qui a écrit des poèmes sur cette guerre, et à bien d’autres contemporains qui ont vendu leur âme au diable, sans oublier bien sûr Mussolini et Hitler, mais ceux-ci n’ont pas encore donné toute leur mesure, il dénonce l’aveuglement, la lâcheté, l’hypocrisie, l’indifférence de beaucoup, les méfaits de l’Église devenue celle des puissants et des nantis, la Terreur régnante. Défenseur et admirateur du peuple qu’il connaît, de ces hommes qui furent de la chair à canon en 1914, des images de la guerre qu’il a faite lui reviennent avec la persistante nostalgie de l’Europe chrétienne de jadis (imaginée plus que réelle mais ici qu’importe !). Quelle force, quelle flamme, quelle fulgurance parfois dans la formule ! « La tragédie espagnole est un charnier », s’exclame-t-il (Les grands cimetières sous la lune, p. 191). Dans cette véritable profession de foi, il veut donner le témoignage d’un « homme libre », de sa passion à défendre la justice, l’honneur chrétien, « fusion mystérieuse de l’honneur humain et de la charité du Christ » (ibid., p. 416).

 C’est ce Bernanos défenseur de la vérité qui est partout présent dans le roman de Lydie Salvayre, appelé comme témoin et comme juge ou justicier. Sans doute aussi pour élargir la portée du récit qui ne se veut pas simplement anecdotique, pour prendre de la hauteur par rapport aux événements qui le composent. Malraux ou Hemingway nous plongent au cœur de l’action, dans l’angoisse avant une action décisive, qu’il s’agisse de réduire au silence un canon ou de faire sauter un pont, dans l’exaltation ou le désespoir qui habite les combattants du peuple, rudes et peu instruits dans Pour qui sonne le glas, ou dans la nouvelle de Sartre « Le mur », intellectuels et aventuriers de L’espoir, tous personnages qui font la guerre, qui débattent des raisons de la faire et tous du côté républicain, les soldats de Franco n’étant vus le plus souvent que de loin, comme l’ennemi à abattre.
C’est ce Bernanos défenseur de la vérité qui est partout présent dans le roman de Lydie Salvayre, appelé comme témoin et comme juge ou justicier. Sans doute aussi pour élargir la portée du récit qui ne se veut pas simplement anecdotique, pour prendre de la hauteur par rapport aux événements qui le composent. Malraux ou Hemingway nous plongent au cœur de l’action, dans l’angoisse avant une action décisive, qu’il s’agisse de réduire au silence un canon ou de faire sauter un pont, dans l’exaltation ou le désespoir qui habite les combattants du peuple, rudes et peu instruits dans Pour qui sonne le glas, ou dans la nouvelle de Sartre « Le mur », intellectuels et aventuriers de L’espoir, tous personnages qui font la guerre, qui débattent des raisons de la faire et tous du côté républicain, les soldats de Franco n’étant vus le plus souvent que de loin, comme l’ennemi à abattre.
Ceux qui ont vu
Le projet de Lydie Salvayre est à la fois plus modeste et plus intime puisqu’elle met en scène sa propre mère et des villageois qu’elle a connus. Non pas récit de guerre, ni épopée, ni considérations théoriques sur le fascisme et la République, mais des souvenirs, disons un roman autobiographique où s’entrelacent la voix de Metse (la mère) racontant son histoire, celle de sa fille (l’auteure), trop jeune pour avoir connu cette guerre et celle de Bernanos à qui elle emprunte son « ironie désespérée ». L’auteure explique sa démarche, elle se documente pour reconstituer les faits dans ce récit conduit habilement entre écrit et oral, qui doit sa saveur à l’hispanisation des mots, au « français bancal » de Metse et, plus globalement, à la tonicité du style narratif. Les événements sont perçus ici à travers la mémoire de la vieille femme qui, certes, ne s’est pas trouvée dans les combats ou les bombardements, mais qui veut oublier cette terrible époque, moins les événements eux-mêmes que les échos qui parviennent au village, rumeurs, ou paroles de ceux qui ont vu. D’abord l’ambiance de l’été 1936 « qui fait basculer les cœurs », l’enthousiasme libertaire qui règne dans la grande ville (Barcelone), où l’on fait brûler des billets de banque « comme de l’ordure » par dédain de l’argent. Espoir fou d’une société nouvelle et naïveté des jeunes don Quichotte face aux choses militaires qui se répercutent dans la famille de Metse, mais un frère, Joseph, est réaliste et inquiet. Il a raison de l’être.
 Le récit refait donc la chronique d’un village, qui suit les faits et gestes de quelques personnages représentatifs, ce qui les unit, et ce qui les sépare de plus en plus à mesure que les franquistes gagnent du terrain et que les esprits s’angoissent et se durcissent. Défilent ainsi Joseph (tué dans une absurde escarmouche), Diego, jeune époux de Metse, rigide dans le style commissaire du peuple stalinien et qui sombrera dans l’ivrognerie, son père le châtelain dépassé par les événements, la tante vieille fille bigote caricaturale (il y a aussi de la drôlerie dans ce livre). Les luttes sourdes ou violentes se précipitent en 1937, l’année de Guernica. La méfiance est dans tous les cœurs au village, véritable microcosme de l’Espagne. Viennent la chute de Barcelone et, ailleurs en Europe, les accords de Munich où la France et la Grande-Bretagne croient avoir sauvé la paix en capitulant devant les exigences de Hitler, la victoire franquiste et les vengeances, l’exode des républicains vers une France peu disposée à les accueillir (la Retirada qui annonce déjà la débâcle de 1940, en France cette fois-ci). La mère part sur la route avec sa fillette (l’auteure), misérables fugitifs traqués comme Gabrielle Roy les a vus et décrits dans d’émouvantes pages de La détresse et l’enchantement.
Le récit refait donc la chronique d’un village, qui suit les faits et gestes de quelques personnages représentatifs, ce qui les unit, et ce qui les sépare de plus en plus à mesure que les franquistes gagnent du terrain et que les esprits s’angoissent et se durcissent. Défilent ainsi Joseph (tué dans une absurde escarmouche), Diego, jeune époux de Metse, rigide dans le style commissaire du peuple stalinien et qui sombrera dans l’ivrognerie, son père le châtelain dépassé par les événements, la tante vieille fille bigote caricaturale (il y a aussi de la drôlerie dans ce livre). Les luttes sourdes ou violentes se précipitent en 1937, l’année de Guernica. La méfiance est dans tous les cœurs au village, véritable microcosme de l’Espagne. Viennent la chute de Barcelone et, ailleurs en Europe, les accords de Munich où la France et la Grande-Bretagne croient avoir sauvé la paix en capitulant devant les exigences de Hitler, la victoire franquiste et les vengeances, l’exode des républicains vers une France peu disposée à les accueillir (la Retirada qui annonce déjà la débâcle de 1940, en France cette fois-ci). La mère part sur la route avec sa fillette (l’auteure), misérables fugitifs traqués comme Gabrielle Roy les a vus et décrits dans d’émouvantes pages de La détresse et l’enchantement.
Ainsi, l’humble histoire de ces femmes résume l’histoire de l’époque, la condense et l’intériorise en déplaçant le regard vers ceux et celles qui l’ont vécue dans le quotidien et dans leur cœur, là où la souffrance est si difficile à effacer. De son côté, Bernanos ne pouvant plus supporter l’horreur devenue régnante à Palma de Majorque, rentre en France, sans illusion sur l’avenir immédiat, une autre guerre, non pas civile celle-là mais qui divisera aussi les esprits sous l’Occupation puis gagnera l’Europe et le monde entier. Lydie Salvayre évoque la voix passionnée qui soulève les Grands cimetières dans une célébration vigoureuse : « Il croyait avoir touché le fond de la hideur… Il avait entendu hurler cent fois VIVE LA MORT… Il avait vu d’honnêtes gens se convertir à la haine… Longtemps il avait essayé de tenir bon… Mais il avait atteint le seuil de ce qu’il pouvait humainement souffrir ». Par la concision mordante, l’ironie amère et douloureuse sans apitoiement, la véhémence sans rhétorique, en maintes pages le récit de Salvayre se hausse à la hauteur de son inspirateur. L’éloge qu’elle en fait se conclut laconiquement sur un « Sale temps pour Bernanos ». Que dirait-il aujourd’hui !
1. Lydie Salvayre, Pas pleurer, prix Goncourt 2014, Seuil, Paris, 2014, 281 p. ; 29,95 $ et Points, 2015.
Note : les citations de Bernanos sont empruntées aux Grands cimetières sous la lune (Le Livre de poche).
EXTRAITS
As-tu comprendi qui étaient les nationaux ? Me demande ma mère à brûle-pourpoint, tandis que je l’aide à s’asseoir dans le gros fauteuil en ratine verte installé près de la fenêtre.
Il me semble que je commence à le savoir. Il me semble que je commence à savoir ce que le mot national porte en lui de malheur. Il me semble que je commence à savoir que, chaque fois qu’il fut brandi par le passé […] il escorta inéluctablement un enchaînement de violences, en France comme ailleurs. L’Histoire, sur ce point, abonde en leçons déplorables.
p. 94-95
Montse, Rosita, Josep et Joan arrivent le soir du 1er août dans la grande ville catalane où les milices libertaires se sont emparées du pouvoir. Et c’est la plus grande émotion de leur vie. Des heures inolvidables (me dit ma mère) et dont le raccord, le souvenir ne pourra jamais m’être retiré, nunca nunca nunca.
Il y a dans les rues une euphorie, une allégresse et quelque chose d’heureux qu’ils n’ont jamais connu et ne connaîtront plus.
p. 110
Je ne sais pourquoi, ces remarques rapportées par ma mère résonnent avec cette phrase de Bernanos que j’ai lue ce matin même et qui disait, je la cite de mémoire, que les hommes d’argent méprisent ceux qui les servent par conviction ou par sottise, car ils ne se croient réellement défendus que par les corrompus et ne mettent leur confiance que dans les corrompus.
Mais à y réfléchir, il m’apparaît clairement que c’est mon présent que cette phrase interroge. Je m’avise du reste, chaque jour davantage, que mon intérêt passionné pour les récits de ma mère et celui de Bernanos tient pour l’essentiel aux échos qu’ils éveillent dans ma vie d’aujourd’hui.
p. 169











