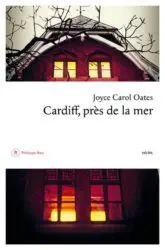Vivez comme si c’était votre vie.
Joyce Carol Oates, Cardiff, près de la mer.
Acquiesçant au propos du philosophe William James selon lequel nos moi publics sont aussi nombreux que les gens que nous connaissons, Joyce Carol Oates ajoute que nous n’avons qu’un seul « moi intérieur, singulier, intraitable et peut-être indéguisable, qui ne se sent jamais davantage chez lui que dans les lieux secrets1 ».
Joyce Carol Oates (JCO) occupe une place unique dans la littérature d’aujourd’hui. « [A] vec la régularité d’un métronome, [elle] replonge dans l’obscurité des âmes et de son pays2. » Les êtres tourmentés s’y trouvent au premier plan. En fondu enchaîné se dresse un portrait des États-Unis, tantôt son maccarthysme hystérique ou sa vénération des armes à feu, tantôt sa démesure montée en religion ou ses violences sociales extrêmes. Elle creuse en profondeur, là où logent les défauts des qualités de cette jeune nation.
L’ordinaire d’une vie qui ne l’est pas
Autant la théorie littéraire la laisse distante, presque indifférente, autant le processus d’écriture allume un feu vif. Obsédée par ses infinis tentacules, son journal en révèle de grands pans, étoffés de moult détails. Les gens de lettres s’en délecteront.
L’écrivaine qui ne souhaitait pas devenir prolifique occupe à temps plein sa principale traductrice, Claude Seban, depuis plus de vingt ans. C’est dire l’ampleur de l’œuvre de celle que l’on a désignée du terme peu flatteur de machine à écrire, terme du reste mérité s’il n’est question que de quantité. Romans, nouvelles, novellas, poésies, essais, pièces de théâtre, récits3. Le compte se perd. Du tapuscrit de son journal de plus de quatre mille pages, son éditeur prend soin de préciser qu’il est dactylographié à interligne simple. Il en publiera une version abrégée en 2009. Déjà en 1973, à 34 ans, elle-même s’étonne de cette abondance : « (C’est vraiment trop. Quand ai-je écrit tout cela… ?) » Devant ces milliers de pages, la raison nous suggère que JCO se relit peu ou prou. Erreur. Elle travaille ses textes par couches successives, les laisse reposer, révise, déplace, rature, élimine. Recommence. Relie, remanie, « ré-imagine ». À l’affût, toujours, elle attend ses personnages sans précipiter leur rencontre, désavouant ainsi son désir premier. Et puis, dit-elle : « Quant à pécher, mes personnages peuvent faire cela pour moi… ! Ils plongent, ils souffrent, parfois ils apprennent parfois ils survivent ».
Où diable trouve-t-elle le temps ? On aurait tort d’imaginer que son univers est spartiate et sa vie, solitaire. Amatrice de boxe, de randonnées à pied ou à vélo, de tennis, elle se découvre une passion pour Chopin et le piano, au point parfois de délaisser l’écriture. Sa « productivité » prend appui sur une stratégie de contrepoids, soit « amour normal, vie normale, travail normal ou en tout cas dépendance normale à l’égard du travail, un rôle plutôt normal dans un environnement plutôt normal ». Le noyau dur de cette normalité,une union solide avec l’auteur, éditeur et éducateur Raymond J. Smith, à qui elle est intensément mariée. Ainsi protégée, elle peut s’exposer à tous les vents violents. Son journal met en relief trois lignes de force : sociable, elle apprécie la compagnie de gens intéressants, estimables et talentueux, même s’ils empiètent sur son temps d’écriture ; ses entrées enflammées donnent la mesure de son intérêt passionné pour l’enseignement, « une sorte de fête intellectuelle » ; l’ambivalence de son rapport à la célébrité y est analysée sous toutes ses coutures, les interprétations du Père simpliste de la psychanalyse (sic) y étant qualifiées de réductrices.
Un aussi bref commentaire est bien sûr impropre à rendre l’épaisseur et la richesse de la pensée dont regorge chaque page du journal de JCO.
Parcimonieuses, les confidences intimes de son journal éclairent une nature heureuse. Foin des tourments qui hantent tant d’écrivains. Or, les univers qu’elle crée dans son recueil de quatre longues nouvelles, Cardiff, près de la mer4, sont à l’opposé de son existence paisible, dans un décor romantique où les jours heureux coulent le long d’une douce rivière ou d’un étang jouxtant un jardin luxuriant. Elle note pourtant dans son journal : « Une vie sereine assurément, du moins en apparence… je doute cependant que la vie ‘sereine’ de quiconque soit vécue ainsi de l’intérieur. Pour nous tous, pour la plupart d’entre nous, le drame s’affirme à chaque instant5 ».
Ce paradoxe s’éteint dans ses nouvelles. Le bonheur paisible n’est plus. Seuls y subsistent les drames au goût d’horreur. Les sfumatos qui floutent les frontières romanesques entre la réalité et le rêve, le réel et le fantasmé, côtoient un réalisme psychologique duquel naît d’abord l’inquiétude. Dans les sinuosités de chacun des quatre chemins empruntés, une femme jeune voit son existence chavirer, car elle y rencontre soit un père qui a décimé sa famille, soit un beau-père qui la harcèle, ou un professeur de philo qui détruit sa vie de doctorante, ou encore un homme au-dessus de tout soupçon qui se fait complice du suicide de sa conjointe poétesse et de l’infanticide par celle-ci de sa fillette de quatre ans.
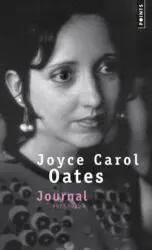 Lentement, la nouvelliste déploie ces histoires complexes, multicouches, en se jouant de nos perceptions ou de nos anticipations. À pas feutrés, notre inquiétude devient malaise et s’y entremêle notre envie impérieuse de connaître le dénouement, et le sort de chacune de ces femmes. La prose sage de Cardiff, près de la mer cache des lieux et des milieux sombres, presque hantés, qu’elle fait surgir d’une imagination nourrie par sa fascination pour les faits divers et les cruautés innommables de son pays.
Lentement, la nouvelliste déploie ces histoires complexes, multicouches, en se jouant de nos perceptions ou de nos anticipations. À pas feutrés, notre inquiétude devient malaise et s’y entremêle notre envie impérieuse de connaître le dénouement, et le sort de chacune de ces femmes. La prose sage de Cardiff, près de la mer cache des lieux et des milieux sombres, presque hantés, qu’elle fait surgir d’une imagination nourrie par sa fascination pour les faits divers et les cruautés innommables de son pays.
Mais la mort sépare ceux qui s’aiment (ou se haïssent)
La mort par homicide, suicide ou maladie, comme dans Respire…6, finit par rompre les liens (malsains) tissés entre les femmes et les hommes imaginés par JCO.
Dans son dernier roman, elle nous fait respirer un air de plus en plus vicié, fidèle à ce mode qui lui sied comme un gant – là où la réalité et le rêve se mélangent si finement qu’il devient difficile de départager l’une de l’autre. La narratrice tutoie son personnage principal, cette trentenaire qui connaît un long, trop long passage quasi psychotique après la mort de son mari, un savant historien des sciences plus âgé qu’elle. L’exploration des arcanes du deuil est ample, d’une maîtrise remarquable. Les refus butés de reconnaître la mort, les accès de folie, les affres de la solitude y sont violents, sanguinaires quelquefois. L’autrice en connaît le refrain, elle qui a enterré deux maris. J’ai réussi à rester en vie témoigne de son premier deuil, Respire…, du second.
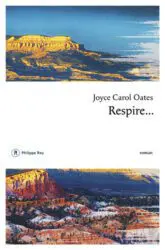 Notre esprit accompagne cette femme hurlante de douleur jusqu’à un point de rupture, saturé par les métaphores, les images, les retours répétitifs. L’effet escompté s’abîme dans le trop-plein, tandis que certaines invraisemblances deviennent indigestes. Plus l’histoire progresse, plus il nous faut constater que la veuve, jeune, lettrée, élégante, ne « possédait » rien en dehors de son mari. Ni profession ni amis. Aucune passion, aucun centre d’intérêt. Une famille absente qui n’en est pas une. Si l’histoire est actuelle, son langage paraît vieux jeu. Si la dernière partie compte des longueurs, la fin paraît précipitée.
Notre esprit accompagne cette femme hurlante de douleur jusqu’à un point de rupture, saturé par les métaphores, les images, les retours répétitifs. L’effet escompté s’abîme dans le trop-plein, tandis que certaines invraisemblances deviennent indigestes. Plus l’histoire progresse, plus il nous faut constater que la veuve, jeune, lettrée, élégante, ne « possédait » rien en dehors de son mari. Ni profession ni amis. Aucune passion, aucun centre d’intérêt. Une famille absente qui n’en est pas une. Si l’histoire est actuelle, son langage paraît vieux jeu. Si la dernière partie compte des longueurs, la fin paraît précipitée.
Blonde en 1 000 pages et en 24 images/seconde
À l’automne 2022, la diffusion sur Netflix de l’adaptation de Blonde7, une vingtaine d’années après sa parution, donne une seconde vie au roman de JCO, finaliste au prix Pulitzer. En avant-propos, l’autrice nous prévient : Blonde n’est pas une biographie de Marilyn Monroe ; seuls 30 % des faits relatés s’appuient sur un filet historique. Elle oriente encore notre lecture en précisant que son texte est une synecdoque, où la partie n’est qu’un aspect du tout. L’écriture de Blonde est indisciplinée. Le sujet narratif change sans crier gare. Les temps se promènent au gré des humeurs de la romancière et à celui de son personnage aux cheveux oxygénés. Quand, au long de plusieurs paragraphes, l’esperluette, 27e lettre de l’alphabet jusqu’au XIXe siècle, se substitue à la conjonction et, on s’irrite quelquefois, puis on se perd en conjectures devant l’usage de ce et commercial dans une œuvre littéraire contemporaine car, dans le parcours de la femme de lettres, si peu est laissé au hasard.
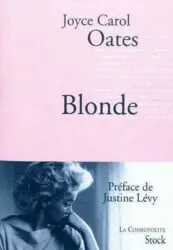 Véritable labyrinthe, Blonde nous convie à une lecture hypnotique, répétitive, qu’on ne saurait qualifier de redondante. Si l’on osait une comparaison, ce serait avec un oignon. Chaque pelure semble pareille à une autre, cependant jamais la même. On cherchera peut-être en vain une plongée aussi profonde dans l’âme de cette femme-allégorie. De cette femme-martyre, dirions-nous, sacrifiée à la meute hollywoodienne des décennies avant qu’un premier prédateur – Harvey Weinstein – ne soit démasqué. Chemin faisant, une plume d’un rare aplomb vise au cœur de la sexualité des hommes, détaillée, détroussée, culbutée. Crue… La conclusion d’une mort par homicide, au demeurant plausible compte tenu des hommes puissants que Marilyn Monroe côtoyait et qui avaient intérêt à la voir disparaître – les frères Kennedy au premier chef –, est audacieuse puisque sa mort, 60 ans plus tard, reste mystérieuse. « La putain du Président était camée & alcoolique & une telle mort [par suicide] ne serait pas inattendue à Hollywood et dans ses environs. »
Véritable labyrinthe, Blonde nous convie à une lecture hypnotique, répétitive, qu’on ne saurait qualifier de redondante. Si l’on osait une comparaison, ce serait avec un oignon. Chaque pelure semble pareille à une autre, cependant jamais la même. On cherchera peut-être en vain une plongée aussi profonde dans l’âme de cette femme-allégorie. De cette femme-martyre, dirions-nous, sacrifiée à la meute hollywoodienne des décennies avant qu’un premier prédateur – Harvey Weinstein – ne soit démasqué. Chemin faisant, une plume d’un rare aplomb vise au cœur de la sexualité des hommes, détaillée, détroussée, culbutée. Crue… La conclusion d’une mort par homicide, au demeurant plausible compte tenu des hommes puissants que Marilyn Monroe côtoyait et qui avaient intérêt à la voir disparaître – les frères Kennedy au premier chef –, est audacieuse puisque sa mort, 60 ans plus tard, reste mystérieuse. « La putain du Président était camée & alcoolique & une telle mort [par suicide] ne serait pas inattendue à Hollywood et dans ses environs. »
Une certaine critique, américaine mais aussi française, a fait un très mauvais parti au film somptueux du cinéaste australien Andrew Dominik, au motif qu’il était sexiste et masochiste. Dans le New York Times, une journaliste l’a même étiqueté de « divertissement nécrophile ». JCO s’est portée à la défense de l’œuvre, arguant que dans l’ère post-#MoiAussi, il était étonnant d’assimiler une réflexion sur la prédation sexuelle à Hollywood à une exploitation misogyne. Au second regard, il appert que le film pèche par excès de drames et de larmes. L’humour décapant et une certaine légèreté de ton propres à la romancière lui font cruellement défaut. Là où le bât blesse surtout, c’est par le peu de cas que le réalisateur accorde à l’intelligence de la brune Norma Jeane Baker (alias Marilyn Monroe). Celle qui a créé la figure et a été la quintessence de l’éternelle blonde idiote était lotie d’une intelligence que l’on disait supérieure à celle d’Einstein, de quoi faire rougir les Kennedy et combien de prestigieux acteurs ou réalisateurs qui l’ont traitée avec le dernier des mépris, pour ne dire que cela. L’écrivaine fait vibrer de mille nuances le tenaillement entre l’esprit brillant de Norma Jeane Baker et les rôles insignifiants ou stupides que l’on a proposés, souvent imposés, à Marilyn Monroe.
Entre le désir insatiable de l’enfant abandonnée et celui, avide, de la femme adulte se glisse une timidité paralysante qui a persisté chez Marilyn, bien qu’elle fût la plupart du temps le « seul vagin en exercice » au sein des maîtres de céans des studios de cinéma, souligne avec ironie JCO. En définitive, une femme perdue et éperdue dans une quête affamée de reconnaissance de son talent et de son intelligence. Marilyn, un tournesol qui n’a eu de cesse de chercher la lumière. En cela, la plus grande réussite de l’autrice, c’est le contraste absolu qu’elle a recréé entre la luminosité extérieure de cette femme archétypale et son obscurité intérieure.
Stupéfaction et consolation
Le recours sans doute peu conscient au sentiment de stupéfaction, fréquent dans les quatre ouvrages de JCO, trahit d’une certaine manière son moi « intérieur » comme si, devant le monde, ses beautés et ses horreurs, elle éprouvait a priori un état stuporeux. Ailleurs, elle antagonise ce moi : « La personne publique jouit (jouit !) de tant d’occasions de se ‘voir̕ dans des miroirs, des miroirs déformants, que le nombre de moi à sa disposition est carrément étourdissant ». Par son écriture frénétique, elle évacuerait son angoisse existentielle. « Le ‘politique’, le ‘social’, l’‘éthique’… des arènes de désespoir suicidaire. »
Dans ses trois œuvres de fiction, elle se range du côté des femmes, en ce qu’elle creuse jusqu’à la moelle les obstacles, infranchissables parfois, auxquels celles-là se heurtent, sans se laisser abuser par leurs errements ou leurs manquements. Sa posture ontologique n’est pas sans rappeler celle de Camille Paglia. Elle fuit comme la peste le féminisme idéologique. Son féminisme se loge du côté de la philosophie, ce qui est tout à son honneur, même quand l’on ne partage pas certaines idées.
Lire Joyce Carol Oates nous garantit un voyage en terre singulière.
1. Journal 1973-1982, trad. de l’anglais par Claude Seban, Points, Paris, 2013, p. 16.
2. Diane de Margerie, « Writer in the Dark », dans Le Magazine littéraire, no 532, juin 2013, p. 532.
3. En 2012, on recensait quelque 115 livres : 55 romans, dont une dizaine de polars parus sous les pseudonymes Rosamond Smith et Lauren Kelly, plus de 400 nouvelles, une dizaine d’essais, des milliers de poésies, plus de 30 pièces de théâtre. S’ajoute ce qu’elle a souhaité ne pas rendre public. Joyce Carol Oates publie chaque année depuis et est toujours active en 2023.
4. Cardiff, près de la mer, trad. de l’anglais par Christine Auché, Philippe Rey, Paris, 2022, 445 p.
5. Journal 1973-1982, op. cit., p. 325.
6. Respire…, trad. de l’anglais par Claude Seban, Philippe Rey, Paris, 2022, 395 p.
7. Blonde, trad. de l’anglais par Claude Seban, Stock, Paris, 2010, 982 p.
EXTRAITS
Son pénis, ses cuisses flasques d’homme d’âge mûr, le petit bout de chair entre ses jambes brandi comme une sorte d’arme mais redevenu mou, ballant et vaincu. Risible.
Cardiff, près de la mer, p. 273.
Les excès des féministes dont elle espérait se distancer. Un certain cabotinage physique/érotique, des provocations inutiles.
Cardiff, près de la mer, p. 389.
La conscience aiguë de soi qu’ont les femmes séduisantes est paralysante. En souhaitant être regardée, la femme renonce à sa propre vision ; elle se sacrifie à son image.
Respire…, p. 34.
Être l’objet du désir masculin, c’est savoir : J’existe ! L’expression du regard. Le durcissement du sexe. Bien que bonne à rien, vous êtes désirée. / Bien que votre mère n’ait pas voulu de vous, vous êtes désirée. / Bien que votre père n’ait pas voulu de vous, vous êtes désirée.
Blonde, p. 210.
Roslyn [le personnage de l’ultime film de Marilyn Monroe] seule courrait dans le désert lors d’une scène soigneusement préparée par l’Actrice blonde et son réalisateur qui lui permettrait d’exprimer, à pleins poumons, sa fureur contre la cruauté masculine.
Blonde, p. 886.