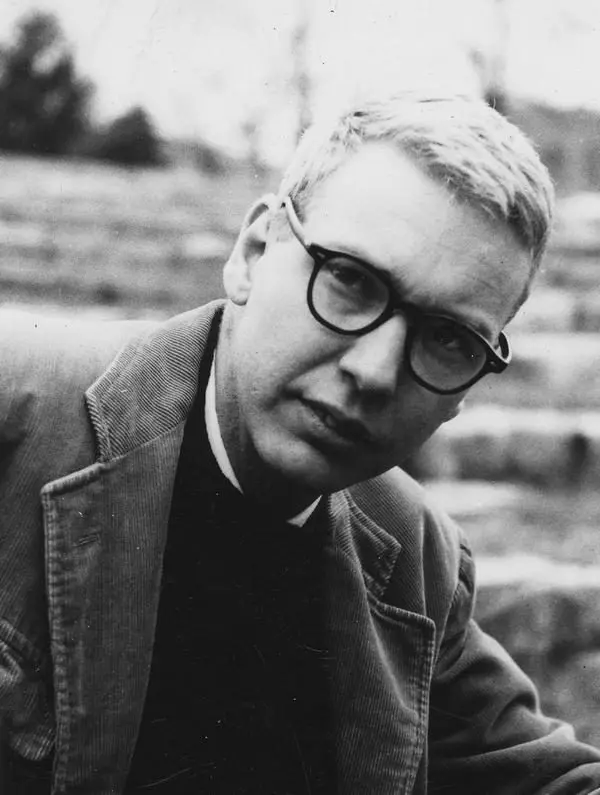Le succès remporté par la minisérie Le jeu de la dame sur Netflix, basée sur le roman éponyme de 1983, a remis au goût du jour le nom de cet auteur dont l’œuvre – six romans et un recueil de nouvelles – avait déjà donné lieu à trois adaptations cinématographiques majeures.
On pensera d’abord au roman L’arnaqueur (1959) et à sa suite La couleur de l’argent (1984), inspiration derrière les films de Robert Rossen (1961) et de Martin Scorsese (1986), mettant tous deux en vedette Paul Newman dans le rôle du joueur de billard et filou « Fast » Eddie Felson. On songera aussi à L’homme tombé du ciel (1963), récit de science-fiction centré sur un extraterrestre exilé, splendidement incarné par David Bowie dans le film de Nicolas Roeg (L’homme qui venait d’ailleurs, 1976). Au moment où Le jeu de la dame cartonne sur Netflix et où l’actrice Anya Taylor-Joy prête ses traits à une Elizabeth Harmon au regard magnétique, Gallmeister a jugé bon de rééditer deux titres-clés de Walter Tevis (1928-1984).
La fillette qui voulut être reine
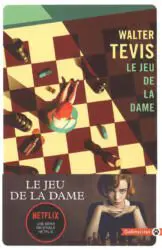 Le jeu d’échecs a maintes fois fasciné les écrivains : souvenons-nous de Poe avec Le joueur d’échecs de Maelzel (1836), Nabokov avec La défense Loujine (1930), Zweig avec Le joueur d’échecs (1943), Simmons avec L’échiquier du mal (1989) ou Süskind avec Un combat (1995). Le jeu de la dame1 vient ainsi enrichir un corpus déjà remarquable en y ajoutant cependant deux facettes capitales : la narration de parties d’échecs comme un véritable suspense et l’inspiration vaguement autobiographique. Certes, Tevis n’était pas aussi doué aux échecs que sa protagoniste, mais il connaissait suffisamment les subtilités du jeu, les joueurs légendaires et les coulisses des grands tournois pour concevoir la plus captivante des fictions. En même temps, Le jeu de la dame n’est pas seulement l’histoire d’une virtuose des échecs ; c’est aussi le roman d’apprentissage d’une jeune fille confrontée aux démons de la drogue et de l’alcool – autre facette de l’œuvre puisant dans la vie de l’écrivain.
Le jeu d’échecs a maintes fois fasciné les écrivains : souvenons-nous de Poe avec Le joueur d’échecs de Maelzel (1836), Nabokov avec La défense Loujine (1930), Zweig avec Le joueur d’échecs (1943), Simmons avec L’échiquier du mal (1989) ou Süskind avec Un combat (1995). Le jeu de la dame1 vient ainsi enrichir un corpus déjà remarquable en y ajoutant cependant deux facettes capitales : la narration de parties d’échecs comme un véritable suspense et l’inspiration vaguement autobiographique. Certes, Tevis n’était pas aussi doué aux échecs que sa protagoniste, mais il connaissait suffisamment les subtilités du jeu, les joueurs légendaires et les coulisses des grands tournois pour concevoir la plus captivante des fictions. En même temps, Le jeu de la dame n’est pas seulement l’histoire d’une virtuose des échecs ; c’est aussi le roman d’apprentissage d’une jeune fille confrontée aux démons de la drogue et de l’alcool – autre facette de l’œuvre puisant dans la vie de l’écrivain.
L’action du roman débute en 1957. Beth Harmon, une orpheline de huit ans, découvre la passion des échecs grâce à M. Shaibel, le factotum du Foyer Methuen à Mount Sterling, dans le Kentucky, où la silencieuse fillette a été placée après la mort de sa mère. Elle avait déjà perdu son père, décédé un an plus tôt pour cause de vie dissolue. Homme de peu de mots et mentor récalcitrant, Shaibel doit pourtant se rendre à l’évidence : Beth est une joueuse phénoménale. Peu à peu, les portes des tournois régionaux s’ouvrent à Beth. Elle se mesure puis se lie à des champions américains comme Harry Beltik et Benny Watts, lui-même ancien enfant prodige. Encouragée par Mme Wheatley, sa mère adoptive, qui l’accompagne de tournoi en tournoi à travers les États-Unis et même au Mexique, et qui chasse son ennui de vivre dans la fine cuisine et dans l’alcool, Beth gravit tous les échelons qui la conduiront à affronter l’as des as, le redoutable grand maître russe Borgov. Parallèlement au récit de son ascension, Beth forme son caractère, fait l’expérience de l’amitié (surtout avec sa compagne d’orphelinat, Jolene DeWitt), explore sa sexualité, acquiert son indépendance. Elle doit aussi surmonter son accoutumance aux tranquillisants, héritée du Foyer Methuen (des cachets de Librium furent, un temps, administrés aux pensionnaires afin de les rendre plus dociles), et un alcoolisme développé solidairement avec celui de Mme Wheatley. Michael Ondaatje prétend relire périodiquement Le jeu de la dame « pour son habileté et le pur plaisir qu’il procure » ; le roman de Tevis semble en effet impossible à lâcher.
Les androïdes rêvent-ils de se suicider ?
 Autre lecture envoûtante, mais d’un tout autre registre, L’oiseau moqueur2 est une dystopie que Tevis a située au XXVe siècle, longtemps après « la mort de la curiosité intellectuelle » et la fin du pétrole. Dans cette société régie par des robots, l’humanité est devenue indolente et désœuvrée. La population mondiale ne comporte plus que dix-neuf millions d’habitants et certaines parties du globe, comme l’Europe et l’Australie, sont partiellement ou totalement désertes. Disparue des mœurs, la lecture est désormais une pratique interdite. Trop intime, elle conduit « à s’intéresser de trop près aux sentiments et aux idées des autres ». Or les individus, élevés dans des internats d’État, ont appris à réprimer tout sentiment lié à autre chose qu’eux-mêmes. Si un doute ou une question les taraude, au lieu de chercher la réponse, ils ont été conditionnés à se détendre et à cesser d’y penser. Si l’inconfort persiste, ils n’ont alors qu’à fumer un joint, s’adonner au sexe-minute ou avaler un comprimé de sopor, cette drogue euphorisante qui fait penser au soma du Meilleur des mondes. Tout a été mis en place pour que l’Homo sapiens vive dans un monde idéal, sans pauvreté ni maladie, ni douleur, ni névrose. Mais ce monde est sur le point d’être ébranlé par trois protagonistes : un robot mélancolique, un professeur qui a appris à lire en autodidacte et une squatteuse du zoo de New York.
Autre lecture envoûtante, mais d’un tout autre registre, L’oiseau moqueur2 est une dystopie que Tevis a située au XXVe siècle, longtemps après « la mort de la curiosité intellectuelle » et la fin du pétrole. Dans cette société régie par des robots, l’humanité est devenue indolente et désœuvrée. La population mondiale ne comporte plus que dix-neuf millions d’habitants et certaines parties du globe, comme l’Europe et l’Australie, sont partiellement ou totalement désertes. Disparue des mœurs, la lecture est désormais une pratique interdite. Trop intime, elle conduit « à s’intéresser de trop près aux sentiments et aux idées des autres ». Or les individus, élevés dans des internats d’État, ont appris à réprimer tout sentiment lié à autre chose qu’eux-mêmes. Si un doute ou une question les taraude, au lieu de chercher la réponse, ils ont été conditionnés à se détendre et à cesser d’y penser. Si l’inconfort persiste, ils n’ont alors qu’à fumer un joint, s’adonner au sexe-minute ou avaler un comprimé de sopor, cette drogue euphorisante qui fait penser au soma du Meilleur des mondes. Tout a été mis en place pour que l’Homo sapiens vive dans un monde idéal, sans pauvreté ni maladie, ni douleur, ni névrose. Mais ce monde est sur le point d’être ébranlé par trois protagonistes : un robot mélancolique, un professeur qui a appris à lire en autodidacte et une squatteuse du zoo de New York.
Le premier de cette triade de personnages est Robert Spofforth. Âgé de 170 ans, il est le dernier « Classe 9 », une série de robots ultrasophistiqués conçus pour devenir des directeurs industriels et des cadres supérieurs (il occupe, pour sa part, les fonctions de doyen de l’Université de New York). Unique Noir de sa catégorie, il est aussi le seul à avoir été programmé pour rester en vie en dépit de ses pensées suicidaires, héritées de Paisley, l’ingénieur brillant mais mélancolique dont le cerveau avait été recopié dans les robots de Classe 9. Ne pouvant mourir tant qu’il reste des humains à servir, Spofforth tente de provoquer leur disparition en causant la dénatalité. Les deux autres protagonistes, Paul Bentley et Mary Lou Borne, vont à la fois servir et contrecarrer ses plans. Bentley est un professeur de l’Ohio qui a accompli l’exploit d’apprendre à lire par lui-même (il a visionné un film montrant une institutrice dans une salle de classe et a graduellement compris le fonctionnement de l’alphabet et de la formation des mots). Pour l’avoir à l’œil, Spofforth le fait venir à New York et lui confie un travail monotone (lire des films muets retrouvés lors de la démolition d’un bâtiment). Dans ses temps libres, Bentley aime à se promener au zoo du Bronx, où il fait la rencontre de Mary Lou, une étrange jeune femme qui, n’ayant nulle part où aller, a élu domicile au Pavillon des Reptiles où un réapprovisionnement quotidien de sandwichs excédentaires lui permet de ne pas mourir de faim. Après s’être enfuie de la Réserve de Marginaux où elle vivait, elle n’a jamais réintégré la société. Elle refuse l’euphorie procurée par le sopor et ne se prive pas de se questionner ou de donner libre cours à ses émotions, pratiquant notamment ce qu’elle appelle la « mémorisation de sa vie ». Fascinante figure d’opposition au système en place, elle devient la compagne de Bentley et tombe enceinte dans ce monde où les enfants ont cessé de naître. Souvent rapproché des dystopies classiques de Huxley, Orwell et Bradbury, L’oiseau moqueur soutient magistralement la comparaison.
1. Walter Tevis, Le jeu de la dame, de l’américain par Jacques Mailhos, Gallmeister, Paris, 2021, 446 p. ; 18,95 $.
2. Walter Tevis, L’oiseau moqueur, trad. de l’américain par Michel Lederer, Gallmeister, Paris, 2021, 336 p. ; 17,95 $.
EXTRAITS
Elle tenait Les Ouvertures modernes aux échecs sous sa table pendant que M. Espero lisait. Elle étudiait les variantes l’une après l’autre, les jouant dans sa tête. Au bout de trois jours les notations – P-4R, C-3FR – surgissaient dans son esprit vif sous la forme de pièces concrètes sur des cases réelles. Elle les voyait sans peine ; elle n’avait pas besoin d’échiquier.
Le jeu de la dame, p. 38.
Elle venait de décider de s’en aller lorsque quelque chose accrocha son regard. Dans le coin en bas à droite, où se trouvaient les magazines de photographie, de bronzage et de bricolage, il y avait un magazine avec une pièce d’échecs en couverture. Elle s’approcha et le sortit du présentoir. La couverture affichait le titre – Revue des échecs – et le prix. Elle l’ouvrit. Il était plein de parties et de photos de gens en train de jouer aux échecs. Il y avait un article intitulé « Le Gambit du roi : nouvelle approche » et un autre intitulé « Les Fulgurances de Morphy ». Elle venait juste d’étudier une des parties de Morphy ! Son cœur s’emballa. Elle continua de feuilleter le magazine. Il y avait un article sur les échecs en Russie. Et il y avait ce mot qui revenait sans cesse : « tournoi ». Il y avait toute une section intitulée « La Vie des tournois ». Elle ne savait pas que ça existait, des tournois d’échecs. Elle pensait que les échecs étaient une activité que vous aviez, comme MmeWheatley faisait des puzzles et des tapis crochetés.
Le jeu de la dame, p. 103.
Pourquoi ne nous parlons-nous pas ? Pourquoi ne nous blottissons-nous pas les uns contre les autres pour nous protéger du vent glacial qui balaye les rues désertes ? Autrefois, il y a très longtemps, il existait des téléphones privés à New York. Les gens se parlaient alors, peut-être à distance, de façon étrange, avec des voix rendues ténues et artificielles par l’électronique, mais ils se parlaient. Des prix des produits alimentaires, des élections présidentielles, du comportement sexuel de leurs enfants, de leur peur de la météo et de leur peur de la mort. Et ils lisaient, ils écoutaient les voix des vivants et des morts leur parler dans un silence plein d’éloquence, connectés à cette rumeur du discours humain qui devait s’enfler dans leur esprit pour dire : Je suis humain. Je parle. J’écoute. Et je lis.
Pourquoi est-ce que plus personne ne sait lire ? Que s’est-il passé ?
L’oiseau moqueur, p. 144-145.
Je possède un exemplaire du tout dernier livre publié par Random House, une société dont le but, jadis, était de publier et de vendre des livres par millions. Ce livre s’intitule : L’Horrible Viol, et il a été publié en 2189. Sur la page de garde, il y a une note qui commence ainsi : « C’est avec ce roman, le cinquième de la série, que Random House met fin aux activités de son département d’édition. La suppression des programmes de lecture dans les écoles depuis ces vingt dernières années a largement contribué à cet état de choses. C’est avec beaucoup de regrets que… » Et ainsi de suite.
L’oiseau moqueur, p. 145.
Et je pouvais les imaginer, ces hommes qui avaient décidé dans un lointain passé de ce que devait être réellement le but de l’humanité et qui avaient mis en place les Internats, le Contrôle Démographique, les Règles d’Intimité et les dizaines d’Édits inflexibles et solipsistes, les Fautes et les Règles qui devaient régir la vie de tous les autres êtres humains jusqu’à ce que l’espèce tout entière eût disparu pour laisser le monde aux chiens, aux chats et aux oiseaux. Ils se prenaient pour des personnages sérieux, graves, attentifs, et ils avaient sans cesse à la bouche des mots comme « bienveillant » ou « compatissant » […] ; ils fumaient la pipe et s’envoyaient des notes sur leurs bureaux couverts de piles de livres et de documents, des notes qui planifiaient le monde idéal de l’Homo Sapiens : un monde sans pauvreté, sans maladie, sans dissension, sans névrose, sans douleur, un monde à l’opposé de celui des films de D.W. Griffith, de Buster Keaton et de Gloria Swanson où régnaient le mélodrame, la passion et la tension, une monde rendu possible par les pouvoirs de la technologie et de la « compassion ».
L’oiseau moqueur, p. 292-293.