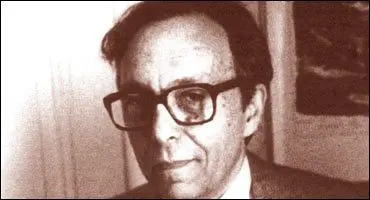Mélancolie et réflexion sont toutes deux un exil. C’est pourquoi, nous enseigne Jean Starobinski, elles ne sont jamais éloignées l’une de l’autre. Elles impliquent chacune un écart, une distance avec la société et avec soi, une certaine ironie, mais aussi le sentiment d’une perte.
Un même mouvement est souvent reconnaissable, dans la mélancolie comme dans la réflexion : le dévoilement. La réflexion présente un péril.
Ce thème du dévoilement, on le retrouve encore dans le comportement masqué et la dénonciation du mensonge, deux attitudes qui ont intéressé notre auteur. Dans tout le XVIIIe siècle, mais aussi dans ceux qui l’ont précédé ou suivi, Jean Starobinski a exploré cette intention et cette condition qu’est la dénonciation de l’apparence et des artifices, le désir de transparence et d’authenticité. Il en a repéré les diverses formes, il en a décrit les mouvements. Historien des idées, il a envisagé la pensée d’abord comme une attitude existentielle, un mode de rapport à soi et de rapport aux autres. Voile et dévoilement, plus qu’une simple forme d’interrogation, définissent une attitude centrale dans notre culture, et la lecture qu’en fait Starobinski, non seulement nous ramène aux sources de nos interrogations et en examine les apories, mais expose les ressorts de nos inquiétudes et de nos tourments.
Le mouvement du dévoilement est présent chez celui qui en fait l’étude. Starobinski sait habiter ce cercle de l’interprétation, qu’il met inlassablement en évidence par la recherche d’une correspondance, dans ses écrits comme dans ceux qu’il étudie, entre la forme et le fond dans le mouvement de la pensée. L’un de ses premiers articles et sans doute l’un de ses meilleurs, « Stendhal pseudonyme » (publié en 1951, repris dans l’Ril vivant), est en tous points exemplaire de son approche. Dès les premières lignes, il étonne et séduit par une question qui est d’abord l’expérience d’un malaise : « Lorsqu’un homme se masque ou se revêt d’un pseudonyme, nous nous sentons défiés. Cet homme se refuse à nous. En revanche nous voulons savoir, nous entreprenons de le démasquer. » La raison de la conduite masquée est le point de départ d’une analyse que je qualifierais volontiers de totale, non parce qu’elle est à la fois littéraire, psychologique, sociologique et philosophique, mais parce qu’elle touche un point essentiel, et d’une façon qui introduit à l’ensemble de l’œuvre étudiée et de son auteur.
La pseudonymie de Stendhal va se révéler, sous la plume de Starobinski, une attitude à la fois étrange et familière, singulière et commune : c’est vouloir se déprendre de soi, de son nom, de ses origines, c’est se placer à distance de soi, une manière de se séparer de soi, en se dissimulant. Elle exprime un refus de toute convention « par la perfection des manières conventionnelles ». Elle est une manière de disparaître pour paraître autrement en société ; une manière de dénoncer en forçant les autres à se regarder eux-mêmes, mais surtout une certaine façon de se créer une intériorité invulnérable en se mettant à l’abri du regard et du jugement des autres. La pseudonymie de Stendhal est un moyen d’échapper à sa condition sociale ou à son corps qui lui font honte. Le masque permet de voir sans être vu, de fuir la servitude extérieure, d’être hors de soi pour mieux se posséder, et ainsi de faire de sa solitude « une retraite inviolable ». C’est devenir un personnage, pour mieux sentir ce que l’on est en deçà des apparences ; un artifice pour lever les apparences, une manœuvre qui devient le moyen de demeurer soi-même : séduire sans être atteint, jouer un sentiment pour mieux l’éprouver. Telle est l’attitude de Stendhal, que discerne Starobinski ; attitude qu’exprime le recours aux masques et qui s’exprimera dans ses romans : se dissimuler pour atteindre la vérité ; user des conventions en les tournant. Le regard de l’autre n’est pas toujours facile à soutenir et « les miroirs sont périlleux ». Et tant qu’à être condamné à jouer, fait remarquer Starobinski, autant jouer le moins mal possible.
Mais c’est Rousseau et Montaigne qui vont permettre à Jean Starobinski de mieux élucider cette entreprise et cette attitude existentielle que sont la critique et la légitimation de l’artifice. Jean-Jacques Rousseau, en effet, offre un cas extrême et paradoxal : il écrit contre le piège que constitue le recours à la parole et à la réflexion ; il dénonce des pièges dont il use pour se déprendre ; il use des miroirs pour se déprendre des regards. Rousseau dénonce l’apparence, la perte et la chute dans lesquelles nous plonge la culture, cherche à retrouver la communication parfaite, celle qui se passe de médiations (le langage, les institutions), et qu’il croira trouver dans un passé imaginaire (l’état de nature), dans l’utopie du Contrat social et de la Volonté générale (fin de la division), dans la confession personnelle, dans la petite enfance, dans les fêtes spontanées des gens simples, dans le spectacle sans artifice, dans l’herborisation et même dans une théorie musicale de l’immédiateté. Captif du dévoilement et de son impossibilité, il écrit pour justifier ses écrits antérieurs, et écrit de nouveau pour justifier et clarifier ses premières justifications, enfermé dans un cercle et une paranoïa.
Montaigne, avant Rousseau, avait dénoncé l’artifice et le déguisement. Mais Montaigne reconnaît la légitimité de l’apparence, qu’il avait d’abord refusée. Starobinski distinguera ainsi trois moments dans sa pensée et le développement de ses Essais : la dépendance subie, la volonté d’indépendance et l’interdépendance acceptée. Si Rousseau demeure irréconcilié, dénonçant et suscitant l’hostilité et l’apparence, trouvant en soi un « asile » qui le convainc de sa propre innocence, Montaigne trouve le moyen de se réconcilier avec l’artifice sans toutefois en être abusé.
Ni biographie, ni exposé des idées de l’auteur étudié, ni explication par le contexte social ou le caractère de la personne, les études de Jean Starobinski sont d’une profonde originalité. Le critique ou l’historien ne cherche pas à expliquer l’œuvre par la vie, non plus que la vie par l’œuvre, mais à montrer leur liaison ou leur connivence, l’interrogation ou le problème qui hante la vie et par conséquent l’œuvre, qui devient le moyen (plus ou moins réussi) de surmonter ce problème ou d’affronter cette interrogation. Pour Starobinski, la cohérence des œuvres n’est pas dans la confirmation que chacune des parties donnerait à l’ensemble, elle est encore moins dans l’absence de contradiction, mais réside plutôt dans la série de variations qu’elle nous propose sur un thème ; thème qui est tout à la fois une préoccupation existentielle et une démarche intellectuelle. La vie et la pensée sont ainsi plus profondément liées qu’elles ne le seraient en cherchant dans la conduite de Rousseau ou de Montaigne une confirmation (par l’exemple) de leur pensée (ce que, dans le cas de Rousseau, on serait bien en difficulté de faire).
Les lectures de Jean Starobinski sont une exploration de notre propre univers intellectuel, social et psychique, autour de la critique des apparences et de la recherche de l’authenticité. On comprend à la lecture de Starobinski, par exemple, pourquoi l’artiste est une figure majeure de notre époque, comment il incarne une aspiration ou traduit une inquiétude commune. La fonction du poète ou de l’artiste est de dévoiler, sinon de désabuser. Il appartient à la société qu’il dénonce ; il use de l’artifice contre l’artifice, il défait l’illusion, quitte à s’illusionner à son tour.
Usant lui-même abondamment de l’artifice (son œuvre est considérable), Jean Starobinski a également analysé les mouvements de la pensée au travers d’histoires de mots (mélancolie, nostalgie, civilisation), dont son dernier ouvrage, consacré au couple « action-réaction », est une illustration. Retraçant le parcours de leurs significations, leurs dérives sémantiques, leur valeur changeante au gré de leurs associations, de leurs usages métaphoriques, et des commentaires, de leurs transferts d’une discipline à une autre, l’historien montre comment les mots« action » et « réaction » vont médiatiser une expérience du corps, une expérience affective ou une expérience politique. De la physique à la politique, du romantisme à la psychopathologie, le couple « action-réaction » a permis différents transferts de sens, de paradigmes et de métaphores. Sans jamais atteindre lui-même un sens précis, il a permis d’ouvrir des chemins, il a contribué à organiser la pensée. Le repérage du mot dans l’histoire est en même temps celui de divers parcours de la pensée qui se croisent à différents moments. Au travers de l’histoire de ces deux mots, Starobinski nous offre une sorte d’histoire moderne de l’interprétation. On assiste à l’organisation d’un champ de la pensée et de l’expérience, à la reprise et au déplacement d’un problème. L’histoire de l’interprétation, ce n’est pas ici uniquement l’histoire intellectuelle de l’Occident moderne, mais plus largement d’une condition, d’un mode d’être, d’un rapport au monde et à la parole. Le sous-titre, Vie et aventure d’un couple (emprunté à Balzac), fait des mots des personnages des êtres vivants dont on suit les vicissitudes de l’existence, la vie agitée.
Starobinski a développé un art de lier la lecture attentive d’une phrase ou d’un court passage d’un livre aux grands mouvements de la pensée occidentale. Manière peut-être de se réconcilier avec le langage et l’artifice, sans se laisser abuser. Loin de toujours séparer, la distance est aussi liaison : la critique est effort pour rétablir une communication ou la prolonger. Méditation sur l’artifice, l’œuvre de Starobinski invite à se réconcilier avec lui, par la subtilité de la pensée et l’élégance de l’expression. La médiation langagière est accès au sens, à défaut d’être accès à l’Être. Elle n’est donc ni un malheur ni une maladie.
Au cours d’un entretien avec Jean Roudaut, il déclarait : « Si j’avais à mettre un avertissement en tête de mes ouvrages, j’écrirais : – C’est un lecteur qui parle. Il vous invite à lire avec lui les rapports qu’il a perçus entre les signes, à écouter la musique plus complexe qui résulte du jeu des voix entendues. Je parle donc pour éveiller une écoute à une autre parole que la mienne, à une autre musique. Il est bon que nous soyons plusieurs à partager ce savoir et cette musique. – » (Magazine littéraire, no 280, septembre 1990, p. 18.).
Principaux ouvrages de Jean Starobinski :
Jean-Jacques Rousseau : la transparence et l’obstacle, Gallimard, 1976 (1957) ; L’œil vivant : Corneille, Racine, Rousseau, Stendhal, Gallimard, 1999 (1960) ; La relation critique, Gallimard, 1970 ; Les mots sous les mots, Gallimard, 1971 ; Montaigne en mouvement, Gallimard, 1982 ; « Le rire de Démocrite, Mélancolie et réflexion », Bulletin de la société francaise de philosophie, 1988 ; Le remède dans le mal : Critique et légitimation de l’artifice à l’âge des Lumières, Gallimard, 1989. ; Action et réaction, Vie et aventures d’un couple (1999).
Ouvrages sur Jean Staroninski : Cahiers pour un temps, Centre Georges Pompidou, Spécial « Jean Starobinski », 1985. ; Magazine littéraire, Spécial « Jean Starobinski », no 280, septembre 1990.