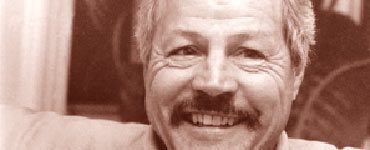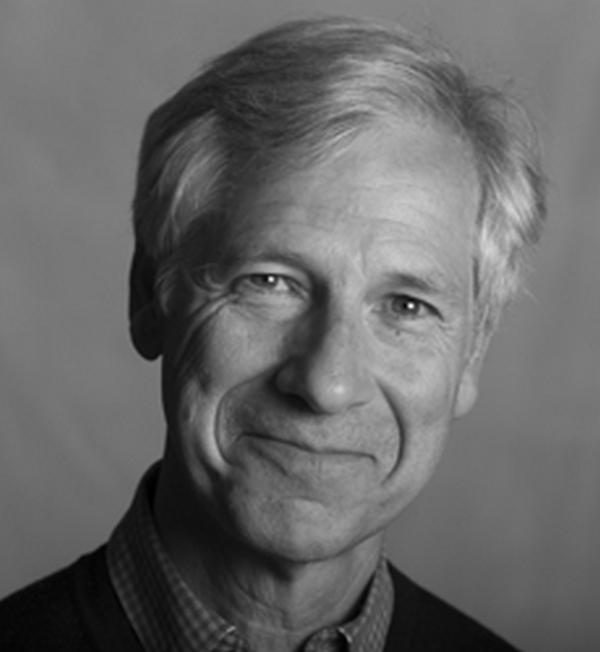Depuis maintenant plus de trente ans, avec une constance qui n’a d’égale que l’acuité de son propos, Jean-Claude Dussault poursuit une œuvre des plus personnelles qui allie poésie, essais et carnets de voyage.
Au-delà de la disparité apparente, un même but se profile : projeter un éclairage sur les zones d’ombre qui recouvrent des pans entiers de notre existence et ainsi élargir notre champ de connaissance, tant de l’univers que nous habitons que de nous-mêmes. S’il fallait qualifier son cheminement, le terme explorateur lui siérait à merveille.
Les rapprochements qu’il a établis dans ses ouvrages précédents entre les modes de pensée en Orient et en Occident, le questionnement soutenu de la réalité, ou plutôt de ce qui nous est donné comme tel, caractérisent sa démarche, qui est avant tout celle d’un esprit libre et critique. Son dernier essai, L’effet Nintendo, Une enquête métaphysique sur la réalité virtuelle, est à la fois d’une rare densité et d’une étonnante limpidité, compte tenu de la matière abordée ici. Jean-Claude Dussault s’y livre, comme le sous-titre le laisse entendre, à une véritable réflexion systématique qui lève le voile sur ce que recouvre le concept de réalité virtuelle. Ces deux mots ont en effet envahi notre discours quotidien sans que nous ayons véritablement soupesé leur charge et leur extension sémantiques. De plus, comme s’emploiera à nous le démontrer l’auteur, ils annoncent des transformations individuelles et sociales encore insoupçonnées.
Des outils sophistiqués
Empruntant à l’allégorie pour illustrer son propos et nous le rendre accessible, tout en s’appuyant sur ses propres recherches antérieures portant sur le désir et la recherche d’harmonie*, Jean-Claude Dussault interroge la réalité et ses fondements, sondant les rapports que nous entretenons avec cette même réalité. Sont ainsi tour à tour appelés à la barre des témoins, philosophes, ethnologues, physiciens, mathématiciens, biologistes, chacun illustrant, selon sa lorgnette respective, tel ou tel aspect de la question.
L’intérêt et l’originalité de son essai reposent en grande partie sur l’analyse et la synthèse des différentes approches qu’il propose et sur les transitions qu’il établit pour mieux cerner le concept de réalité virtuelle, une fois ce dernier dépouillé des attributs superficiels dont l’affublent nombre de gadgets technologiques. Aussi, n’était-il pas inutile que l’auteur nous rappelle et nous démontre, preuves à l’appui, que la réalité virtuelle n’est pas le fruit des récentes découvertes technologiques. Tout au plus ces dernières, qu’elles s’inscrivent dans le domaine de l’informatique, de l’électronique, de la cybernétique, ont-elles contribué au cours des dernières décennies à rendre davantage palpable cette notion de réalité virtuelle, mais ce faisant elles ont également contribué à nous distraire de l’essentiel. L’engouement qu’exerce aujourd’hui la technologie de pointe dans notre vie de tous les jours – Internet en est sans doute le plus bel exemple – illustre à quel point nous ne craignons pas de manipuler des outils sophistiqués dont la finalité nous échappe. Certes, nous en comprenons les modes d’emploi, mais là s’arrête notre maîtrise de l’outil. Comme l’avait fait l’industrialisation, qui a transformé radicalement les conditions de travail des hommes et des femmes du siècle dernier, et peut-être davantage les rapports qu’ils entretenaient entre eux, l’informatisation de notre société est en voie d’opérer des changements majeurs dont nous ignorons encore quelles seront les conséquences. « Les outils qu’une société se donne, souligne Jean-Claude Dussault, ne sont pas sans relation avec l’état même de cette société et ne sont pas sans avoir une influence directe sur le comportement des individus qui la composent. »
La création d’un nouveau paradigme
Comme il sied à tout bon enquêteur, Jean-Claude Dussault délimite d’emblée l’objet de son enquête et inventorie les moyens dont il dispose pour la mener à bien. Le mot virtuel, nous rappelle-t-il, a un double sens philosophique : est virtuel ce qui existe à l’état de puissance active ; est également considéré comme virtuel ce qui n’existe qu’à l’état d’ébauche. L’auteur recourt aux deux éléments de cette définition pour appuyer sa thèse, à savoir qu’ils permettent de circonscrire la nature de l’homme. Nous existons bel et bien à l’état de puissance active et nous ne cessons, du moins la plus grande partie de notre vie, de nous transformer, que ce soit au contact des autres, de leurs influences, ou des multiples expériences qui jalonnent notre cheminement. Ainsi sommes-nous constamment des ébauches de nous-mêmes, ni tout à fait les mêmes ni tout à fait différents. En cela, souligne Jean-Claude Dussault, nous sommes bel et bien des êtres virtuels.
De tout temps, notre condition nous est apparue limitée ; de tout temps, nous avons tenté d’y échapper. L’une des fonctions primordiales des modes de pensée ancestraux consistait justement à permettre à la fois de tendre nos pensées, comme on tend un arc en vue d’atteindre une cible au loin, vers ce qui se révélait le plus souvent inexplicable, et d’y opérer parfois une plongée vertigineuse. Ces élans procuraient à cette part de notre être qui nous échappe, et que la culture occidentale appelle tantôt âme, tantôt conscience, la pérennité, l’immortalité si souvent dénoncée, mais non moins ardemment recherchée. À ce propos, Jean-Claude Dussault rappelle le rôle et la fonction assumés de tout temps par les modes de pensée philosophiques et religieux qui encadraient nos vies. Porteurs de sens, au même titre que les archétypes propres à toute société, comme nous l’ont révélé les travaux de Jung, ces modes de pensée avaient non seulement pour fonction de donner un sens, une direction à nos existences, mais peut-être encore davantage de permettre une ouverture sur une réalité autre, une réalité qui échappe aux modes de perception habituels. De la même façon, le rêve permet au rêveur d’accéder à une autre dimension de son existence, et ce, même si cette dimension lui demeure inaccessible à l’état de veille. Elle n’en est pas moins réelle, comme ces pensées que nous écartons et qui, avant d’être reléguées à l’oubli, occupaient notre esprit.
En dépouillant le ciel et les êtres qui l’habitaient de leur caractère sacré, en refusant surtout à ces modes de pensée traditionnels non pas tant le pouvoir que nous leur accordions que celui qu’ils mettaient à notre portée, nous nous sommes interdit l’utilisation d’autant de leviers qui nous donnaient accès à des paliers de connaissance aujourd’hui considérés suspects. En d’autres mots, tout ce qui avait jusque-là eu pour fonction de renseigner l’homme sur la complexité de sa nature, autant que sur celle de l’univers qui est le sien, était jugé caduc sans autre forme de procès. La culture occidentale, rappelle à cet égard Jean-Claude Dussault, a toujours tendu vers une vision linéaire de la réalité. Toute connaissance accessible par une voie autre ne l’est pas pour nous, son accès a été banni. Et c’est justement le vide occupé autrefois par la représentation du sacré que tend aujourd’hui à investir les manifestations que nous englobons dans le concept de réalité virtuelle. Que ce soit par le biais de jeux électroniques de plus en plus sophistiqués qui propulsent le joueur dans des dimensions spatio-temporelles inimaginables il y a quelques années, par le biais de ces nouveaux outils de travail qui nous permettent de communiquer à distance avec des interlocuteurs inconnus l’instant d’avant, de nous déplacer virtuellement pour accéder aux richesses des plus grandes bibliothèques du monde, aux chefs-d’œuvre des plus grands musées, ou d’être auscultés par un spécialiste qui se trouve au même moment à des milliers de kilomètres, notre mode de perception et d’appréhension du monde est en pleine expansion. Mais le monde n’est-il pas, par définition, en constante expansion ? On croirait nager en pleine science-fiction, mais ce n’en est pas moins le monde dans lequel nous vivons.
La vision du monde qui émane aujourd’hui des fulgurantes applications technologiques par lesquelles se crée un nouveau paradigme n’a d’autre fonction que d’élargir le sens que nous donnons à nos existences, de repousser les frontières du réel en créant de nouveaux espaces, de la même manière que le faisaient les modes de pensée ancestraux en définissant des lieux qui repoussent les limites de nos existences terrestres.
Nous sommes orphelins de sens
Par delà les multiples réalisations et exploits technologiques dont nous nous enorgueillissons en cette fin de siècle, la quête effrénée de la réalité virtuelle qui en est l’épiphénomène met à nu le vide de nos existences. Si, comme le souligne Jean-Claude Dussault, nous avons déboulonné les statues autrefois érigées aux dieux qui veillaient sur nos destinées pour permettre à l’individu de donner sa pleine mesure, que penser du sort aujourd’hui réservé à ce même individu dans la plupart de nos sociétés ? Les bulletins d’information nous confrontent quotidiennement à une troublante réalité : guerres, viols, torture, commerce d’enfants à des fins pornographiques ne cessent de donner raison à ce personnage de Dostoïevski qui clamait : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis ! »
Heureusement, l’enquête métaphysique menée par Jean-Claude Dussault se conclut sur une note plus réjouissante. L’essayiste cherche en effet à démontrer que nous sommes potentiellement des êtres lumineux et multiples, qu’il nous appartient en quelque sorte de nous réaliser pleinement ou non. Les récentes découvertes de la physique quantique ne cessent de nous démontrer que nous ne savons rien de notre propre univers, que les frontières que nous avons érigées, et que nous défendons avec tant d’ardeur, sont tout au plus des bornes superficielles qui n’ont d’autre fonction que d’atténuer le vertige que nous ne manquerions pas d’éprouver sans elles. « Nous campons au seuil d’un monde de possibilités qui nous échappent », nous rappelle constamment Jean-Claude Dussault.
À l’aube d’un nouveau millénaire, nous revoici devant l’absolu de notre propre condition. Magnifiquement, l’essai de Jean-Claude Dussault vient nous rappeler, à l’image du Tangram, ce jeu millénaire de formes chinois, que la réalité virtuelle prend sa source dans l’imagination créatrice. Là réside sans doute le seul pouvoir qui nous soit dévolu, le seul véritable sens que nous puissions espérer tirer de notre existence. À ce jeu, il n’y a ni vainqueurs ni vaincus.
*Voir à ce sujet la trilogie qu’il a publiée sous les titres de : Pour une civilisation du plaisir, Le corps vêtu de mots et Au commencement était la tristesse.
Jean-Claude Dussault a publié :
Proses (suites lyriques), Orphée, 1955 ; Le jeu des brises, Orphée, 1956 ; Dialogues platoniques, Orphée, 1956 ; Sentences d’amour et d’ivresse, Orphée, 1958 ; Essai sur l’hindouisme, Quinze, 1965 et 1980 ; Pour une civilisation du plaisir, Le Jour, 1968 et Quinze, 1980 ; Le corps vêtu de mots, Le Jour, 1972 et Quinze, 1980 ; Éloge et procès de l’art moderne, en collaboration avec Gilles Toupin, VLB, 1979 ; Le I Ching, en collaboration avec Jean Maillé, Libre Expression, 1982 ; Journal de Chine, La Presse, 1986 ; L’Inde vivante, l’Hexagone, 1990 ; Au commencement était la tristesse (réédition de L’orbe du désir, Quinze, 1976), « Typo », l’Hexagone, 1991 ; Correspondance Gauvreau-Dussault 1949-1950, l’Hexagone, 1993 ; L’effet Nintendo, Une enquête métaphysique sur la réalité virtuelle, l’Hexagone, 1997.