Avec le déchiffrage du génome humain complété en 2000, on a pratiquement mis au jour le script de la vie elle-même, avec pour corollaire le pouvoir pour l’être humain d’en modifier les instructions. Il a fallu bien des efforts et bien des tâtonnements avant d’en arriver là, nous rappelle Siddhartha Mukherjee dans son brillantissime essai, Il était une fois le gène. Percer le secret de la vie1. Malgré les immenses avancées qu’elles laissent entrevoir, l’auteur montre que ces percées ne vont pas sans causer aussi de grandes inquiétudes.
De la théorie du spermisme de Pythagore, au VIesiècle av. J.-C., jusqu’à celle des homoncules de Paracelse (1493-1541), en passant par Galien (IIesiècle) et sa théorie de la symétrie inversée des organes reproducteurs mâles et femelles, il a fallu des siècles de tâtonnements avant que Darwin ne mette au point sa théorie sur l’évolution des espèces publiée en 1859. À la stupeur du monde scientifique de l’époque, le naturaliste et paléontologue anglais y avançait que toutes les formes de vie avaient évolué à partir de spécimens primitifs dont beaucoup avaient disparu depuis. Sa théorie affirmait, pour la première fois, que la vie est un processus évolutif et non une forme fixée une fois pour toutes. Et cette évolution est régie par les lois de la sélection naturelle qui veut que, dans le combat perpétuel pour s’accaparer les ressources nécessaires à leur survie, seuls survivent les individus les mieux adaptés à leur environnement. Mais par quel mécanisme et sur quels supports pouvait bien se faire cette évolution ?
C’est à Gregor Mendel (1822-1884), un modeste clerc d’origine silésienne, que l’histoire attribue le mérite d’avoir « découvert » la génétique. En effectuant une multitude de croisements sur des plants de petits pois et en notant sur plusieurs générations les variations de certaines caractéristiques (taille, couleur, positionnement des fleurs, etc.), il observa l’apparition et la disparition alternées de certaines d’entre elles. Il en déduisit que ces changements étaient portés par des unités biologiques qu’il classa en « dominants » et en « récessifs », selon la probabilité de leur apparition dans une génération donnée. Ses travaux, publiés en 1866, tombèrent dans l’indifférence générale et ne trouvèrent leur plein écho dans le monde de la recherche biologique que 30 ans plus tard.
Améliorer la race
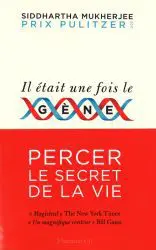 En effet, la fin du XIXesiècle et le début du XXevirent se déclencher des débats passionnés sur les conclusions sociologiques, politiques et culturelles qu’on pouvait tirer de la théorie de Darwin. Si la théorie darwinienne était exacte, disait-on, une sélection faite par l’homme sur des bases rationnelles ne serait-elle pas préférable à une sélection faite par une nature aveugle ? Ce fut la naissance des courants eugéniques qui plaidaient pour une amélioration du patrimoine génétique humain en rendant plus difficile ou même impossible la reproduction de ses membres les plus « faibles » : simples d’esprit, infirmes, criminels, alcooliques, homosexuels, etc.
En effet, la fin du XIXesiècle et le début du XXevirent se déclencher des débats passionnés sur les conclusions sociologiques, politiques et culturelles qu’on pouvait tirer de la théorie de Darwin. Si la théorie darwinienne était exacte, disait-on, une sélection faite par l’homme sur des bases rationnelles ne serait-elle pas préférable à une sélection faite par une nature aveugle ? Ce fut la naissance des courants eugéniques qui plaidaient pour une amélioration du patrimoine génétique humain en rendant plus difficile ou même impossible la reproduction de ses membres les plus « faibles » : simples d’esprit, infirmes, criminels, alcooliques, homosexuels, etc.
Dès lors, cette quête pour améliorer la race humaine grâce à la génétique allait donner naissance à des interprétations diverses qui ont nourri aussi bien les délires des politiques raciales de l’Allemagne des années 1930 que les délires, en URSS, d’une science communiste pour qui « les gènes étaient un mirage inventé par la bourgeoisie pour souligner la fixité des différences individuelles […]. Les cerveaux, pas les gènes, devaient être lavés ». À la fin des années 1920, l’agronome Lyssenko prétendit même pouvoir améliorer les rendements des récoltes en reconditionnant les semences par un traitement choc, entre autres par l’exposition de semences de blé à des froids extrêmes pour en accroître la résistance. Toute cette pseudo-science ne fut pas tout à fait inutile. Par exemple, l’eugénisme allemand a permis d’améliorer les méthodes de recherche en génétique en faisant apparaître l’utilité des études sur les jumeaux. Autre bénéfice – indirect celui-là – des politiques raciales nazies, l’exode massif des cerveaux allemands qui « allaient finir par redessiner le paysage scientifique du nouveau continent où ils abordaient ».
L’année 1953 allait marquer un tournant dans la recherche sur l’hérédité. C’est cette année-là que l’Américain James Watson et l’Anglais Francis Crick mirent au jour la fameuse double structure hélicoïdale de l’ADN. On pouvait enfin « voir » le support matériel sur lequel était inscrit le script de la vie. Partant, il était possible d’espérer en comprendre mieux le mécanisme de liaison avec les cellules. Ainsi, en comparant l’ADN de personnes saines avec l’ADN de personnes malades, on a pu établir des liens entre certaines variations génétiques et certaines maladies comme l’anémie falciforme, la trisomie 21 ou la mucoviscidose (fibrose kystique). Dès lors, la chasse aux maladies génétiques était ouverte. Chacun espérait qu’une fois identifié le gène responsable de la maladie, on pourrait agir sur lui pour neutraliser ses effets. Malheureusement, ce ne fut pas si simple.
Apprendre à lire le livre de la vie
On s’est vite rendu compte, en effet, que la plupart des maladies génétiques étaient non pas attribuables au mauvais fonctionnement d’un seul gène, mais impliquait un ensemble de gènes ainsi que leur positionnement sur les chromosomes. Autre surprise, on découvrit que les gènes ne se présentent pas en séquence continue sur le brin d’ADN et que tous les gènes ne sont pas « égaux » entre eux, certains contrôlant l’activation de certains autres. Pour ajouter encore à la complexité du sujet, les chercheurs découvriront, plus tard, que les gènes peuvent garder le « souvenir » de stress environnementaux vécus par les générations précédentes. Par exemple, une grave famine subie par une génération pourra avoir des effets sur le génome de ses descendants, en augmentant chez eux l’occurrence de l’obésité. C’est ce qu’on appelle l’épigénétique.
Devant tant de surprises, la communauté de scientifiques qui s’intéressaient à la question arriva à la conclusion que si l’on voulait envisager une application clinique des connaissances génétiques, il fallait en priorité établir la carte complète du génome humain. Prévu pour s’étirer sur des dizaines d’années, contre toute attente, le déchiffrage du génome humain fut complété en 2000. Résultat : le génome humain est composé de 3 088 286 401 lettres (un peu plus ou un peu moins), de quatre sortes seulement : A (adénine), T (thymine), C (cytosine) et G (guanine). Publié dans la taille de caractère que vous lisez actuellement, il ferait 66 fois la longueur de l’Encyclopædia Britannica et compterait 23 volumes. Chaque cellule du corps humain en possède un exemplaire complet. Nous pourrions dire, métaphoriquement du moins, que l’on possède actuellement la recette pour fabriquer un être humain. Mais pour tirer durablement profit de la génomique, il faut apprendre à lire ce « livre du vivant » et à comprendre les interrelations qu’entretiennent entre eux nos 23 000 gènes. Nous avons peut-être la recette de la vie, mais il y a encore beaucoup de mystères à percer avant que les ingrédients ne donnent naissance à un nouveau Golem, Frankenstein ou Superman.
Une boîte de Pandore ?
Siddhartha Mukherjee est un oncologue américain d’origine indienne, rendu célèbre par la publication en 2010 de L’empereur de toutes les maladies. Une biographie du cancer, qui lui a valu le prix Pulitzer de l’essai et une renommée mondiale après que le magazine Time l’a sélectionné parmi les 100 livres les plus importants parus depuis 1923. Son dernier ouvrage ne risque pas de faire ombrage à sa réputation d’exceptionnel vulgarisateur.Son essai se lit comme le passionnant compte rendu de la quête menée depuis des siècles par une cohorte de chimistes, de biologistes, de médecins, d’alchimistes, pour mettre la main sur le Saint Graal de la vie. Avec méticulosité, exhaustivité et un grand souci d’exactitude (toutes ses avancées, toutes ses données sont référencées), Mukherjee en rappelle les principales étapes, en présente les acteurs en rendant à chacun son dû.
Bien qu’éminemment lisible, ce livre de vulgarisation scientifique comporte certains chapitres qui demanderont au lecteur une attention plus grande. Mais jamais ce lecteur ne se sentira largué par le scientifique. Pour faire passer son contenu, l’auteur évite autant que possible de recourir à des notions scientifiques trop pointues, préférant recourir à l’image, à la métaphore. En outre, pour pallier la sécheresse de son sujet, il s’efforce de garder constamment une épaisseur humaine dans son propos en puisant à même son expérience professionnelle et parfois personnelle.
Il était une fois le gène. Percer le secret de la vie est un livre incontournable pour tout esprit curieux qui s’intéresse aux enjeux scientifiques de son époque. En outre, les possibilités que laisse entrevoir la maîtrise de la génomique sont vertigineuses. Nous sommes probablement à l’aube d’une époque qui n’a jamais connu son équivalent dans l’Histoire. Aurons-nous la sagesse de choisir entre toutes les voies qui s’ouvrent à l’humanité celles qui seront bénéfiques pour l’espèce ? Siddhartha Mukherjee écrit à la toute fin de son ouvrage : « Ce que nous allons en faire [de notre génome] pourrait être le test ultime de la connaissance et du discernement de notre espèce ». Espérons, avec lui, qu’en perçant le secret du vivant, nous n’avons pas ouvert une boîte de Pandore.
1. Siddhartha Mukherjee, Il était une fois le gène. Percer le secret de la vie, trad. de l’américain par Pierre Kaldy, Flammarion, Paris, 2017, 660 p. ; 39,95 $.
EXTRAITS
Le spermisme de Pythagore
Pythagore […] était à l’origine de l’une des théories les plus anciennes et les plus admises sur la similitude entre parents et enfants. Le cœur de cette théorie était que l’information héréditaire […] est portée par le sperme du mâle. Ce dernier recueillerait les instructions en circulant partout dans le corps humain pour s’imprégner des vapeurs mystiques de chaque partie du corps, les yeux informant sur leur couleur, la peau sur sa texture, les os sur leur longueur, et ainsi de suite […]. Cette théorie fut finalement appelée spermisme.
p. 35
Le caractère aussi
Le genre. La préférence sexuelle. Le tempérament. La personnalité. L’impétuosité. L’anxiété. Le choix. Un à un, les domaines les plus subtils de la vie humaine se trouvent progressivement cernés par les gènes. Des aspects du comportement qui étaient largement attribués à la culture, au choix, à l’environnement ou à une construction unique du soi se sont avérés, avec surprise, être influencés par les gènes.
p. 471
L’ADN recombinant
L’ADN recombinant avait fait passer la génétique du domaine de la science dans celui de la technologie. Les gènes n’étaient plus des abstractions. Ils pouvaient être libérés du génome des organismes où ils avaient été prisonniers pendant une éternité, transportés entre les espèces, amplifiés, purifiés, agrandis, raccourcis, modifiés, combinés, mutés, réarrangés, coupés, collés, édités […]. Ils n’étaient plus simplement des objets d’étude mais des instruments d’étude.
p. 290
Comment ça marche
Entre la fin des années 1950 et celle des années 1970 […], ce fut la physiologie du gène qui a dominé la recherche scientifique. Comprendre comment les gènes peuvent être régulés, c’est-à-dire activés ou réprimés par des signaux précis, a dévoilé la façon dont il agissent dans le temps et l’espace pour spécifier les priorités uniques à chaque cellule de l’organisme. Comprendre que les gènes peuvent être reproduits, recombinés entre chromosomes et réparés par des protéines spécifiques a permis d’expliquer comment cellules et organismes arrivent à conserver, copier et rebattre les cartes de l’information génétique à travers les générations.
p. 239











