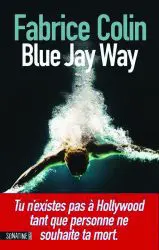Décidément, on ne sort jamais déçu de la lecture d’un roman paru chez Sonatine. Et ce n’est pas Blue Jay Way1 qui trahira cette impression plus que favorable. Pourtant, c’est bien connu, tant d’écrivains français se sont cassé les dents à tenter d’écrire ze roman américain.
Le Français Fabrice Colin, ici plus proche parent de Brett Easton Ellis ou de James Ellroy que d’une Fred Vargas, arrive avec une maestria étonnante à échafauder un scénario trompe-l’œil tordu dont semblent avoir le secret des cinéastes du calibre de David Mamet ou Christopher Nolan. Colin conçoit une trame complexe, que peut éclairer un intertexte subtil mais signifiant (Rosemary’s Baby, Lost Highway).
Julien est un Franco-Américain ayant achevé ses études littéraires à l’Université McGill. Vivant désormais à New York, il caresse le projet de produire une étude sur la célèbre auteure Carolyn Gerritsen, avec qui il arrive à établir une relation de confiance. À tel point qu’il en vient à accepter de se rendre à Beverly Hills dans la somptueuse demeure de Blue Jay Way qui appartient à son ex, le richissime producteur Larry Gordon, pour veiller à son insu sur leur fils Ryan, une tête brûlée sans foi ni loi. Julien est donc parachuté dans la ville qui n’a d’angélique que le nom. Los Angeles, théâtre de la déchéance de notre modernité païenne, se déploie en Jardin des délices de nos fantasmes apocalyptiques les plus débridés. Étant donné que Julien entretient depuis quelque temps une liaison secrète avec Ashley Moss, la nouvelle femme du patron Larry, il est plongé dans la plus embarrassante des situations lorsque celle-ci disparaît mystérieusement. Julien doit alors vivre avec la perspective très inconfortable de voir découvert le pot aux roses et le risque d’être du coup placé au sommet de la courte liste des suspects potentiels.
Plus tout à fait français mais pas vraiment californien non plus, Julien appartient à une race d’exclus, aussi exilé entre deux cultures qu’étranger de plus en plus par rapport à lui-même. Cette perte de repères absolue semble en faire le candidat idéal pour les esprits machiavéliques, desquels on sent vite qu’il devient le jouet, le pantin désarticulé.
Parallèlement, par le procédé de plus en plus répandu de l’alternance des points de vue narratifs d’un chapitre à l’autre, on suit les destins de deux autres personnages. D’abord Jacob, qui souffre de schizophrénie, mais surtout Scott, un enfant sadique et fin manipulateur dans la pure lignée des Hannibal Lecter ou Thomas Bishop. Les descriptions crues de ses sombres exploits sont rapportées avec moult dégoûtants détails explicites (l’âpre rigueur d’un Shane Stevens est alors convoquée et le résultat s’avère positivement noir). Au fil de ces pages faisant office de genèse d’un psychopathe, Scott sème dès l’âge de quatre ou cinq ans les carnages et collectionne les histoires sordides, explorant le mal et ses effets jusqu’à devenir ultimement, adulte, un redoutable tortionnaire manipulateur.
Des personnages forts évoluent ainsi dans une étourdissante spirale destructrice qui nous aspire pantois vers les bas-fonds, au fur et à mesure que la tension, hypnotique, devient plus aiguë. Plus encore que la simple atmosphère trouble de la villa de Blue Jay Way, la construction de l’intrigue et la dynamique actantielle servent de prétexte aux suppositions les plus paranoïaques. Plongé dans la confuse duplicité hollywoodienne, le naïf Julien ne sait plus démêler le vrai du faux, dans cette Amérique désespérée où réalité et fiction s’entremêlent. « Et le vent qui soufflait sur L. A. ressemblait de plus en plus à l’haleine du diable. » Dans une cité décadente aux allures de nouvelle Olympe avec ses acteurs demi-dieux, Colin dépeint le portrait inquiétant d’une Amérique narcissique qui provoque sa propre perte. Englué parmi cette bande d’hédonistes, Julien finit par se fondre dans ce groupe de glandeurs qui fraient avec les grands noms de la culture pop contemporaine, de James Ellroy, qui fait le chien dans une fête hors de contrôle, à Jack Nicholson, qui vomit triomphalement sur une table de billard. Le contexte cool et chic est alors favorable à ce que le récit soit çà et là ponctué d’aphorismes provocateurs à la Oscar Wilde.
S’il s’attarde parfois sur des événements marginaux de manière plus ou moins heureuse, Blue Jay Way évite néanmoins l’écueil de l’éparpillement attendu au départ en s’abreuvant à une seule source agitée : Colin puise son eau corrompue dans la noirceur même de ce que pourraient être les marécageux rêves d’anéantissement de David Lynch. Voilà un roman qui se démarque des thrillers bon marché grâce notamment à la richesse et à la précision chirurgicale de la langue de Fabrice Colin. De toute urgence à mettre sur le rayon des valeurs sûres, tout à côté de vos polars ambitieux favoris. Malgré ses irritants somme toute mineurs (propension au name-dropping, portrait peu crédible du FBI), Blue Jay Way se classe certainement parmi les plus aboutis des romans noirs contemporains écrits dans notre langue.
1. Fabrice Colin, Blue Jay Way, Sonatine, Paris, 2012, 480 p. ; 37,95 $.