Poète, romancier, nouvelliste, essayiste, chroniqueur, traducteur, Francis de Miomandre (1880-1959) laisse à sa mort une production abondante, multiple, que l’on a trop tendance à réduire à un titre – Écrit sur de l’eau, prix Goncourt 1908 – et à une forme d’aimable fantaisie. C’est méconnaître tout un pan secret de son œuvre de fiction – des livres plus tardifs, plutôt marqués du sceau du merveilleux et de l’onirisme où Miomandre, à l’instar parfois de son ami Jean Cassou, flirte avec le surréalisme.
Prix Goncourt 1908
Lorsque Miomandre (de son vrai nom Francis-Félicien Durand1), quatre ans après Les hôtes inconnus (scènes de la vie réelles), publie, en juin 1908, son second roman, Écrit sur de l’eau, il est loin d’imaginer obtenir quelques mois plus tard le prix Goncourt. Son profil littéraire ne semble
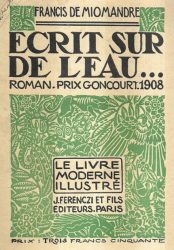
d’ailleurs pas l’y prédisposer. Admirateur de Rimbaud, de Jules Laforgue et de Stéphane Mallarmé, secrétaire de Camille Mauclair, familier du Mercure de France et des petites revues symbolistes comme L’Ermitage, Francis de Miomandre s’enthousiasme volontiers, dans ses articles rassemblés dans Visages (1907), pour Marcel Schwob, Rachilde, Remy de Gourmont, Paul Claudel… Des goûts, on le voit, sensiblement éloignés de l’héritage naturaliste dont se réclame l’académie Goncourt. On pourrait d’ailleurs en dire de même d’Écrit sur de l’eau, roman sur lequel plane davantage l’esprit de Laforgue ou de Jean de Tinan que le souvenir des auteurs de Germinie Lacerteux. Rendant compte, dans La Nouvelle Revue française de mars 1909, de ce livre « léger comme une bulle » et « charmant » – un livre de « fantaisiste2 »… – André Gide ne peut s’empêcher de marquer sa perplexité : « pourquoi [ces Messieurs de l’académie Goncourt] ont donné leur prix à Écrit sur de l’eau… c’est ce que l’auteur se demande sans doute comme nous3 ».
On aurait tort cependant de voir dans ce roman que Miomandre nous annonce « bizarre comme un rêve4 », une œuvre qui bouleverse radicalement les 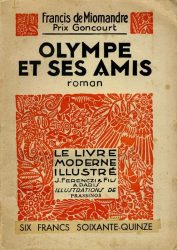 conventions du réel. Réduit à son anecdote, Écrit sur de l’eau nous conte, dans le Marseille du tournant du XXe siècle, les débuts de la vie sentimentale de Jacques de Meillan, jeune homme rêveur qui verra peu à peu tomber ses illusions amoureuses. Partant de ces données somme toute banales, réalistes, l’écrivain n’en construit pas moins un livre singulier, passablement étrange, qui brille notamment par son écriture souple, fluide, musicale ; par le ton désinvolte du narrateur, tout empreint d’ironie et de tendresse, et qui nous vaut quelques pages d’une grande drôlerie ; par l’allure primesautière du récit, qui ne se prive d’aucune digression, l’auteur se permettant même d’insérer au mitan de son roman un intermède qui, nous prévient Miomandre dans une note, « n’a aucun rapport avec le chapitre précédent, ni non plus d’ailleurs avec le reste de l’action5 ». Plus encore, Écrit sur de l’eau se signale par l’éclairage poétique qui baigne, de manière impalpable, les êtres et les choses, et qui confère au roman une authentique dimension féerique.
conventions du réel. Réduit à son anecdote, Écrit sur de l’eau nous conte, dans le Marseille du tournant du XXe siècle, les débuts de la vie sentimentale de Jacques de Meillan, jeune homme rêveur qui verra peu à peu tomber ses illusions amoureuses. Partant de ces données somme toute banales, réalistes, l’écrivain n’en construit pas moins un livre singulier, passablement étrange, qui brille notamment par son écriture souple, fluide, musicale ; par le ton désinvolte du narrateur, tout empreint d’ironie et de tendresse, et qui nous vaut quelques pages d’une grande drôlerie ; par l’allure primesautière du récit, qui ne se prive d’aucune digression, l’auteur se permettant même d’insérer au mitan de son roman un intermède qui, nous prévient Miomandre dans une note, « n’a aucun rapport avec le chapitre précédent, ni non plus d’ailleurs avec le reste de l’action5 ». Plus encore, Écrit sur de l’eau se signale par l’éclairage poétique qui baigne, de manière impalpable, les êtres et les choses, et qui confère au roman une authentique dimension féerique.
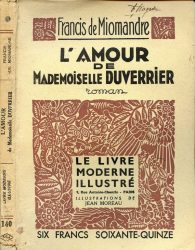
Avec, ainsi qu’a pu l’écrire Alexandre Arnoux, ce « petit chef-d’œuvre d’invention cocasse, aérienne, fait de rayons, d’ironie et de chatoiements6 », Francis de Miomandre pose son univers et impose certaines de ses obsessions. On y voit déjà s’exprimer son goût pour les personnages fantasques et chimériques, son amour des animaux et des objets, sa sensibilité à la présence du merveilleux dans la vie quotidienne… Autant d’éléments que le romancier va reprendre, développer, approfondir dans sa très nombreuse et inégale production ultérieure, sans pour autant s’enfermer dans une formule, s’attachant au contraire, au fil des livres et des décennies, à diversifier son œuvre.
Une fantaisie multifacette
Parmi la soixantaine de romans et recueils de nouvelles publiés par Miomandre, certains suivent, avec plus ou moins d’audace et de liberté, la voie ouverte avec Écrit sur de l’eau – une voie purement fantaisiste, dans laquelle on trouvera des œuvres qui, sans trop s’éloigner du réel et du possible, multiplient les extravagances, plongent des personnages décalés de la vie ordinaire dans un univers de vaudeville, ou mieux encore d’« opérette7 ». Dans cette veine éminemment légère s’inscrivent quelques amusantes réussites comme Le radjah de Mazulipatam (1926) ou Olympe et ses amis (1927) – deux romans qui s’imposent encore au lecteur d’aujourd’hui par l’aisance toute funambulesque avec laquelle Miomandre mène son récit et ses personnages aux portes de l’absurde.
Ailleurs, le romancier saura œuvrer dans un registre plus grave, loin des fictions souriantes et quelque peu frivoles qui ont fait sa renommée. De fait, 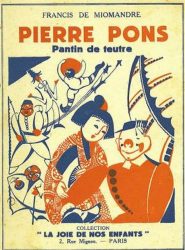 dans des livres comme L’aventure de Thérèse Beauchamps (1913), La naufragée (1924) ou L’amour de mademoiselle Duverrier (1926), l’auteur délaisse quelque peu les excentricités pour s’attacher avant tout à la vérité psychologique de ses personnages, offrant ainsi de mémorables portraits de femmes qui souffrent d’aimer – ou de ne pas aimer. Chez ce Miomandre plus amer, plus « réaliste », la fantaisie, sans tout à fait disparaître, se fait résolument plus discrète ; elle se contente de nimber délicatement certaines scènes, certains êtres. On songe ainsi, dans L’aventure de Thérèse Beauchamps, aux deux énigmatiques Chinois, Loung et Tchéou, qui viennent troubler l’ennui conjugal de l’héroïne, ou bien, dans L’amour de mademoiselle Duverrier – sans doute le roman le plus âpre de Miomandre –, les étranges visions qui hantent Pierre de Salernes durant ses recherches archéologiques en Amérique du Sud.
dans des livres comme L’aventure de Thérèse Beauchamps (1913), La naufragée (1924) ou L’amour de mademoiselle Duverrier (1926), l’auteur délaisse quelque peu les excentricités pour s’attacher avant tout à la vérité psychologique de ses personnages, offrant ainsi de mémorables portraits de femmes qui souffrent d’aimer – ou de ne pas aimer. Chez ce Miomandre plus amer, plus « réaliste », la fantaisie, sans tout à fait disparaître, se fait résolument plus discrète ; elle se contente de nimber délicatement certaines scènes, certains êtres. On songe ainsi, dans L’aventure de Thérèse Beauchamps, aux deux énigmatiques Chinois, Loung et Tchéou, qui viennent troubler l’ennui conjugal de l’héroïne, ou bien, dans L’amour de mademoiselle Duverrier – sans doute le roman le plus âpre de Miomandre –, les étranges visions qui hantent Pierre de Salernes durant ses recherches archéologiques en Amérique du Sud.
Mais sans doute est-ce au contraire en se libérant des contraintes du réalisme pour explorer ouvertement les territoires de la merveille et du rêve, que Miomandre a trouvé sa voie. Celle, tout au moins, qui lui a permis non seulement d’explorer la part la plus intime de son inspiration, mais aussi de donner à lire certaines de ses œuvres les plus abouties. Cette veine de l’imagination pure ne s’imposera dans la  production de Miomandre que de manière très progressive, d’abord timidement, à travers un livre pour enfants (Histoire de Pierre Pons, pantin de feutre, 1912), ou bien par le biais d’œuvres confidentielles, à très faible tirage, comme Contes des cloches de cristal (1925) ou Onésime (1928), puis avec davantage d’assurance à partir des années 1930. Cette décennie débute ainsi avec Vie du sage Prospero (1930), délicieux petit roman merveilleux en forme d’hommage à l’univers féerique de Shakespeare, dans lequel le lecteur croise, dans un XVIIe siècle de fantaisie, non seulement Prospero, mais également Hamlet, Caliban, Ariel… Et même la reine Cléopâtre ! Il faut toutefois attendre Otarie, arabesque amoureuse et marine (1933) et Direction Étoile (1937) pour que Miomandre trouve enfin la formule lui permettant de concilier à la fois ses grandes admirations littéraires (le romantisme allemand8, le symbolisme de sa jeunesse, le surréalisme9) et la richesse de son monde intérieur.
production de Miomandre que de manière très progressive, d’abord timidement, à travers un livre pour enfants (Histoire de Pierre Pons, pantin de feutre, 1912), ou bien par le biais d’œuvres confidentielles, à très faible tirage, comme Contes des cloches de cristal (1925) ou Onésime (1928), puis avec davantage d’assurance à partir des années 1930. Cette décennie débute ainsi avec Vie du sage Prospero (1930), délicieux petit roman merveilleux en forme d’hommage à l’univers féerique de Shakespeare, dans lequel le lecteur croise, dans un XVIIe siècle de fantaisie, non seulement Prospero, mais également Hamlet, Caliban, Ariel… Et même la reine Cléopâtre ! Il faut toutefois attendre Otarie, arabesque amoureuse et marine (1933) et Direction Étoile (1937) pour que Miomandre trouve enfin la formule lui permettant de concilier à la fois ses grandes admirations littéraires (le romantisme allemand8, le symbolisme de sa jeunesse, le surréalisme9) et la richesse de son monde intérieur.
Des rêves éveillés
Dans Otarie, bref roman ou longue nouvelle, Miomandre donne libre cours à son goût des métamorphoses, et nous entraîne, avec son héros-narrateur, à la recherche d’une femme-fée entraperçue un jour, au bord de l’eau, et qui n’est autre que la Reine de la Mer. Pour décor de cette histoire féerique d’un profond lyrisme, Miomandre, se souvenant peut-être de Louis Aragon et de son fameux Paysan de Paris, a choisi Paris – le Paris moderne et trépidant des années 1930, avec ses rues, ses hôtels, ses music-halls, ses taxis… On retrouve un tel cadre dans Direction Étoile, roman dans lequel le métro parisien, de la station Raspail à la station Étoile, permet au héros de vivre, en songe, toute une existence en quelques minutes. À travers ces deux récits, Miomandre donne le ton de ses livres suivants – des livres nés, comme a pu l’écrire Marcel Brion, de la plume d’un « véritable enchanteur », et qui « nous transportent dans un monde de rêve qui n’est, si nous l’examinons bien, que la réalité sous l’angle magique où elle se pare d’une splendeur surréelle10 ».
Pour s’en convaincre, on lira ce qui demeure un des sommets de l’œuvre romanesque de Miomandre – une série de trois recueils de nouvelles oniriques :

Le fil d’Ariane (1941), Fugues (1942) et Portes (1943), que viendra prolonger, un an après la mort de l’auteur, un quatrième ensemble moins homogène, Caprices (1960). Dans le domaine de la fiction brève, notre « enchanteur » excelle à plonger son lecteur dans un univers fantasmatique, quelque peu surréalisant – ce n’est pas un hasard si « Le fil d’Ariane », récit qui ouvre le recueil éponyme, est dédié à André Breton et à Paul Éluard –, dont les merveilles ne sont pas exemptes d’angoisse ou de cruauté. Songeons ainsi à l’atmosphère oppressante qui imprègne « Somnambules dans l’eau », une des plus belles nouvelles de Fugues. Sous les yeux du héros-narrateur, des jeunes filles semblent irrésistiblement attirées par une piscine. Arrivées au fond de l’eau, elles s’allongent et, immobiles, paraissent dormir, à moins qu’elles ne soient mortes. Incapable de résister à leur séduction, le narrateur va, au péril de sa vie, tenter de sauver malgré elles ces belles ensevelies. En vain : le charme se révèle trop puissant, et le héros doit se résoudre à abandonner les jeunes filles à leur sort funeste…
Les nouvelles de Francis de Miomandre baignent volontiers dans un climat de rêve éveillé, où s’estompent les frontières entre réel et merveilleux. Un tel climat est également perceptible dans certains romans tardifs qui comptent parmi les plus convaincants de notre auteur, comme Les jardins de Marguilène (1943), si riche en inventions poétiques, le très nervalien Primevère et l’ange (1945), La conférence (1946), qu’on a pu rapprocher de l’univers de Kafka11, ou encore L’œuf de Colomb (1954). Ce dernier est particulièrement drôle et émouvant : véritable hommage à Barcelone, ce « livre hors du temps », ainsi que le désigne notre auteur12, fait de Christophe Colomb le contemporain aussi bien de l’architecte Gaudí que de Don Juan. Sous la plume de Miomandre, qui a toujours célébré les pouvoirs supérieurs de l’imagination et du songe, Colomb n’est plus le découvreur mais, grâce à l’action d’une drogue magique, le rêveur de l’Amérique.
* Source: gallica.bnf.fr/Bibliothèque nationale de France
1. Pour toute donnée biographique concernant notre auteur, voir le précieux ouvrage de Remi Rousselot, Francis de Miomandre, un Goncourt oublié, La Différence, Paris, 2013.
2. André Gide, « Écrit sur de l’eau par Francis de Miomandre », La Nouvelle Revue française, 1er mars 1909, p. 217.
3. Ibid, p. 218.
4. Francis de Miomandre, Écrit sur de l’eau, Du Feu, Paris, 1908, p. 10.
5. Ibid., p. 111.
6. Alexandre Arnoux, « Cher Francis… », Les Nouvelles littéraires, 6 août 1959, p. 4.
7. Voir Edmond Jaloux, « L’Esprit des Livres », Les Nouvelles littéraires, 29 mars 1924, p. 3.
8. Partie prenante du nouveau romantisme de l’entre-deux-guerres, Miomandre sera un membre assidu du Brambilla-Club, cercle des admirateurs d’Hoffmann et des romantiques allemands mis sur pied par Edmond Jaloux et Jean Cassou en 1925.
9. Voir Remi Rousselot, op. cit., p. 135-136.
10. Marcel Brion, « Rencontre avec Francis de Miomandre », Les Nouvelles littéraires, 13 janvier 1955, p. 1.
11.Jean-Pierre Richard, « La Conférence, par Francis de Miomandre », Fontaine, été 1946, p. 317.
12. Voir Marcel Brion, op. cit., p. 4.
Francis de Miomandre a publié, entre autres :
Romans (choix) : Écrit sur de l’eau, Du Feu, 1908, La Différence, 2013 ; L’aventure de Thérèse Beauchamps, Calmann-Lévy, 1913 ; La naufragée, Ferenczi et Fils, 1924 ; Le radjah de Mazulipatam, Ferenczi et Fils, 1926, Kailash, 1996 ; L’amour de mademoiselle Duverrier, Ferenczi et Fils, 1926 ; Olympe et ses amis, Ferenczi et Fils, 1927 ; Vie du sage Prospero, Plon, 1930 ; Otarie, arabesque amoureuse et marine, Maurice d’Hartoy, 1933 ; Direction Étoile, Plon, 1937 ; Mon caméléon, Albin Michel, 1938, L’Arbre vengeur, 2017 ; Les jardins de Marguilène, L.U.F., 1943 ; Primevère et l’ange, Robert Laffont, 1945 ; La conférence, Le bateau ivre, 1946 ; L’œuf de Colomb, Grasset, 1954.
Nouvelles (choix) : Contes des cloches de cristal, Chez Madame Lesage, 1925 ; Onésime, Manuel Brucker, Pour les amis du docteur Lucien-Graux, 1928 ; Le fil d’Ariane, Édouard Aubanel, 1941 ; Fugues, La Guilde du Livre, 1942 ; Portes, De la Baconnière, 1943 ; Caprices, Gallimard, 1960.
EXTRAITS
[…] au moment où Barbette, saisissant à pleine poignée sa belle chevelure blonde, allait renoncer à son androgyne royauté, il se ravisa et, comme si lui fût venu du ciel un avertissement mystérieux, leva la tête, et ce qu’il aperçut, nous le vîmes tous aussi, mais je crois bien que je fus seul à le comprendre. Un bruit insolite retentit dans les hauteurs, le toit de l’établissement s’écroula, ou plutôt se mit à fondre, comme une nuée – car pas un fragment n’en atteignit nos crânes – et, de l’Empyrée, descendit dans la salle un grand Oiseau, blanc comme le linge, vers lequel l’acrobate leva une main amicale… Alors, il arriva quelque chose de prodigieux, dont on devait longtemps parler dans le dix-septième arrondissement. Barbette, comme soulevé par une aspiration formidable, quitta le sol sans aucun effort, doucement, lentement, comme font les anges quand ils ne sont pas pressés, et les deux bras au-dessus de la tête… Doucement, lentement, jusqu’à ce que, l’Oiseau descendant d’un mouvement inverse et identique, les mains de l’Androgyne eussent rencontré les pattes de la Bête qui, alors, les ayant agrippées de sa forte étreinte et poussant un grand cri de joie, l’emporta dans le ciel. Évidemment pour toujours.
Otarie, arabesque amoureuse et marine, Maurice d’Hartoy, 1933, p. 123-125.
Au premier abord, elle ressemblait à toutes les cariatides de théâtre, c’est-à-dire qu’elle était douée d’un embonpoint flatteur, encore accusé par l’effort nécessaire à l’exercice de sa fonction. Intégralement nue d’ailleurs, avec quelque chose d’emphatique dans l’étalage de ses muscles élégamment fuselés. Pourtant, en l’examinant avec plus de soin, je distinguai, dans l’ensemble de ce personnage, je ne sais quoi de singulier, qui le différenciait des autres cariatides, ses voisines. D’imperceptibles ondulations semblaient parcourir son épiderme de plâtre doré… Ah ! mais ce n’était pas du plâtre !… C’était de la chair, de la chair vivante. La cariatide qui soutenait mon balcon était une femme en chair et en os.
Je ne pus retenir un cri de stupeur.
Ce cri la fit se retourner. Oui, le visage qui regardait les fauteuils d’orchestre se tourna lentement vers moi et… je reconnus Yolande.
– Je n’en puis plus, vous savez, dit-elle. Ce n’est pas un métier pour une femme.
– Ma pauvre amie, en effet, je vous plains ! Vous avez l’air bien fatiguée.
– Je me sens des fourmis dans les jambes, des crampes dans les doigts de pied, et j’ai l’épaule écrasée. Mais, que voulez-vous ? Il n’y avait plus d’autre place quand je suis arrivée. Encore heureuse d’avoir trouvé celle-là ! Seulement, je commence à en avoir, si j’ose dire, plein le dos. Et il était grand temps que vous veniez.
– Qu’entendez-vous par là ?
– Qu’au lieu de me plaindre vous feriez mieux de me relayer.
– Vous relayer ?…
– Oui, vous mettre à ma place.
– Mais je suis en tenue de soirée ! J’ai même l’habit de votre mari.
– Oui, en effet, je le reconnais. Mais il faut le quitter, justement.
– ?…
– Vous ne pouvez pas soutenir un entablement avec un frac. Vous feriez scandale. Tandis que, tout nu, personne ne fera attention à vous…
La conférence, Le bateau ivre, 1946, p. 84-86.









