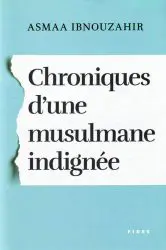Nul doute, Asmaa Ibnouzahir est une jeune femme infatigable, frondeuse et aventureuse. Arrivée au pays en 1994 de son Maroc natal, l’adolescente brillante se fraye un chemin à la force de son énergie vitale, puis occupe plusieurs emplois pour payer ses études universitaires.
Sous apparence de modernité
Amatrice aguerrie de water-polo et de taekwondo, elle rejoint la première équipe de football féminin de Montréal et nous donne à voir une fille bien de son temps qui a même fait profession de foi souverainiste. Musulmane par automatisme, elle participe à des missions humanitaires au Sénégal, au Niger, au Mali qui la guideront vers une intense réflexion spirituelle.
Les Chroniques d’une musulmane indignée1 ne sont pas tant des chroniques reliées à des faits historiques qu’un récit autobiographique dans lequel elle fait une démonstration en bonne et due forme de sa modernité pour nous mener, sans avoir l’air de trop y toucher, dans son labyrinthe d’humeur et d’indignation où le climat devient vite étouffant. Au début de son éveil politique vint la tragédie du 11 septembre 2001, laquelle impose à la jeune adulte l’opinion que « tous les mulsulmans-es seraient donc des fauteurs-trices de trouble » (p. 66). L’injustice de la mort de 3000 personnes semble moins l’inquiéter que « ces accusations gratuites » (p. 67).
En prenant la mesure de l’oppression des femmes, Ibnouzahir tranche : « Les discriminations envers les femmes n’ont pas besoin de la religion pour avoir lieu ». Certes non, mais il n’est qu’à observer les diverses pratiques de l’islam pour voir qu’il en est un puissant vecteur que l’autobiographe masque de sophismes ou d’oublis commodes. On pourrait parler sans jeu de mots de mauvaise foi. Un seul mais tragique exemple. Elle signale qu’en Afrique l’excision est « encore présente dans plusieurs villages » (p. 96). Elle a sciemment ou non omis les récentes données de l’UNICEF (2013), selon lesquelles parmi 29 pays d’Afrique et du Moyen-Orient où se trouvent ces femmes mutilées, âgées de 15 à 49 ans, 18 sont majoritairement ou en presque totalité de confession musulmane. Dans ces « villages », survivent quelque 125 millions de fillettes et de femmes mutilées. Le fait est clair : le taux de prévalence des mutilations génitales est directement proportionnel à la prégnance de l’islam.
Féminisme et islamisme : antinomie insoluble
Au cours du long plaidoyer d’Asmaa Ibnouzahir en faveur d’un féminisme islamique, Lise Payette voit sa plume qualifiée de simpliste (p. 85). Djemila Benhabib n’est animée que par des intérêts propagandistes (p. 170). La verve de Nabila Ben Youssef est discréditée puisque seuls les experts de l’islam ont le droit de s’exprimer (p. 86). Que tous les autres ferment leur… clapet, sous-entendu la majorité des Québécois qui n’y comprennent goutte.
Celle qui prétend « contribuer à dissiper les tensions et les peurs sociales » n’hésite pas à taxer d’hystériques, de paranoïaques ou de pyromanes sociaux (p. 137) de simples citoyens, inquiets à bon droit de l’islamisation de notre société, venus défendre les valeurs de la laïcité devant la commission Bouchard-Taylor. Les accommodements raisonnables passent dans le même broyeur d’idées. À leur origine, ces accommodements avaient pour objectif de favoriser l’égalité des chances, et ils ne visaient que des situations permanentes ou temporaires, mais inchangeables, par exemple un handicap ou une grossesse, ce qu’Ibnouzahir se garde de mentionner. Or la religion n’appartient ni à l’une ni à l’autre de ces catégories, et le but a été perverti par les requêtes harcelantes des communautés religieuses chrétiennes, juives ou musulmanes, et le laxisme des politiques.
Même si son intention était le rapprochement, le ton, la manière et la dialectique d’Ibnouzahir appellent à la division plutôt qu’à l’union des femmes, tout en entretenant une confusion utile entre racisme et islamophobie. Ce serait peu si elle ne nous suggérait pas, dans une improbable logorrhée, de « s’entendre » sur le classement des divers extrémismes islamiques en les nommant littéralistes ou puritains (p. 296), plutôt que wahhabisme, salafisme ou terrorisme. Vous avez bien lu. Ainsi Boko Haram, Daech ou al-Qaïda seraient… puritains !!! Pis, elle boucle sa harangue par un appel passionné au « jihad féministe islamique ». Qui cherche-t-elle à abuser ? Nous ? Elle-même ? Ou les deux ?
Démagogie de l’expert
Au total, ce récit soulève deux questions fondamentales : le temps serait-il venu de recevoir dans l’indifférence absolue le reproche sourd ou avoué de ne pas avoir lu, de préférence dans la langue arabe, le texte fondateur de l’islam (le Coran) et les textes (les hadiths) relatant les paroles du prophète (au nombre de quelque 100 000 authentifiés sur 700 000) pour avoir droit de parole ? Le temps serait-il venu de ne plus céder à la « démagogie de l’expert », car les faits observés et leur horreur s’accusent d’eux-mêmes ? Les simples citoyens comprennent fort bien la signification des massacres de Charlie Hebdo, de Tunis, de Sousse, de Beyrouth, de Paris ou de Bamako perpétrés au nom de l’islam, en 2015 seulement. Il tombe sous le sens que l’amalgame tant reproché entre l’islam et le terrorisme ne vient pas des non-croyants ou des apostats, mais de l’islam lui-même qui s’en réclame à cor et à cri.
La complainte lancinante et la rhétorique spécieuse de ces chroniques n’apportent rien de très nouveau à l’habituel discours mystificateur pour qui s’intéresse de près aux questions remuant notre société en tout sens : accommodements raisonnables, voile musulman, laïcité ou charte des valeurs. À l’opposé, ce récit et ses dédales tatillons exigeront une patience stoïque du lectorat peu averti. Seuls les gens informés mais désireux d’entendre la voix d’une musulmane indignée qui se livre sans complexe y trouveront peut-être leur compte. Je laisse le soin de conclure à Salem Ben Ammar, docteur en sciences politiques, qui porte un jugement lapidaire sur le lien entre le goulag coranique et les femmes : accorder des droits à la femme musulmane revient à mettre à mort l’islam lui-même.
1. Asmaa Ibnouzahir, Chroniques d’une musulmane indignée, Fides, Montréal, 2015, 367 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Depuis 2007, je constate que certains journalistes créent sciemment des controverses à partir de questions totalement hypothétiques, comme c’était le cas du niqab.
P. 132
Mais il faut comprendre que certaines personnes, ayant des connaissances très limitées sur l’islam, malgré leurs origines, aiment tout de même invoquer quelques concepts ici et là – souvent en arabe –, histoire d’acquérir une crédibilité qui leur procure par la suite une réputation d’«experts-es» sur la question.
P. 178
[…] il est important pour celles et ceux qui veulent s’engager dans le mouvement réformiste féministe de connaître les écrits classiques, les méthodologies de recherche en sciences islamiques et tout ce qui peut constituer la base de l’argumentaire des groupes traditionalistes.
P. 361
L’une des déclarations flagrantes émises par Leila Lesbet, par exemple, était que « le voile a été imposé dans les pays musulmans par des assassinats, par le viol, par des violences inouïes à l’égard des femmes ». Une telle affirmation verse autant dans le simplisme que dans la démagogie mensongère.
P. 216