On le sait, il fut une époque où le français était la langue internationale de la diplomatie. Ce qu’on sait moins, c’est qu’elle fut aussi longtemps la lingua franca des relations entre Blancs et Autochtones dans toute l’Amérique du Nord. Aujourd’hui, ben…
C’était au temps où la rivière Yellowstone, dans le Wyoming, s’appelait la rivière Roche jaune. Au temps où les quelques milliers d’habitants de Saint-Louis, au confluent du Mississippi et du Missouri, parlaient français. Au temps où l’Iowa était peuplé de la tribu qu’on appelait les Ayouas.
On ne parle pas ici d’un Régime français lointain ayant disparu avec la Conquête de 1760, mais bien de l’arrière-pays américain du beau milieu du XIXe siècle, une époque où les expéditions pelletières partant de Saint-Louis, sur la frontière occidentale de la civilisation américaine, se passaient en français. Le colonel Régis de Trobriand, au service de l’armée américaine durant la guerre de Sécession, n’en croit pas ses oreilles de Breton : la langue française, dit-il, est « beaucoup plus répandue parmi [les Indiens] dans ces contrées que la langue anglaise ».
Un métissage de longue date
Certes, l’histoire remonte à loin. Dès les premiers voyages de Champlain, un nommé Étienne Brûlé accompagne l’explorateur et ne tarde pas à prendre la poudre d’escampette pour vivre chez les Autochtones, attiré par l’aventure, la liberté… et l’accueil chaleureux des Amérindiennes. Pendant près de trois siècles, les Français puis les Canadiens français sillonneront ainsi les « Pays-d’en-Haut » (pas ceux de Séraphin, ceux des Illinois, des Cris et des Gros-Ventres, autour des Grands Lacs) en redescendant le Mississippi. Ils se mêleront aux Amérindiens, seront littéralement adoptés par eux, feront des affaires avec eux, et y répandront leur langue tout naturellement. Aujourd’hui encore, lorsqu’on ouvre le bottin de la réserve de Fort Berthold, dans le Dakota du Nord, on y trouve en abondance des Beauchamp, des Couture, des Gendreau, des Gingras, des Plante, des Roy… Oh, ils parlent maintenant tous anglais, bien sûr – et jusqu’à récemment, parlaient encore arikara, mandan ou gros-ventre –, mais ils se souviennent de leurs racines françaises et en sont fiers, même s’il n’en reste que des patronymes et des toponymes.
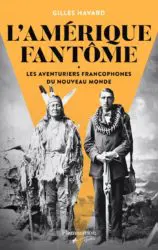 La plupart de ces électrons libres ayant été humbles et analphabètes, ils sont plus ou moins tombés dans l’oubli. Mais on a quand même des traces éloquentes de plusieurs d’entre eux. C’est ainsi l’histoire captivante de neuf coureurs des bois en particulier que raconte l’historien français Gilles Havard dans L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde1, depuis l’énigmatique Pierre Gambie, assassiné en Floride par deux Timucuas pour des raisons obscures en 1565, jusqu’au Montréalais Pierre Beauchamp, qui passera presque toute sa vie chez les Arikaras, dans le Haut-Missouri. Né vers 1809, Beauchamp est loin d’être le seul Canadien français attiré par l’Ouest au XIXe siècle. C’est presque une mode, à l’époque : tout le monde au Bas-Canada a un cousin, un oncle, une connaissance partis pour la grande aventure. « J’ai pris goût de bonne heure à leur vie, raconte-t-il. Courir comme eux les forêts et la prairie, ça m’allait d’instinct, à moi. » Il ajoute : « Les villes, ça ne me va pas. Ça n’est pas dans mon caractère. Je m’y trouve misérable. Aussi je n’y suis pas resté, et je n’y retournerai jamais. Je mourrai où j’ai vécu, dans la prairie ».
La plupart de ces électrons libres ayant été humbles et analphabètes, ils sont plus ou moins tombés dans l’oubli. Mais on a quand même des traces éloquentes de plusieurs d’entre eux. C’est ainsi l’histoire captivante de neuf coureurs des bois en particulier que raconte l’historien français Gilles Havard dans L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde1, depuis l’énigmatique Pierre Gambie, assassiné en Floride par deux Timucuas pour des raisons obscures en 1565, jusqu’au Montréalais Pierre Beauchamp, qui passera presque toute sa vie chez les Arikaras, dans le Haut-Missouri. Né vers 1809, Beauchamp est loin d’être le seul Canadien français attiré par l’Ouest au XIXe siècle. C’est presque une mode, à l’époque : tout le monde au Bas-Canada a un cousin, un oncle, une connaissance partis pour la grande aventure. « J’ai pris goût de bonne heure à leur vie, raconte-t-il. Courir comme eux les forêts et la prairie, ça m’allait d’instinct, à moi. » Il ajoute : « Les villes, ça ne me va pas. Ça n’est pas dans mon caractère. Je m’y trouve misérable. Aussi je n’y suis pas resté, et je n’y retournerai jamais. Je mourrai où j’ai vécu, dans la prairie ».
Les interprètes, médiateurs hybrides
Les Canadiens français « indianisés » sont aussi présents dans les Interprètes au pays du castor2de l’historien canadien de la traduction Jean Delisle, mais celui-ci ratisse plus large, nous racontant l’histoire non seulement des Français Étienne Brûlé (1592-1633), Nicolas Perrot (1644-1717) et Louis-Thomas Chabert de Joncaire (1670-1739) et des Canadiens français Élisabeth Couc (1667-1752) et Jean L’Heureux (1831-1919), mais aussi d’interprètes d’origines autres, et notamment de deux femmes autochtones remarquables : la Chipewyanne Thanadelthur (1697-1717) et l’Inuite Tookoolito (1838-1876).
La galerie de Delisle comporte en fait une bonne quinzaine de personnages qui ont tous eu des destins exceptionnels. Qu’il suffise de citer le cas de John Tanner, fils de pasteur enlevé par des Indiens à une centaine de mètres de la maison familiale, au bord de l’Ohio, en 1789, à l’âge de neuf ans. Adopté par ses ravisseurs – ce qui, dans la culture amérindienne, était généralement le but de ces rapts –, il en viendra à oublier complètement l’anglais, qu’il devra réapprendre pour communiquer avec les membres de sa famille lorsqu’il retrouvera celle-ci… quelque trente ans plus tard. C’est alors seulement, évidemment, qu’il pourra devenir interprète. Mais il sera surtout un homme condamné à vivre entre deux mondes, un peu comme coincé dans des limbes interculturels.
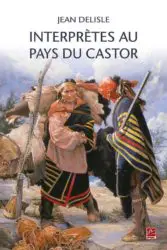 Les interprètes, souligne Delisle, sont d’ailleurs bien plus que de simples truchements. On est loin de la voix anonyme qui traduit hors champ les propos d’un député de la Chambre des communes dans notre téléviseur. Ce sont généralement des gens qui ont épousé une ou des cultures des Premières Nations (notamment en se mariant avec des Indiennes) et qui sauront non seulement traduire les mots des Blancs, mais aussi leur servir de guide sur les particularités culturelles de leurs interlocuteurs, les faux pas à éviter et l’interprétation des gestes, des intentions et des sensibilités. Interpréter entre l’anglais ou le français d’une part et une langue autochtone d’autre part, c’est aussi savoir utiliser les métaphores et autres procédés rhétoriques dont les Amérindiens sont friands et sans lesquels on paraît bien pauvre à leurs yeux. En fait, souvent, les interprètes sont carrément des négociateurs, et Delisle cite de nombreux exemples où des guerres ou des massacres ont été évités grâce à l’intervention d’interprètes capables de prévenir, ou de sauver in extremis, des situations explosives causées par mégarde.
Les interprètes, souligne Delisle, sont d’ailleurs bien plus que de simples truchements. On est loin de la voix anonyme qui traduit hors champ les propos d’un député de la Chambre des communes dans notre téléviseur. Ce sont généralement des gens qui ont épousé une ou des cultures des Premières Nations (notamment en se mariant avec des Indiennes) et qui sauront non seulement traduire les mots des Blancs, mais aussi leur servir de guide sur les particularités culturelles de leurs interlocuteurs, les faux pas à éviter et l’interprétation des gestes, des intentions et des sensibilités. Interpréter entre l’anglais ou le français d’une part et une langue autochtone d’autre part, c’est aussi savoir utiliser les métaphores et autres procédés rhétoriques dont les Amérindiens sont friands et sans lesquels on paraît bien pauvre à leurs yeux. En fait, souvent, les interprètes sont carrément des négociateurs, et Delisle cite de nombreux exemples où des guerres ou des massacres ont été évités grâce à l’intervention d’interprètes capables de prévenir, ou de sauver in extremis, des situations explosives causées par mégarde.
Sans parler des fois où ils sauvent la vie des explorateurs. À ce sujet, le récit de Tookoolito et de son mari Ebierbing partis à la dérive, tenez-vous bien, sur une banquise de deux kilomètres de diamètre détachée du Groenland pour être rescapés par un navire au large de Terre-Neuve deux mille kilomètres plus bas, après plus de six mois en plein hiver (d’octobre 1872 à avril 1873), figure sans doute parmi les plus fabuleux de l’ouvrage. C’est grâce aux habiletés des deux Inuits, qui savent chasser le phoque et construire des igloos, que la vingtaine de naufragés pourra survivre. « En effet, sans Ebierbing, qui sait ce qu’il serait advenu des prisonniers de la banquise. Or, il n’a pas touché la totalité du salaire prévu à son contrat. Il est même l’un de ceux qui ont été le moins rétribués par le gouvernement américain. » Évidemment, le fait qu’il ait été un Autochtone n’a rien à voir…
Par contraste, notons que dans l’Amérique française, les interprètes, absolument essentiels aux échanges commerciaux, savaient vendre leurs services au prix fort. Ce sont parfois les mieux payés d’une expédition… à condition de réussir à passer à la caisse, ce qui n’est pas toujours évident dans un monde de far west.
Épouser sans dominer
Les destins de tous ces coureurs des bois, voyageurs, interprètes et Blancs « ensauvagés » sont si divers qu’on ne saurait les résumer ici en quelques lignes, mais Delisle et Havard nous les racontent avec force détails instructifs sur les us, coutumes et mentalités des Amérindiens et sur un fascinant choc des cultures qui s’atténue au fil des générations pour devenir cohabitation. Et une chose transparaît d’un bout à l’autre : c’est que les Français n’avaient pas avec les Amérindiens les types de rapports qu’ont eus les Espagnols avant et les Anglais ensuite. Certes, quelques préjugés pointent çà et là – et les Amérindiens eux-mêmes n’en sont pas exempts –, mais à la base, ce n’est pas de domination, et encore moins d’extermination, mais bien de commerce, d’ouverture, de vie commune et d’adoption qu’il est question entre les Français, puis les Canadiens français, et les différentes nations amérindiennes, des Montagnais de Charlevoix aux Sioux des Grandes Plaines. Jusqu’à ce que la Destinée manifeste des Américains vienne établir l’hégémonie de ceux-ci et extermine, par le feu ou l’acculturation, aussi bien les Frenchies que les Amérindiens et les Métis. Du côté canadien, l’action britannique ne sera guère plus reluisante.
La peau de chagrin
 Ce qui nous amène au plus prosaïque Deux poids deux langues3 de Serge Dupuis, qui tourne sa loupe plus spécialement vers les relations entre anglophones et francophones dans notre grand pays. Le cadre est certes différent, mais encore une fois, c’est d’un rapport de forces qu’il est question, et il est particulièrement désolant de lire cette description détaillée – et bien documentée – des mille et un aspects par lesquels cette fameuse francophonie, qui dominait jadis non seulement la vallée du Saint-Laurent mais les Pays-d’en-Haut et la Grande Louisiane, finit par s’effriter au sein même d’un pays qui se dit bilingue. Dupuis sait rendre à César ce qui appartient à César : au crédit du Canada anglais, on peut citer de nombreuses initiatives de bonne foi du gouvernement fédéral, et on peut aussi citer l’ouverture de la population canadienne-anglaise dont témoigne l’immense popularité des écoles d’immersion, mais dans l’ensemble, l’histoire des deux communautés linguistiques du Canada, c’est l’histoire de l’érosion de la plus ancienne au profit de la conquérante, que ce soit par volonté délibérée – toutes les provinces sauf le Québec auront, à une époque ou à une autre, interdit ou étouffé l’enseignement en français par exemple – ou par le simple jeu de la démographie, de l’acculturation et du machiavélique multiculturalisme que Trudeau père a su implanter pour infléchir la course du bilinguisme et du biculturalisme qui semblait avoir un avenir prometteur à l’époque de la commission Laurendeau-Dunton, dans les années 1960.
Ce qui nous amène au plus prosaïque Deux poids deux langues3 de Serge Dupuis, qui tourne sa loupe plus spécialement vers les relations entre anglophones et francophones dans notre grand pays. Le cadre est certes différent, mais encore une fois, c’est d’un rapport de forces qu’il est question, et il est particulièrement désolant de lire cette description détaillée – et bien documentée – des mille et un aspects par lesquels cette fameuse francophonie, qui dominait jadis non seulement la vallée du Saint-Laurent mais les Pays-d’en-Haut et la Grande Louisiane, finit par s’effriter au sein même d’un pays qui se dit bilingue. Dupuis sait rendre à César ce qui appartient à César : au crédit du Canada anglais, on peut citer de nombreuses initiatives de bonne foi du gouvernement fédéral, et on peut aussi citer l’ouverture de la population canadienne-anglaise dont témoigne l’immense popularité des écoles d’immersion, mais dans l’ensemble, l’histoire des deux communautés linguistiques du Canada, c’est l’histoire de l’érosion de la plus ancienne au profit de la conquérante, que ce soit par volonté délibérée – toutes les provinces sauf le Québec auront, à une époque ou à une autre, interdit ou étouffé l’enseignement en français par exemple – ou par le simple jeu de la démographie, de l’acculturation et du machiavélique multiculturalisme que Trudeau père a su implanter pour infléchir la course du bilinguisme et du biculturalisme qui semblait avoir un avenir prometteur à l’époque de la commission Laurendeau-Dunton, dans les années 1960.
À la lecture de ces trois ouvrages, on peut comprendre que l’enseignement de l’histoire suscite tant de débats politiques et idéologiques.
1. Gilles Havard, L’Amérique fantôme. Les aventuriers francophones du Nouveau Monde, Flammarion Québec, Montréal, 2019, 653 p. ; 45,95 $.
2. Jean Delisle, Interprètes au pays du castor, Presses de l’Université Laval, Québec, 2019, 354 p. ; 39,95 $.
3. Serge Dupuis, Deux poids deux langues. Brève histoire de la dualité linguistique au Canada, Septentrion, Québec, 2019, 229 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Pour un Canadien de la vallée du Saint-Laurent, la mobilité vers l’Ouest [au XIXe siècle] reste une pratique aussi banale qu’elle l’avait été sous le Régime français.
L’Amérique fantôme, p. 286.
La circulation équestre des trappeurs a des incidences catastrophiques sur la flore et surtout sur la faune, mais ces hommes n’ont ni l’ambition de « civiliser » les Indiens, ni le désir d’usurper leurs terres.
L’Amérique fantôme, p. 436.
L’analyse minutieuse de la contribution des interprètes des deux premières expéditions de Franklin fait ressortir de manière éclatante le rôle déterminant qu’ils ont joué. Une relecture attentive des faits nous amène à conclure que l’on a sous-estimé leur importance et que les vrais héros ne sont pas ceux qu’on pense. Ainsi, sans [son interprète] Matonabbee, qui lui sauve la vie, Samuel Hearne n’aurait pas été le premier Blanc à atteindre l’océan Arctique […].
Interprètes au pays du castor, p. 202.
En Nouvelle-Écosse, la province forme en 1996 un conseil scolaire provincial pour gérer les écoles acadiennes […]. En principe, le ministre accepte la construction de cinq écoles secondaires homogènes de langue française, mais il ne lance aucun chantier après trois ans. En arrivant au pouvoir en juillet 1999, les progressistes-conservateurs annulent ces projets […].
Deux poids deux langues, p. 169.









