Pierre Lemaitre a consacré un roman à la guerre de 1914-1918 du point de vue de ceux qui l’ont livrée. Il s’est abondamment documenté auprès des historiens et des combattants qui ont laissé des traces écrites. L’ouvrage a obtenu le prix Goncourt dont chaque automne les médias ne manquent pas de rappeler les attributions contestables, recouvrant des ententes et des combines devenues secret de Polichinelle. Chaque fois on s’interroge sur la qualité de l’heureux élu et sur celle de la « cuvée ». Et, avec en tête Proust, on dresse la liste de ceux qui ne l’ont pas eu pour la plus grande mauvaise conscience des juges. On se souvient aussi du refus de Julien Gracq, pourfendeur de l’intelligentsia parisienne et de ses rites que constituent les prix annuels. Toutefois, en choisissant Au revoir là-haut1, bon gros roman dans la tradition réaliste, les académiciens ne prenaient pas de risques…
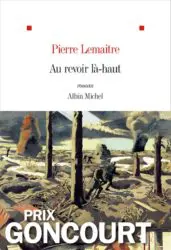 Pourquoi en effet avoir couronné en 2013 cette longue, interminable et macabre histoire d’un racket sur les inhumations et tombes déplacées de poilus ? La vérité historique est prouvée, mais on évolue là complaisamment dans la tuerie et parmi les blessés – l’un des protagonistes devenu l’une de ces horribles « gueules cassées » associé bizarrement pour son projet mortuaire à un soldat qui a failli mourir enseveli dans un trou d’obus (une obsession, semble-t-il, chez l’auteur, parmi d’autres reconnaissables). Le duo et l’intrigue sont complétés par un officier arrogant, cynique, malhonnête, qui n’hésita pas sur le champ de bataille à tirer dans le dos de ses troupes pour créer un vide qui révélerait mieux son « héroïsme ».
Pourquoi en effet avoir couronné en 2013 cette longue, interminable et macabre histoire d’un racket sur les inhumations et tombes déplacées de poilus ? La vérité historique est prouvée, mais on évolue là complaisamment dans la tuerie et parmi les blessés – l’un des protagonistes devenu l’une de ces horribles « gueules cassées » associé bizarrement pour son projet mortuaire à un soldat qui a failli mourir enseveli dans un trou d’obus (une obsession, semble-t-il, chez l’auteur, parmi d’autres reconnaissables). Le duo et l’intrigue sont complétés par un officier arrogant, cynique, malhonnête, qui n’hésita pas sur le champ de bataille à tirer dans le dos de ses troupes pour créer un vide qui révélerait mieux son « héroïsme ».
Beaucoup plus convaincant – et intéressant – est Miroir de nos peines2, qui constitue en quelque sorte un volet complémentaire et symétrique de l’œuvre précédente : après le roman de la Première Guerre, celui de la Seconde. Même épaisseur, même entrelacement des intrigues, même verve narrative, même multiplication des épisodes.
Nous sommes plongés – le mot prend tout son sens – dans la France de 1940 en train de se désintégrer à un rythme accéléré. La guerre est commencée mais on ne la voit pas, elle demeure pendant des mois « la drôle de guerre ». La défense de la fameuse ligne Maginot, qui devait arrêter l’envahisseur, entretient d’abord l’illusion. Un des protagonistes, Gabriel, fait partie de la garnison parmi tous ces soldats qui meurent de routine et d’ennui. Les troupes allemandes vont tout simplement contourner la ligne de défense, traverser la Belgique qu’on croyait un bouclier efficace et les Ardennes réputées infranchissables (ce sont le moment et le lieu où se déroule l’admirable Balcon en forêt de Gracq). L’inexorable s’est produit : l’armée allemande enveloppe les Alliés, les pousse vers la poche de Dunkerque d’où ils tenteront de gagner les côtes anglaises, et progresse vers Paris sans rencontrer de résistance. Cependant, les plus invraisemblables ragots sont inventés par les médias pour nier la réalité. Et quand celle-ci crève les yeux, on trouve une raison à l’humiliation de l’armée française : elle a été trahie par « la cinquième colonne », mythique complot antifrançais. L’inquiétude tourne alors vite à la panique, au sauve-qui-peut chez les populations du Nord, de l’Est, de la région parisienne. Elles sont lâchées sur les routes qui descendent vers le Sud en une indescriptible confusion, dans les souffrances et le désespoir quotidiens. Des soldats perdus cherchent en vain leur unité et leurs chefs qui sont « aux abonnés absents », comme le gouvernement lui-même qui s’est replié (ou a fui) vers Bordeaux. Ou bien ces soldats désertent sans états d’âme, se mélangeant aux civils qui fuient en auto, en carriole, à pied, affamés, affolés, épuisés, traqués par les avions de chasse à croix gammée. C’est la grande débâcle de 1940 que ceux qui l’ont vécue, ou simplement vue, n’ont jamais pu oublier.
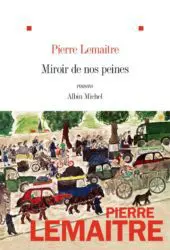 Le roman de Lemaitre, qui aurait pu être allégé d’une intrigue compliquée et parasite – le suicide d’un médecin en présence d’une jeune fille qui en sera traumatisée et dont la fuite traverse le récit –, trouve quelques-unes de ses meilleures pages, enlevées, mordantes, haletantes, dans l’évocation du chaos. Mine d’or, hélas, pour le romancier… Gabriel et son compagnon Raoul, soldats déserteurs, sont eux aussi livrés aux hasards de la route avec des épisodes dramatiques ou cocasses. Apparaissent parmi les personnages d’étonnantes figures. L’une des plus réussies est l’insaisissable Désiré en tous ses avatars : avocat à succès grâce à son culot et à son bagout, puis linguiste ignorant des langues qu’il prétend traduire, chargé de l’information, c’est-à-dire expert en fabrication de fausses nouvelles pour entretenir le moral de la nation, et finalement prêtre ayant créé un centre d’accueil pour les réfugiés. Les différents personnages vont se rejoindre dans ce havre par un miracle soigneusement – et un peu trop bien – orchestré par l’auteur. Ils y trouvent un semblant de paix et la réponse aux questions qu’ils se posaient sur leur passé et leur destin (que Lemaitre, en bon historien, va compléter par une série de notices au-delà de la guerre). Ce Désiré laisse au lecteur un malaise : qui est-il vraiment ? Un mystificateur qui s’éclipse au moment d’être démasqué ? Oui, mais il fait le bien en trompant ceux à qui il le fait, au nom de la charité chrétienne, attentif aux besoins de chacun et jamais à court d’expédients pour y parvenir, adulé et célébré comme un saint. Quand la réalité de son sacerdoce suscite des doutes trop insistants, il se perd une fois de plus dans la nature…
Le roman de Lemaitre, qui aurait pu être allégé d’une intrigue compliquée et parasite – le suicide d’un médecin en présence d’une jeune fille qui en sera traumatisée et dont la fuite traverse le récit –, trouve quelques-unes de ses meilleures pages, enlevées, mordantes, haletantes, dans l’évocation du chaos. Mine d’or, hélas, pour le romancier… Gabriel et son compagnon Raoul, soldats déserteurs, sont eux aussi livrés aux hasards de la route avec des épisodes dramatiques ou cocasses. Apparaissent parmi les personnages d’étonnantes figures. L’une des plus réussies est l’insaisissable Désiré en tous ses avatars : avocat à succès grâce à son culot et à son bagout, puis linguiste ignorant des langues qu’il prétend traduire, chargé de l’information, c’est-à-dire expert en fabrication de fausses nouvelles pour entretenir le moral de la nation, et finalement prêtre ayant créé un centre d’accueil pour les réfugiés. Les différents personnages vont se rejoindre dans ce havre par un miracle soigneusement – et un peu trop bien – orchestré par l’auteur. Ils y trouvent un semblant de paix et la réponse aux questions qu’ils se posaient sur leur passé et leur destin (que Lemaitre, en bon historien, va compléter par une série de notices au-delà de la guerre). Ce Désiré laisse au lecteur un malaise : qui est-il vraiment ? Un mystificateur qui s’éclipse au moment d’être démasqué ? Oui, mais il fait le bien en trompant ceux à qui il le fait, au nom de la charité chrétienne, attentif aux besoins de chacun et jamais à court d’expédients pour y parvenir, adulé et célébré comme un saint. Quand la réalité de son sacerdoce suscite des doutes trop insistants, il se perd une fois de plus dans la nature…
Le roman a une force d’entraînement indéniable avec des accélérations qui, comme dans un bon film d’aventures, laissent le lecteur haletant. Il donne une impression de vie intense, de réalité proche. Sa qualité documentaire est, comme pour Au revoir là-haut, également manifeste, car si Lemaitre invente, reconstitue ce que fut la débâcle, les historiens confirment : « C’est bien ainsi que ça s’est passé ! » La guerre que malgré les évidences on niait, la déroute nationale provoquée par ses responsables politiques et militaires, l’immense panique, le désespoir, l’impuissance, le chacun-pour-soi, la débrouillardise et les gestes de solidarité. Le roman de Lemaitre prend place dans la lignée bien nourrie des récits et documents sur 1940 (l’auteur en cite une vingtaine) qui adoptent des points de vue fort divers mais convergents, que ce soient Les communistes d’Aragon, Un balcon en forêt et les Manuscrits de guerre de Gracq ou Pilote de guerre de Saint-Exupéry. Les collapsologues parlent aujourd’hui d’un effondrement prévisible de notre civilisation, les écrivains nous montrent déjà ce qu’il pourrait être.
1. Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, Albin Michel, Paris, 2013, 566 p. ; 32,95 $.
2. Pierre Lemaitre, Miroir de nos peines, Albin Michel, Paris, 2020, 536 p. ; 34,95 $.











