L’Américain David Treuer est né à Washington en 1970 d’une mère ojibwée et d’un père juif autrichien, émigré aux États-Unis en 1938 pour fuir la montée hitlérienne. L’écrivain est âgé d’à peine six ans lorsque sa mère Margaret Seelye Treuer est nommée juge d’une cour tribale. La famille rejoint alors la tribu Chippawa de la réserve de Leech Lake, au Minnesota, où l’écrivain grandira.
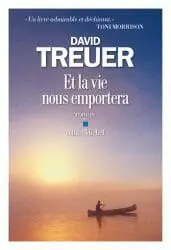 Lors du festival littéraire international Metropolis bleu 2017, David Treuer a reçu à Montréal le Prix littéraire des Premiers peuples pour son roman Et la vie nous emportera. Une dizaine d’années plus tôt, Le manuscrit du Docteur Apelle avait été jugé un des meilleurs livres de l’année par le Washington Post, le Minneapolis Star Tribune et le Time Out Chicago1.
Lors du festival littéraire international Metropolis bleu 2017, David Treuer a reçu à Montréal le Prix littéraire des Premiers peuples pour son roman Et la vie nous emportera. Une dizaine d’années plus tôt, Le manuscrit du Docteur Apelle avait été jugé un des meilleurs livres de l’année par le Washington Post, le Minneapolis Star Tribune et le Time Out Chicago1.
Un littéraire féru de chasse et de pêche
Bien qu’élevés dans une réserve indienne, les enfants Treuer ont toujours eu l’appui de leurs parents pour faire de longues études. Il est vrai que si l’un était auteur et professeur, l’autre a été la première avocate indienne du Minnesota et est juge aujourd’hui. Après avoir fréquenté l’école primaire de la réserve, David Treuer étudie à Bemidji, puis à l’Université de Princeton, où il obtient un baccalauréat ès arts.
En 1994, Treuer termine sa maîtrise en écriture créative sous la direction de Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, et l’année suivante il publie Little, son premier livre. Fort bien reçu de la critique, l’émouvant roman se déroule à Pauvreté, une réserve indienne sans ressources et bien nommée, où plusieurs narrateurs racontent tour à tour leurs versions de la vie et surtout de la mort d’un jeune enfant. « Un récit complexe et puissant, où se mêlent les voix intimes de personnages pleinement aboutis », affirmera Morrison, qui ajoutera : « Treuer révèle l’histoire vraie et réelle des Indiens américains ». L’écrivain entreprend ensuite des études en anthropologie à l’Université du Michigan, où il obtient un doctorat en 1999.
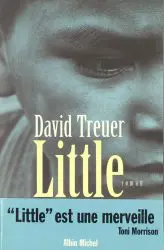 Aujourd’hui, David Treuer partage son temps entre ses obligations de professeur en littérature et en écriture créative à l’Université de Californie du Sud et ses séjours dans la réserve de Leech Lake, où il poursuit son œuvre de romancier. Il y vit avec sa femme Gretchen – de descendance indienne Seneca, de la Confédération iroquoise – et leurs enfants. Tout comme ses quelque 150 cousins, Treuer y pratique la chasse, la pêche, la trappe et la cueillette du riz sauvage, et participe aux cérémonies rituelles.
Aujourd’hui, David Treuer partage son temps entre ses obligations de professeur en littérature et en écriture créative à l’Université de Californie du Sud et ses séjours dans la réserve de Leech Lake, où il poursuit son œuvre de romancier. Il y vit avec sa femme Gretchen – de descendance indienne Seneca, de la Confédération iroquoise – et leurs enfants. Tout comme ses quelque 150 cousins, Treuer y pratique la chasse, la pêche, la trappe et la cueillette du riz sauvage, et participe aux cérémonies rituelles.
Loin de renier son appartenance indienne, David Treuer l’assume sans problème et en parle longuement. Dans toute son œuvre, il plonge ses lecteurs dans cet univers méconnu, à la fois misérable, mystique et plein d’espérance. Fils de juge, le romancier est particulièrement sensible aux droits des Indiens et surtout à leur défense. N’écrit-il pas dans Indian Roads : « Pour la plupart des accusés indiens, pour la plupart des Indiens en général, l’idée que nous puissions avoir des droits est assez récente » ?
Un Ojibwé fier de ses origines
Treuer aime la vie tribale, car il croit à ses vertus pacificatrices. Ses personnages retournent volontiers dans leur réserve natale dans l’espoir de panser leurs plaies, après un séjour souvent éprouvant dans la ville hostile.
David Treuer et son frère aîné Anton se passionnent pour l’histoire, la culture et la langue de leur peuple, même si à Leech Lake à peine 15 % des habitants la parlent. Les Ojibwés appartiennent au grand groupe des Anichinabés ou Anihšināpē, qui comprend en outre les Outaouais et les Algonquins. Présents au Wisconsin et au Minnesota, où ils ont remplacé les Dakotas (Sioux) lorsque ces derniers ont émigré plus à l’ouest, les Ojibwés vivent aussi en Ontario et au Manitoba, où ils sont appelés les Saulteux.
L’écrivain n’hésite pas à dénoncer les conditions de vie misérables des Indiens, autant dans les réserves que dans les tristes banlieues urbaines où, au moment de l’après-guerre, ils avaient été plus ou moins parqués. Abandonnant leurs réserves, désireux de vivre le rêve américain, ils avaient alors aménagé en ville dans des taudis dont le Bureau des affaires indiennes leur avait fait miroiter les avantages. « On est en Amérique, on fait comme les gens d’ici, disait volontiers son père ». À la suite de quoi, « le gouvernement avait oublié les Indiens dans les villes ». Dans Comme un frère, son deuxième roman, Treuer en explore la cruelle décadence, en situant l’action de son récit dans le lugubre quartier Southside de Minneapolis. Comme tant d’Amérindiens, le protagoniste construira des gratte-ciel et sa famille et lui affronteront leur dure et impitoyable destinée.
 En anglais, Comme un frère porte le titre de The Hiawatha, nom d’un train géré par la CMSP&P (Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad), objet de rêve d’un des personnages du livre pour un nouveau départ qui n’aura jamais lieu. Hiawatha est aussi une célèbre légende reconnue de toutes les tribus indiennes d’Amérique du Nord. Le héros mythique – d’origine ojibwée – est au cœur du Chant de Hiawatha du poète Longfellow et de la Symphonie du Nouveau Mondede Dvořák.
En anglais, Comme un frère porte le titre de The Hiawatha, nom d’un train géré par la CMSP&P (Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad), objet de rêve d’un des personnages du livre pour un nouveau départ qui n’aura jamais lieu. Hiawatha est aussi une célèbre légende reconnue de toutes les tribus indiennes d’Amérique du Nord. Le héros mythique – d’origine ojibwée – est au cœur du Chant de Hiawatha du poète Longfellow et de la Symphonie du Nouveau Mondede Dvořák.
Être un Indien au XXIesiècle
David Treuer ne cesse de réfléchir à l’identité, l’identité indienne en premier lieu. Dans Le manuscrit du Docteur Apelle, son troisième roman, dans lequel il raconte une histoire dans une histoire, puisque de symboliques amours indiennes se retrouvent nichées au cœur d’un grand amour contemporain. Le professeur Apelle vit ainsi une liaison amoureuse complexe et torturée avec une autre passionnée de livres, et leur relation gravite autour d’un manuscrit racontant une fabuleuse histoire d’amour entre deux Indiens. Lui, Bimaadiz, élevé par un orignal, et elle, Eta, élevée par une louve, sont les protagonistes de ce qui s’apparente à une légende indienne du XIXesiècle, faite d’enfants trouvés, de valeureux guerriers et de destins contrariés, teintée de spiritualité et d’harmonie avec la nature.
« Oncques l’on ne vit ni ne verra couple et noce plus magnifiques » sont les mots qui bénissent l’union de Bimaadiz et d’Eta. Plus compliquée est la relation entre le professeur Apelle et Campaspe Bello. « Comme tant de belles choses, cette histoire est née de conflits. C’étaient des temps difficiles. […] Entre-temps, le travail m’attend », affirmera le linguiste. L’expert d’une langue étonnamment jamais nommée n’arrivera pas à donner un sens à sa propre histoire, lui qui vit à cheval entre deux cultures et deux langages.
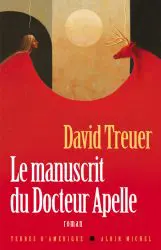 David Treuer poursuit sa quête d’identité en réunissant dans Indian Roads. Un voyage dans l’Amérique indienne autant ses propres souvenirs d’enfance dans la réserve que le résultat de ses recherches et enquêtes journalistiques plus récentes. Il y consigne des faits bruts, donne des informations historiques et fournit des cartes géographiques qui combleront tout lecteur intéressé par l’actualité des quelque 300 réserves américaines. Le livre sera considéré comme un classique par le New York Times, qui en appréciera l’actualité et la pertinence. L’auteur ajoutera en entrevue : « La réserve décrit l’être que je suis et elle demeure le sujet de mes livres ».
David Treuer poursuit sa quête d’identité en réunissant dans Indian Roads. Un voyage dans l’Amérique indienne autant ses propres souvenirs d’enfance dans la réserve que le résultat de ses recherches et enquêtes journalistiques plus récentes. Il y consigne des faits bruts, donne des informations historiques et fournit des cartes géographiques qui combleront tout lecteur intéressé par l’actualité des quelque 300 réserves américaines. Le livre sera considéré comme un classique par le New York Times, qui en appréciera l’actualité et la pertinence. L’auteur ajoutera en entrevue : « La réserve décrit l’être que je suis et elle demeure le sujet de mes livres ».
La ligne conductrice d’Indian Roads est le récit de l’enterrement hors norme du fascinant grand-père ojibwé de l’auteur. Tout en révélant sa biographie avec générosité, David Treuer décrit la réserve de Leech Lake et revient sur l’histoire des réserves établies dès le XVIIIesiècle aux États-Unis et le contexte des 550 tribus qui y habitent aujourd’hui. Tout y passe : l’alcoolisme et la misère endémiques, l’extravagante richesse, le haut taux de suicide, les casinos et les commerces illégaux, le mépris des Blancs et des autres non-autochtones pour les Indiens et les efforts de ces derniers pour garder vivantes langue et culture. On y décèle l’humour, souvent noir, dont use l’écrivain qui pourtant se définit autrement : « Nous sommes drôles. Vraiment. Je dois cependant souligner que je suis parmi les Ojibwés les moins drôles ».
« C’est dans la vie de la réserve qu’on voit, qu’on sent mieux que partout ailleurs le passé donner forme au présent. Sur la réserve, le passé n’est pas si passé que ça », écrira Treuer en guise de conclusion.
Et puis, la Deuxième Guerre mondiale
Avec Et la vie nous emportera, David Treuer fait un retour marqué au roman, dont il situe l’intrigue dans une riche famille blanche du Minnesota, de 1942 à 1952. L’entrée des États-Unis dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale aux côtés des Alliés vient troubler l’ordre établi dans le domaine des Washburn, là où les Indiens ne sont en apparence que serviteurs dévoués et bonnes à tout faire.
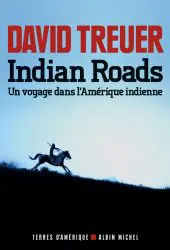 Et pourtant. Les relations entre Blancs et Indiens prennent une tout autre coloration quand une jeune Indienne est tuée par accident, meurtre dont on accusera trop vite Billy, un autre Indien, l’ami et ensuite l’amour coupable de Frankie, le fils de la maison. Malade de culpabilité, ce dernier deviendra aussi l’amant de Prudence, la sœur de la jeune assassinée.
Et pourtant. Les relations entre Blancs et Indiens prennent une tout autre coloration quand une jeune Indienne est tuée par accident, meurtre dont on accusera trop vite Billy, un autre Indien, l’ami et ensuite l’amour coupable de Frankie, le fils de la maison. Malade de culpabilité, ce dernier deviendra aussi l’amant de Prudence, la sœur de la jeune assassinée.
Tout au long du roman, Treuer met l’accent sur la dualité entre courage et lâcheté, entre vérité et mensonge, entre désir et perte, entre races et classes sociales, entre amours licites et celles qui sont impossibles parce qu’inavouables. Entre vie et mort. « Assis droit sur la banquette arrière, les mains sur les genoux, la casquette rasant la garniture du toit, il évoquait aux yeux de tous l’image des Indiens servant d’enseigne aux bureaux de tabac, comme s’il avait été changé en statue de bois. »
1. Les livres de David Treuer ont été publiés en français chez Albin Michel : Little en 1998 ; Comme un frère en 2002 ; Le manuscrit du docteur Apelle en 2007 ; Indian Roads. Un voyage dans l’Amérique indienne en 2014 ; Et la vie nous emportera en 2016.
EXTRAITS
Pendant les mois d’été, les feuilles et l’herbe parvenaient à cacher ce qui ne doit pas être vu. Quand venait la chaleur de ces mois-là, que ce soit les pins ou les taillis, l’herbe ou les plantes sauvages, masquaient les injustices, les frontières sans cesse rétrécies, l’histoire elle-même. Ceci n’était pas possible lorsqu’il neigeait et que tout ce qui a poussé se cache ou meurt. […] Des champs qui avaient fourni du maïs, des betteraves, du soja et des tournesols à des fermiers venus d’Allemagne, de Suède et de Norvège, étaient maintenant envahis par le chiendent.
Little, p. 20.
Après le travail, dans les bars, les ouvriers continuaient à ne pas parler. Faire la conversation, c’était trop difficile. Alors ils gardaient le principe du code. Ils criaient des noms de lieux ou de bâtiments, des dates qui évoquaient des souvenirs. Quebec Bridge, 1907 ! lançait quelqu’un, et les autres hochaient la tête et buvaient. Chosa ! Empire State, 1931 !Il y avait un moment de recueillement. Puis un blagueur criait à pleine voix : Lenny Whitebird, Institut de massage de Sakura, 1969 ! Ils hurlaient tous de rire à se tenir les côtes. La liste des victimes s’étendait à ceux qui avaient attrapé la chaude-pisse.
Comme un frère, p. 100.
Le Dr Apelle se sentait désarmé. Désarmé parce que, comme tous les Indiens, il ne possédait aucun langage pour son être actuel. […] Il a toujours été trop timide pour faire état de ses origines, pour laisser son passé d’Indien parler pour lui et prendre sa place. Son père était pareil. Ils venaient vendre des branches de sapin ou des poissons d’hiver, et quelqu’un se vantait de ses talents de trappeur : La semaine dernière j’ai pris huit visons et un lynx. Le père d’Apelle se disait épaté et il le félicitait. Ce qu’il ne disait pas, c’est que chez eux, ils avaient vingt fourrures de castor tendues et écharnées ainsi que dix loutres clouées sur des planches.
Le manuscrit du Docteur Apelle, p. 262.
Le cercueil est dans la fosse. Le père Paul fait ce que font les catholiques. Les gardiens des couleurs de Leech Lake sont là – des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale, de la Corée, du Vietnam, de la première guerre du Golfe et de l’Afghanistan. Ils saluent et tirent trois salves, et le bruit des coups de feu s’évanouit sur le lac. Mon cousin et moi rassemblons les douilles pour les jeter dans la tombe, puis nous nous armons de nos pelles et nous mettons à la tâche pour recouvrir les restes de mon grand-père. L’enterrement était catholique parce qu’il était catholique. Le sol est indien. Et ceux qui ont creusé la tombe étaient indiens. Et le lac, et la terre qui l’entoure sont les nôtres et sont indiens aussi.
Indian Roads, p. 407.
Mary aurait aimé aller à l’école dans les Plaines, à Flandreau, comme nombre des autres filles, mais ni les missionnaires, ni l’agent des Affaires indiennes, ni le directeur de l’école ne l’auraient acceptée. Quand, petite, elle allait à l’église, le prêtre ne semblait nullement se soucier de son salut. Et pourquoi ? Parce qu’elle avait une jambe plus courte que l’autre ? Parce qu’elle n’était pas jolie ? Quelle sorte de Dieu avait à son service des hommes comme celui-là ? Le pasteur de l’église luthérienne de la Trinité de Deer River, lui, au contraire, avait toujours été presque aussi gentil avec elle que Gephardt, qui la conduisit jusqu’à l’autel.
Et la vie nous emportera, p. 271.











