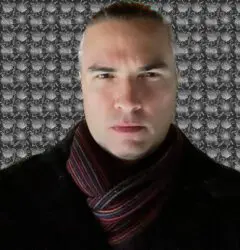J’apprécie l’audace graphique et esthétique de la collection « Sauvage » chez Annika Parance : les pages frontispices n’affichent pas le titre du livre, pas plus que le nom de l’auteur. Ces informations se voient plutôt imprimées en quatrième de couverture ; une confusion entre l’envers et l’endroit qui sied parfaitement à l’écriture de David Beaudoin.
Dans L’écueil des mondes, paru en 2021, tout comme dans La signature rouillée, sorti l’année suivante en tant que premier titre de la collection « Coûte que coûte », Beaudoin développe des univers où l’action et les personnages semblent en adéquation avec cet étrange rapport de symétrie inversée.
Au cœur du cataclysme
Les nouvelles qui composent L’écueil des mondes partagent d’évidentes similarités. Elles mettent en scène des protagonistes qui doivent affronter la puissance dévastatrice de la nature, des obstacles venant de toutes parts qui les contraignent à se laisser échouer. Ajoutons que ces personnages forment généralement des couples discordants où chacun s’oppose à l’autre. Que ce soit pour des raisons sociales, générationnelles ou culturelles, ils se butent à une incompatibilité irréductible. Ils se heurtent à des antagonismes qui rendent difficile la communion entre les esprits, faisant en sorte que les relations amoureuses achoppent. En fait, seuls les corps arrivent à fusionner, et l’unique moyen de s’unir ou de se comprendre passe par les rapports charnels.
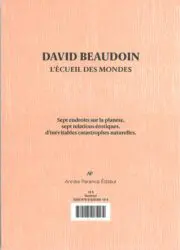 J’ajouterai que ces conflits interpersonnels se déroulent tous dans un environnement qui ne joue pas le rôle d’un simple décor, mais qui incarne une véritable entité agissante. Chacune des nouvelles se situe dans un endroit différent de la planète où frappe un désastre naturel : rivières contaminées en Équateur, éruption volcanique en Indonésie, tremblement de terre au Pérou, froid glacial au Népal, glissement de terrain en Bolivie, infestation de rats en Inde et tempête de poussière au Chili. Écrasés par des altérités multiformes et réfractaires, les repères de celles et ceux qui s’y trouvent vont jusqu’à disparaître. En fait, pour ces individus épuisés et perdus dans la jungle ou terrorisés par les secousses d’un séisme, le sens du monde en arrive parfois même à s’effondrer. « Ils dérivèrent deux jours et deux nuits dans le brouillard et les retombées de poussière. Personne ne savait quoi faire durant cette errance. Tout à coup, les conversations avaient l’air insignifiantes. »
J’ajouterai que ces conflits interpersonnels se déroulent tous dans un environnement qui ne joue pas le rôle d’un simple décor, mais qui incarne une véritable entité agissante. Chacune des nouvelles se situe dans un endroit différent de la planète où frappe un désastre naturel : rivières contaminées en Équateur, éruption volcanique en Indonésie, tremblement de terre au Pérou, froid glacial au Népal, glissement de terrain en Bolivie, infestation de rats en Inde et tempête de poussière au Chili. Écrasés par des altérités multiformes et réfractaires, les repères de celles et ceux qui s’y trouvent vont jusqu’à disparaître. En fait, pour ces individus épuisés et perdus dans la jungle ou terrorisés par les secousses d’un séisme, le sens du monde en arrive parfois même à s’effondrer. « Ils dérivèrent deux jours et deux nuits dans le brouillard et les retombées de poussière. Personne ne savait quoi faire durant cette errance. Tout à coup, les conversations avaient l’air insignifiantes. »
Ces multiples tableaux apocalyptiques transposent les bouleversements intérieurs des personnages sur un mode hyperbolique. Le lieu de l’action est toujours hostile, inhospitalier, voire angoissant. Une tension inquiétante ne cesse de rôder en arrière-plan. Dans chacun des sept textes du recueil – le chiffre sept recèle ici un évident pouvoir de connotation quant à la magie et au sacré –, on décèle une part d’étrangeté et d’inexplicable. Tout cela participe d’ailleurs à l’atmosphère troublante des descriptions. « Dans ce décor de fin du monde, quelques lamas patientaient stupidement, toujours attachés à leurs piquets, inconscients du sort qui les attendait. Et sur l’un des rares sommets encore intacts, Judy crut discerner la silhouette de deux femmes assises côte à côte, les cheveux voguant dans le vent. »
Au paroxysme de la destruction surgissent par moment des présences d’une sérénité suspecte, des éléments d’apparence anodine, mais teintés d’un inexplicable caractère malveillant. « Il ne restait plus que de la grisaille partout autour. Les yeux lui brûlaient tellement qu’il devait les garder clos en permanence. Dans une ultime tentative, il reprit son avancée jusqu’à ce que sa tête heurte la surface d’un objet. »
Écrit durant un voyage autour du monde de plus d’un an, ce recueil regroupe des récits où l’érotisme se conjugue au tragique, des nouvelles qui traitent de crises personnelles amplifiées par le contexte de cataclysme dans lequel elles surviennent. Dans ces mondes au caractère imprévisible, le drame se joue sur un plan tout autant intime que global.
Le vandale et double
Je serais tenté d’affirmer qu’en croisant ces trois classiques : Le meurtre de Roger Ackroyd d’Agatha Christie, Le Horla de Guy de Maupassant et Le portrait de Dorian Grey d’Oscar Wilde, vous obtiendrez quelque chose s’approchant de La signature rouillée. J’aurais envie de simplifier les choses, mais je retiendrai mon élan. En fait, ce premier roman foisonnant et complexe ne pourrait se résumer par un jeu facile de comparaisons.
Au musée Carnavalet, à Paris, Le sauvetage des malades de l’hôpital de l’Ancienne Charité a été vandalisé et la directrice de l’établissement doit faire appel aux services d’un spécialiste pour effacer les traces du méfait. Elle contacte Antoine G., le protagoniste du roman. Rapidement, celui-ci se montre fasciné par le tableau qui dépeint les patients d’un établissement hospitalier secourus lors des inondations de 1910 dans la capitale française. Individu méthodique et pleinement investi de sa mission, Antoine entreprend des recherches sur A. Boulanger, l’artiste derrière l’œuvre à remettre en état. Il est aussitôt obsédé par ce qu’il découvre. Surtout, il commence à s’imaginer, à fabuler toutes sortes de scénarios autour du drame contenu dans la représentation de cet événement historique. Sa capacité de discernement se confond toutefois avec de fausses perceptions du réel. « Antoine G. douta de ce qu’il voyait et surtout de l’interprétation qu’il en faisait. Il avait passé beaucoup trop de temps devant cette peinture pour que son jugement ne soit pas altéré. »
 Un élément déclencheur dans l’enquête concerne l’identité de l’artiste de la toile : A. Boulanger est une femme ! Voilà ce qu’Antoine G. pense avoir découvert. Aidé par ses visions et son instinct, il parvient alors à élaborer des théories validant cette hypothèse : « Le coup de pinceau ainsi que la manière de représenter les personnages laissaient supposer une sensibilité féminine. Un homme du début du vingtième siècle n’aurait jamais peint de cette façon ». Il en vient enfin à persuader la directrice que ses théories s’appliquent à d’autres œuvres du musée. Surtout, il estime que l’identité véritable de maintes femmes peintres a été tenue secrète. En mettant en lumière ce triste sort réservé à toutes ces artistes, il considère qu’il révolutionnera l’histoire de l’art.
Un élément déclencheur dans l’enquête concerne l’identité de l’artiste de la toile : A. Boulanger est une femme ! Voilà ce qu’Antoine G. pense avoir découvert. Aidé par ses visions et son instinct, il parvient alors à élaborer des théories validant cette hypothèse : « Le coup de pinceau ainsi que la manière de représenter les personnages laissaient supposer une sensibilité féminine. Un homme du début du vingtième siècle n’aurait jamais peint de cette façon ». Il en vient enfin à persuader la directrice que ses théories s’appliquent à d’autres œuvres du musée. Surtout, il estime que l’identité véritable de maintes femmes peintres a été tenue secrète. En mettant en lumière ce triste sort réservé à toutes ces artistes, il considère qu’il révolutionnera l’histoire de l’art.
En plus du déroulement de l’enquête, le récit propose de nombreux retours en arrière sur la jeunesse d’Antoine, qui a grandi au Québec seul avec sa mère. Ces flashbacks s’intéressent en particulier à la relation déterminante qu’il a entretenue avec sa grand-mère Zélina qui, comme lui, est dotée de mystérieuses facultés. « Elle lui avait expliqué qu’ils étaient différents du reste des membres de la famille, et que ceux-ci ne pouvaient pas comprendre ce qui les habitait. » Plus loin, il est dit que l’orientation sexuelle de son aïeule ne correspond pas à celle de la majorité, que sa grand-mère fréquentait une femme en secret. Pour sa part, dans le cadre de son investigation, Antoine fait la rencontre du docteur en psychiatrie Nabil Zakaria. Les deux hommes sont aussitôt attirés l’un par l’autre. Ils entament une liaison passionnée qui produit un effet apaisant sur Antoine. Aussi, Nabil est un fervent admirateur d’Antonin Artaud, à qui il voue un véritable culte et au sujet duquel il possède un savoir encyclopédique. Un soir, le psychiatre invite son amant à assister à une pièce. Antoine entre alors dans un étrange état de transe. « Le restaurateur se rendit compte qu’il avait quitté son corps. Il planait dans le Théâtre de la Bastille, comme s’il était aspiré par la fiction qui se jouait ce soir-là. »
Plus l’enquête avance, plus Antoine se laisse absorber par la tâche qu’il doit accomplir. Du fait de son état mental instable et de ce qui est présenté comme une sorte de clairvoyance, il décèle des détails que lui seul arrive à percevoir. Par ailleurs, l’intensité de ses visions se décuple. Il paraît vivre dans un monde parallèle où même les objets inanimés prennent vie. Marchant à travers la ville, il se rend sur le lieu réel duSauvetage des malades de l’hôpital de l’Ancienne Charité. Le niveau de la Seine commence à monter et les rues sont inondées. Sa conscience se trouve alors submergée par un environnement extérieur incontrôlable affluant avec violence. De plus, les hallucinations qu’il éprouve lui révèlent des informations sur la femme vêtue de blanc qui figure en tant que point central du tableau. « La nuit précédente, il avait encore rêvé à l’inondation de 1910. Il s’était revu en voguant dans la vieille barque en bois au milieu de tous les cercueils flottants. »
Un matin, en rentrant au musée, Madeleine Bernard, qui l’avait engagé au départ, n’est plus là. Elle a été remplacée par un certain Bernard Madeleine. À partir de ce moment, tout bascule. Le comportement d’Antoine se transforme, il devient complètement paranoïaque et accuse le nouveau venu d’être responsable du départ de sa supérieure. « Dès qu’il avait fermé les yeux, il n’avait pu s’empêcher de penser au meurtre de Madeleine Bernard perpétré par Bernard Madeleine. […] Antoine G. était certain que ce dernier avait fait disparaître la directrice du musée Carnavalet parce qu’elle en savait trop sur le sort des femmes dans l’histoire de la peinture. »
À la fin, après un long crescendo vers la folie, nous apprenons qu’Antoine est, en vérité, celui qui a vandalisé la toile et que Nabil est son médecin. Nous comprenons que toute cette histoire doit être appréhendée comme un vaste épisode psychotique. Chacun des morceaux du puzzle se met alors en place et tous les indices que le narrateur a habilement disséminés depuis le début viennent rendre évidente une situation qui paraissait de plus en plus confuse.
Le ruban de Möbius
Le curieux objet géométrique possédant un seul côté, appelé ruban de Möbius, m’apparaît bien illustrer le fonctionnement déroutant de La signature rouillée. Ce roman réussit avec adresse à créer de la confusion entre le côté pile et le côté face d’une pièce tournoyant sous nos yeux. Cela dit, là où il n’y a pas d’équivoque, c’est concernant la grande maîtrise dont fait preuve l’auteur de la mécanique narrative. La construction de son récit s’avère impeccable et la résolution de l’intrigue, qui s’opère dans un renversement complet de perspectives, parvient à provoquer une sorte d’épiphanie chez le lecteur.
Réalisme magique ?
Par ces deux premières publications bien ficelées, Beaudoin pose les premières briques d’une œuvre prometteuse. Avec une esthétique un peu baroque, l’auteur propose une écriture raffinée usant du passé simple, une prose à l’élégance classique se mariant d’ailleurs à merveille avec les fictions souvent hors du temps qu’il élabore.
David Beaudoin a publié :
L’écueil des mondes, « Sauvage », Annika Parance, Montréal, 2021.
La signature rouillée, « Coûte que coûte », Annika Parance, Montréal, 2022.
EXTRAITS
La Cuyabeno devenait de plus en plus difficile à remonter. Le nombre de carcasses y flottant augmentait sans cesse, des poissons, des oiseaux, quelques dauphins d’eau douce. Les animaux dérivaient comme si la jungle les rappelait à elle.
L’écueil des mondes, p. 22.
Les membres des deux hommes n’avaient jamais affiché une telle fermeté. L’esprit de compétition qui aurait dû les animer était totalement transcendé en quelque chose de plus grand, de plus intense. L’un était complètement excité de se sentir cocu, de voir sa femme se faire baiser devant lui, alors que l’autre jouissait de sa toute-puissance, de se percevoir comme l’amant viril qu’il devait nécessairement être.
L’écueil des mondes, p. 38.
Antoine G. n’en pouvait plus. Il s’assit sur une marche pour se reposer. Les femmes peintres se penchèrent immédiatement sur lui. Elles l’enlacèrent, puis le soulevèrent toutes ensemble. Le restaurateur passa de main en main, alors qu’elles le transportaient vers le haut de l’escalier. Il se sentit important, comme si elles l’avaient choisi pour les aider. Dans son esprit, il ne faisait aucun doute qu’il était devenu l’une d’entre elles.
La signature rouillée, p. 151-152.