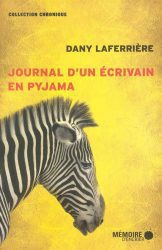Je le confesse d’emblée : je ne suis pas un familier de l’œuvre de Dany Laferrière. Le succès de son premier roman n’est sans doute pas étranger au fait que je me sois tenu à distance de ses écrits.
Je n’irai pas jusqu’à dire que son titre, résolument accrocheur, voire racoleur, a contribué à m’en détourner ; c’est davantage le bruit et la rumeur médiatiques entourant la publication du roman qui ont freiné ma curiosité. C’est ainsi. Tous les regards se portent sur un livre, je détourne aussitôt le mien sur un autre. Je préfère la naïve impression de découvrir un auteur et une œuvre à celle qu’on cherche à m’imposer par son caractère incontournable. D’aucuns diraient qu’il m’arrive de bouder le succès populaire. Je ne leur gâcherai pas ce plaisir. Ni de dire celui le plaisir que j’ai eu à lire le Journal d’un écrivain en pyjama1. Longtemps, je me suis éloigné du bonheur…
Je savais pourtant, depuis longtemps même, qu’il ne s’agissait que d’un rendez-vous sans cesse reporté. Je peux même en dater le report : depuis la parution du troisième roman, L’odeur du café. Encore une fois à cause du titre, mais de façon positive cette fois : je résiste difficilement à l’odeur du café frais moulu, comme à d’autres effluves qui vous font tourner la tête. Un titre, nous dit Laferrière, c’est comme un mot de passe qui nous donne accès au livre. J’avais le bon cette fois, et je me le suis répété tout bas comme il nous y invite. Sans avoir lu le livre, ni même l’avoir ouvert en librairie, je m’imaginais passer devant la galerie où Da, la grand-mère du narrateur, invite les passants à s’arrêter un instant pour partager un moment de complicité, un café dont la principale vertu semble être d’éloigner momentanément les mauvais esprits (je vous entends sourire). Et si la rencontre s’est pour ma part produite avec L’énigme du retour, je n’en demeure pas moins convaincu que c’est par la voix que j’ai accédé à cette œuvre riche en couleurs et en odeurs de toutes sortes, qui nous font si souvent défaut au sortir de l’hiver. La voix d’un narrateur qui se confond, il faut bien l’avouer, à celle de son auteur entendu à quelques reprises à la radio et à la télévision. Une voix où se mêlent le rire et le sérieux, comme quelqu’un qui vous reçoit en pyjama : « On se sent tout de suite en intimité avec quelqu’un qui vous ouvre sa porte en pyjama, même s’il a l’air aussi maussade qu’un temps gris de novembre ». Une voix où l’on décèle aussitôt une intelligence vive qu’une pointe de malice s’efforce d’atténuer. Da a sûrement dû maintes fois lui rappeler les vertus de la modestie.
Intimité. Voilà sans doute le fil conducteur de cette chronique qui aborde les multiples facettes de l’écriture. « Ce journal, écrit d’entrée de jeu Dany Laferrière, n’est qu’une collection de notes d’écriture et de lecture, prises au fil des jours, et qui ne sont destinées qu’à moi, ou du moins au jeune écrivain que je fus. J’ai laissé filer la vache avant de chercher à fermer la barrière. » Multiples, et dans un ordre qui rappelle davantage la conversation que la classe à un jeune écrivain, les questions qui y sont abordées sont reliées au temps, le temps réel comme celui de la narration, à l’insondable espace entre l’un et l’autre, et à ces autres questions concernant le point de vue, le point de fuite, la page blanche, l’éternel combat entre le cerveau gauche et le cerveau droit, le duel entre celui qui crée et celui qui critique, la vraisemblance, le lieu, l’exigence quotidienne, aussi fidèle au rendez-vous que l’est chaque lever de soleil, les doutes, aussi inévitables que les jours de grisaille, la solitude, les relations avec un éditeur, avec les journalistes, avec les amis et les membres de sa famille qui cherchent tout autant qu’ils craignent à se reconnaître dans ce qui est écrit et qui fait ici dire à Laferrière que « ce qu’ils aiment dans les autres livres, c’est bien ce qu’ils détestent chez vous : ces détails qui donnent vie au livre ». Ce résumé des sujets abordés ne devrait toutefois pas faire ombrage à l’aspect le plus important, à mes yeux, de cette chronique : la manière de dire, d’écrire, d’appréhender le réel que les mots, seul véritable matériau de l’écrivain, tenteront par la suite de rendre. Le style, la voix.
L’aspect ludique est ici omniprésent et trace la ligne, de manière aussi visible que les rayures du pyjama, entre le sérieux et le caractère affecté d’une démarche qui se voudrait sérieuse, qui au demeurant ne tromperait que le charmant zèbre de la page couverture. Car à tout moment, on ne peut s’empêcher d’entendre le rire sonore de Dany Laferrière qui désamorce la gravité du propos. Il marche ainsi constamment sur un fil de fer, avec les mots pour seul filet, et le rire comme amulette. Et ce sens de la formule qui fait aussitôt du lecteur un complice intelligent. Un exemple parmi tant d’autres : « La fausse poésie, c’est comme la fausse monnaie : cela ressemble à l’original, mais ne sert à rien ».
« Personne ne peut vous apprendre à écrire. Cela exige une trop grande plongée à l’intérieur de soi. » Mais la lecture demeure incontestablement la voie royale qui conduit à l’écriture. Dany Laferrière est ici redevable envers tous les écrivains qui ont formé son goût, de Dumas à Borges, sans oublier Homère, Rabelais, Shakespeare, Voltaire, Woolf, Duras, Yourcenar, Márquez, Miller, Cortázar, Roth, et tant d’autres. Tout écrivain, rappelle-t-il, est d’abord un lecteur qui puise, pige, patouille dans les œuvres dont il s’alimente. À elle seule, la liste des auteurs auxquels Laferrière réfère pour illustrer et appuyer son propos s’avère un formidable programme de lecture. Un carré de sable inépuisable. De quoi épuiser toutes vos réserves de café.
Chacune des deux cent deux notes (notez cette suite inachevée) qui nous sont ici données se termine par un aphorisme qui nous est offert comme un biscuit chinois que l’on prend plaisir à déballer en anticipant déjà le plaisir que nous livrera le prochain. Intelligence du propos, ai-je souligné ci-dessus, et plaisir de savoir qu’on peut à tout moment se replonger dans ce journal en étant assuré d’y retrouver une voix et une couleur sans doute propre à cet univers particulier qu’il me tarde maintenant d’explorer à mon aise puisque n’est pas pantouflard celui qui porte le pyjama.
1. Dany Laferrière, Journal d’un écrivain en pyjama, Mémoire d’encrier, Montréal, 2013, 319 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
Quelle étrange expression ! Legrandécrivain. Cela voudrait-il dire qu’il ne peut plus rien écrire de mauvais ? Il sait bien qu’il est impossible d’écrire quoi que ce soit sans cette angoisse qui prend la forme d’une petite boule dans sa poitrine. Il n’y a pas d’écrivain zen.
p. 112
N’espérez pas devenir un écrivain sans vanité, car ceux qui ont tenté le coup sont devenus, au mieux, des mystiques.
p. 115
On ne dira jamais assez combien la lecture d’un mauvais livre peut aider parfois un écrivain désespéré à reprendre confiance en lui.
p. 155
Il y a plusieurs manières d’écrire. Pour ma part, je crois qu’il est préférable que le lecteur pense que les mots naissent sous ses yeux. Qu’il ait l’impression que tout est facile. Et qu’il pourrait en faire pareil à l’instant. Pour arriver à une telle fluidité, il faut se débarrasser de cette habitude de parader. Et oublier un moment les phrases pompeuses, les analyses complexes, mais vides de sens, et cette musique si artificielle qu’on sent bien qu’elle n’est reliée à rien.
p. 224
On doit comprendre, même si cela nous blesse quelque part, que notre difficulté à lire Joyce concerne moins Joyce que nous.
p. 232
Ce sentiment qu’on ressent en écrivant, d’être totalement en accord avec ce qu’on écrit, est plutôt rare, mais c’est une telle fête quand ça arrive.
p. 235
Vous avez toujours le choix entre lire un bon livre ou en écrire un mauvais – voilà une vacherie.
p. 295