Quand l’encre de Chine, le Sharpie et le Stabilo remplacent la vieille Underwood, l’image poétique est à prendre au premier degré.
L.-M. S.
Dès la parution de son premier roman au milieu des années 1980, Dany Laferrière s’intéresse à la dimension physique du métier d’écrivain. Qu’il soit attablé dans la cuisine d’un modeste logement en pleine canicule ou caressé par une brise bienveillante, assis sur un banc de parc, le corps tout entier du romancier est souvent décrit comme participant à l’expérience totale de l’écriture.
La création littéraire prend parfois même l’aspect d’une étonnante pratique sportive où les doigts tapant sur les touches d’une vieille Underwood s’activent au rythme d’une épuisante performance athlétique.
Avec la sortie de sa quatrième et de sa cinquième œuvre dessinée, la machine et le clavier sont à nouveau laissés de côté par l’auteur, cela à la faveur d’outils qui engagent vers des méthodes scripturales beaucoup plus artisanales, beaucoup plus charnelles, où les images remplacent les descriptions et où le texte est tracé à la main.
Du dessin au montage graphique
Contrairement à Autoportrait de Paris avec chat1, à Vers d’autres rives2 et à L’exil vaut le voyage3, qui revêtent davantage l’aspect de grands cahiers à dessins, Sur la route avec Bashō4 et Dans la splendeur de la nuit5 abordent la mise en page autrement. Le format des livres est plus conventionnel, plus compact, mais aussi on remarque un emploi plus élaboré du montage graphique. Véritablement, on constate une recherche dans le cadrage des images, le jeu entre les échelles de plans et le raccord des séquences. Ce changement dans l’approche du visuel a ainsi pour effet favorable de dynamiser la trame des illustrations qui s’enchaînent, cela sans nuire à cette particularité d’objet « fait main » qui, certes, n’est pas sans attraits.
Dans Sur la route avec Bashō, le narrateur est un personnage se nommant Caméra et c’est par le prisme particulier de sa lentille que nous est montré le récit, un récit fait de brèves scènes hétéroclites aux couleurs vives. Cette vigueur sur le plan chromatique peut d’ailleurs rappeler l’art du peintre haïtien Philomé Obin, voire celui du très célébré Jean-Michel Basquiat, artiste au sujet de qui Laferrière signe notamment un pastiche très réussi. Parlant de célébrités, Caméra choisit de nous en présenter, toutes disciplines confondues, un important florilège. Du peintre Henri Matisse aux tennismen Roger Federer et Rafael Nadal, en passant par le saxophoniste de jazz John Coltrane ou la poète Sylvia Plath, pour ne présenter que ce très mince éventail, les noms s’enchaînent presque à la vitesse d’une pellicule devant la lumière d’un projecteur. Mêlés à ces gens connus émergent des individus anonymes, des plans d’ensemble montrant des foules, des natures mortes ou des plans si rapprochés qu’ils en viennent à transformer leur sujet en œuvre abstraite. D’une impitoyable objectivité, Caméra montre tout, sans désir apparent d’ordonner ou de hiérarchiser. Et cette matière picturale qui nous est offerte, ces coloris hyperboliques parviennent à littéralement saturer notre capacité à en prendre davantage. Mais tel que l’affirmait Laferrière dans sonJournal d’un écrivain en pyjama : « Ma technique, je l’ai piquée au peintre primitif. Il procède par intoxication. Il ne s’adresse pas à l’intelligence, mais aux sens6 ». On l’aura deviné, ces dessins que cadre Caméra ne semblent donc pas répondre à la logique d’une implacable structure, mais plutôt à une sensibilité tout instinctive.
Un cahier dans le cahier
Environ à mi-chemin du récit surgissent deux pleines pages sur lesquelles se déploie une photographie de ce qui semble être la véritable table de travail de Laferrière. On y observe des stylos, des feutres, des crayons, des bouteilles d’encre et de pigments de couleurs, mais également un cahier grand ouvert divulguant deux pages ne se trouvant nulle part ailleurs dans le livre. « L’image fixe provoque des émotions beaucoup plus complexes que des images en mouvement. » Ici, l’effet de surprise opère avec une efficacité redoutable. Les quatre coins du cadre semblent exploser pour dévoiler un hors-champ où se retrouvent les outils liés à l’esthétique visuelle de cette entreprise littéraire que l’auteur peaufine depuis quelques années et que le lecteur, lui, tient entre ses mains.
« Voilà une chose à laquelle je ne m’attendais pas
cette amitié avec Bashō. Je ne m’étendrai pas non plus
sur cette relation avec un poète mort depuis si longtemps déjà. »
Sur la route avec Bashō
Un roman sur Bashō ?
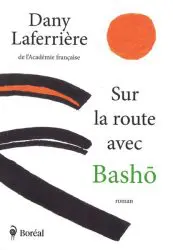 D’une part, ce n’est pas véritablement un roman, sinon au même titre que l’auteur d’origine haïtienne est un écrivain japonais. D’autre part, le livre ne s’intéresse pas de manière directe à la vie ou à la poésie de Bashō. Le lien entre le poète et le contenu de ce « roman » est donc plutôt subtil. Oui, on y trouve, retranscrits, certains de ses textes. Il y a aussi un évident goût pour le laconisme dans la formulation, une façon de tenter de cristalliser le réel dans sa plus pure expression, un principe de création avec lequel une comparaison avec le haïku est envisageable. « Parfois, je lis, toujours le même livre. Je l’ouvre pour me retrouver dans un haïku de Bashō. C’est là que j’aimerais vivre, dans un vers de Bashō7. » Une chose est certaine, il ne s’agit aucunement d’un roman verbeux. Les mots sont employés avec parcimonie. La langue écrite s’efface pour laisser la place à des illustrations qui vont bien au-delà de la description, dessins qui parviennent à se substituer à l’image poétique, peut-être parce que la vue d’une idée peut parfois rendre obsolète l’utilité des sous-titres. « Bashō ne voit pas le paysage comme un géographe. Il ne perçoit que des couleurs8. »
D’une part, ce n’est pas véritablement un roman, sinon au même titre que l’auteur d’origine haïtienne est un écrivain japonais. D’autre part, le livre ne s’intéresse pas de manière directe à la vie ou à la poésie de Bashō. Le lien entre le poète et le contenu de ce « roman » est donc plutôt subtil. Oui, on y trouve, retranscrits, certains de ses textes. Il y a aussi un évident goût pour le laconisme dans la formulation, une façon de tenter de cristalliser le réel dans sa plus pure expression, un principe de création avec lequel une comparaison avec le haïku est envisageable. « Parfois, je lis, toujours le même livre. Je l’ouvre pour me retrouver dans un haïku de Bashō. C’est là que j’aimerais vivre, dans un vers de Bashō7. » Une chose est certaine, il ne s’agit aucunement d’un roman verbeux. Les mots sont employés avec parcimonie. La langue écrite s’efface pour laisser la place à des illustrations qui vont bien au-delà de la description, dessins qui parviennent à se substituer à l’image poétique, peut-être parce que la vue d’une idée peut parfois rendre obsolète l’utilité des sous-titres. « Bashō ne voit pas le paysage comme un géographe. Il ne perçoit que des couleurs8. »
Le lecteur pourrait ici se demander : « Mais que l’académicien veut-il bien me raconter ? » Car le texte occupe une place que l’important réseau d’images tend à souvent occulter. Alors, quoi penser ? Et si on regardait ces dessins comme on lit une phrase ? Et si on interprétait ces traits et ces cercles comme d’ambiguës métaphores ? Et si on laissait venir à nous les idées que connotent ces personnages aux contours indéfinis ? Et si les phrases n’étaient finalement que le dessin d’une main retranscrivant une histoire dont on est le seul à connaître la clé ? Et si on écoutait ce conseil que nous prodigue Caméra, selon lequel « on n’a pas toujours tort de prendre les choses au premier degré, récupérant au passage [notre] cœur d’enfant ».
« Je me suis toujours demandé ce qu’exigent de nous
tous ces crépuscules qui se sont logés en nous.
Qu’ont-ils fait de nous ? Tout ce noir. »
Dans la splendeur de la nuit
De la lumière à l’obscurité
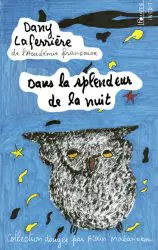 Dans Sur la route avec Bashō, l’action se déroule principalement le jour. Le soleil sur la page couverture nous le suggère, aussi la présence du personnage Caméra sous-entend l’importance d’un éclairage adéquat. Dans la splendeur de la nuit nous invite à une escapade nocturne faite d’échos et de fantasmagorie en plein cœur d’un arrondissement défavorisé de Port-au-Prince. Ironiquement, cette œuvre, publiée dans la collection « Points Poésie » chez Seuil, collection dirigée par Alain Mabanckou, ami de Laferrière, révèle un caractère narratif beaucoup plus important que Sur la route avec Bashō, qui affiche l’étiquette « roman ». De toute évidence, le principal intéressé s’amuse avec les appellations désignant les divers genres littéraires.
Dans Sur la route avec Bashō, l’action se déroule principalement le jour. Le soleil sur la page couverture nous le suggère, aussi la présence du personnage Caméra sous-entend l’importance d’un éclairage adéquat. Dans la splendeur de la nuit nous invite à une escapade nocturne faite d’échos et de fantasmagorie en plein cœur d’un arrondissement défavorisé de Port-au-Prince. Ironiquement, cette œuvre, publiée dans la collection « Points Poésie » chez Seuil, collection dirigée par Alain Mabanckou, ami de Laferrière, révèle un caractère narratif beaucoup plus important que Sur la route avec Bashō, qui affiche l’étiquette « roman ». De toute évidence, le principal intéressé s’amuse avec les appellations désignant les divers genres littéraires.
Le point de vue proposé est celui d’un jeune poète encore adolescent : « [P]ersonne ne me croit quand je dis que j’ai seize ans et que je suis poète ». Ce narrateur déambule au gré d’autres personnages : des amis ou des noctambules rencontrés par hasard. Parmi ceux-ci, il y a Marlon, ancien camarade de classe fou de la musique de Little Richard. Il y a aussi Mao qui, dans les rues violentes de son bidonville, rêve de gloire littéraire et qui recevra une longue lettre d’un vieil écrivain allemand, Gunther, l’invitant à Berlin. On fait également la connaissance d’un sculpteur trop pauvre pour s’acheter du matériel, qui prospecte les rues malfamées de la capitale à la recherche de déchets qu’il pourra transformer en œuvres d’art. Se confondant avec ces personnages, surgissent des animaux totems : un hibou devenant grand-duc, un cobra et un jaguar issu de la jungle du Douanier Rousseau. Et surplombant cette faune en quête de sens et de vérités, cette présence venue de loin dans le temps et dans l’espace, celle du poète chinois Li Po tenant une tasse de thé à la main et dont les vers parviennent à décrire la vie de la Cité-Soleil en plein cœur de la nuit.
« As-tu déjà voyagé dans une couleur ? Tu arrives dans un quartier où règne le bleu, où tout est bleu, même les autres couleurs. Où l’on mange du bleu, boit du bleu. Et quand on a la fièvre on fait du bleu. Et où le coup de foudre se dit : prendre un coup de bleu. Et j’espère au bout du chemin un baiser bleu. »
Dans la splendeur de la nuit
Dessiner pour prolonger le sens des mots
« Quand / on tombe / sur un livre /
on lit un écrivain / mais /quand un lecteur / nous raconte / un livre /
c’est lui qu’on lit. »
Sur la route avec Bashō
En introduction, nous avancions que la présence des dessins dans l’œuvre de l’auteur depuis maintenant cinq livres pouvait être interprétée comme un prolongement du corps à travers l’écriture. À bien y réfléchir, peut-être serait-il plus judicieux d’envisager cette vaste entreprise graphique comme une extension de l’écriture elle-même. Les illustrations, les couleurs qui s’opposent, les rotations du poignet traçant des cercles, la main incertaine derrière cette ligne droite mal assurée, tout comme les bavures de stylo, racontent à leur façon une histoire sur laquelle achoppe le texte. Ce qui est visible est, en fait, souvent de l’ordre du non-dit. Et ce qui est écrit, c’est le lecteur perspicace qui le lira à travers les images.
1. Dany Laferrière, Autoportrait de Paris avec chat, Boréal, Montréal, 2018.
2. Id., Vers d’autres rives, Boréal, Montréal, 2019.
3. Id., L’exil vaut le voyage, Boréal, Montréal, 2020.
4. Id., Sur la route avec Bashō, Boréal, Montréal, 2022.
5. Id., Dans la splendeur de la nuit, « Points Poésie », Seuil, Paris, 2022.
6. Id., Journal d’un écrivain en pyjama, Mémoire d’encrier, Montréal, 2013, p. 224.
7. Id., Je suis un écrivain japonais, Boréal, Montréal, 2008, p. 158.
8. Ibid, p. 261.











