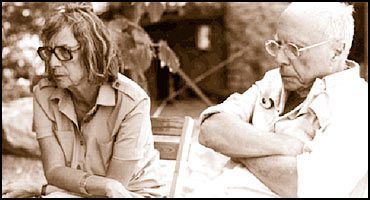Le Jardin des plantes de Claude Simon tient le difficile pari de faire un récit autobiographique qui, loin d’être monocorde et personnel, soit aussi récit de la traversée du siècle. Les inflexions de la narration singulière jouent avec les éclats de voix multiples, les clameurs, les babéliques discours du monde contemporain.
Une geste de notre temps
Geste de notre temps, Le Jardin des plante1 bruit d’échos, de remémorations, de lectures, d’instantanés, de voyages et rencontres, de paroles rappelées qui émergent en fragments, de tableaux restitués par touches ; une geste qui ne cesse de re-faire la scène de la guerre et des massacres administrés. Car, une fois de plus, nous sommes sur la route des Flandres en juin 40, embarqués à l’infini dans le leitmotiv simonien par excellence, le plus tragique, le plus dérisoire : « Parce que, dit-il, oui, c’était parfaitement dérisoire : l’exquise matinée de printemps, le ciel d’un bleu transparent, les prés fleuris, la verte campagne où la seule trace de la guerre était cette route qui ressemblait à une décharge publique ou plutôt à un de ces cimetières de voitures comme on en voit parfois dans les banlieues des grandes villes, avec cette seule différence qu’au lieu d’être entassées les carcasses de véhicules et les épaves de toute sorte étaient alignées comme au cordeau le long de la route […] ». Les lecteurs de Claude Simon retrouvent aussitôt les motifs de La route des Flandres2, avec l’emblématique silhouette du cavalier basculant, sabre levé, comme « ces figurines de plomb […] qu’il faisait fondre, enfant », ou le rideau de filet à motif de paons masquant une fenêtre, ou le cadavre en décomposition ; mais ces motifs sont comme rebrodés en un récit qui a pris de la hauteur, réinscrits dans une écriture d’après l’écriture, après les années après le temps, par quoi une sorte de survie de l’événement confère au narrateur don de survue. C’est une forme sinon de sagesse du moins de lucidité aiguë que donne le long cours de l’œuvre – un surplomb, l’intelligence : « […] sa brève expérience du feu (le rôle dérisoire et mortel qu’on lui a fait jouer : impression qu’on s’est moqué de lui, – on – recouvrant non pas un ou plusieurs personnages, quelque catégorie humaine et sociale (politiciens, généraux), mais une sorte de vague et facétieuse entité (l’Histoire ?), impersonnelle, stupide et impitoyable) demeure comme un traumatisme maintenant pour ainsi dire enkysté en lui à la façon d’un corps étranger, installé pour toujours. »
Qu’il s’agisse, comme dans ce passage, des rapports du narrateur, évadé du camp où il était prisonnier en Allemagne, avec un groupe de résistants qu’il abrite, ou qu’il s’agisse du massacre des Malgaches en 1947-1948, ou encore de l’épisode du camion des tirailleurs nord-africains carbonisés3 (« Il pense : Pauvres bougres, pauvres bougres, pauvres bougres, pauvres bougres »), l’écriture de Claude Simon dans Le Jardin des plantes est plus que jamais de vif-argent, qui sait à la fois saisir au passage la violence des sensations et laisser se déposer, au fil du phrasé, la quintessence du récit de vie récit de mort. La fureur et l’apaisement.
Comme si ce livre de la mémoire était le lieu où toute l’œuvre simonienne parvenait à une décantation extrême. Épure – tous les motifs repassés aux filtres des textes d’archives, ces archi-textes (il y a les Carnets de Rommel, les Mémoires de Churchill, le Journal de marche de tel Régiment d’Infanterie de Forteresse conservé au Service Historique de l’Armée de Terre, Château de Vincennes), aux filtres des interviews journalistiques, des colloques (il y a un fragment reproduit du colloque de Cerisy : débat « nouveau roman » sur « le référent » du récit, entre JR et ARG4), aux filtres des récits, citations, descriptions, réécritures, bref, toute une bibliothèque nourrissant et réinventant une mémoire.
Portrait d’une mémoire : la poétique du montageé
Le Jardin des plantes offre ainsi, somptueusement, cette jouissance particulière à l’écriture simonienne, qui relève de sa double polarité : le coup du trait et l’élaboration du portrait ; l’immédiateté et le détour ; la scrutation et la vue longue ; l’orfèvrerie du détail scénique et les larges enjambements qui relient ou délient les sections du texte.
Car il n’y a point de confidence, encore moins de confession ou d’aveu, dans ces Mémoires. C’est au secret des tracés de l’écriture que s’opère le creusement d’une intimité : par le minutieux déroulé des descriptions qui donne à chaque élément ou objet désigné une charge d’affects inouïe. Et, par suite, une force métaphorique dont la singularité est, précisément, d’opérer dans le récit des transports à tous les sens du terme. Et rien n’est plus prégnant que la narration de cette prise sensuelle des corps et de la porosité dehors-dedans qui en résulte. Telle l’évocation de l’enfance par le biais des scènes aux vitraux de « la chapelle du collège » et des rites de la liturgie ponctuant « à l’aide de claquoirs de bois les différentes phases de l’office ». Car tous ces traits riment bientôt avec « a chapelle ardente » des funérailles et avec l’annonce faite au garçon : « presque aboyant : Ta maman est morte ! » ; à la suite de quoi le récit, dévidant le spectacle des fils de téléphone derrière la vitre du train et le jeu machinal de leurs effets avec la vitesse, se décrit lui-même, principe télé-phonique toujours de la narration, dans la distance, la variante, la surprise des phénomènes.
Prégnante tout autant est la palette des couleurs que le narrateur sait construire en une suite de mots, substantifs posés telle la substance par les touches du peintre, afin de donner toute la mesure (la dramaturgie parfois) d’une aube sur la Sibérie ou sur la Sologne, d’un couchant, des premières irisations du jour vues d’avion ; ou, pareillement, du cercle des jeunes filles de Madras « drapées dans des saris aux couleurs de fleurs ou de fruits : géranium, indigo, carmin, pervenche, cerise, pourpre, safran, grenat, vieux rose, citron, réséda ». L’événement dès lors est bien celui de l’advenir des mots sur la page et des cheminements imaginaires auxquels ils invitent. L’autobiographie manifeste ainsi clairement qu’elle est avant tout « portrait d’une mémoire » c’est-à-dire le lieu où chaque élément, tout en étant lié à une remémoration du vécu, est indissociable de la mise en œuvre qui le construit et, ce faisant, l’invente. Chaque trait est constitué et constituant d’un ouvrage qui forme un monde à soi. S’il y a révélation dans Le Jardin des plantes, c’est bien celle-ci : il ne saurait y avoir de récit de vie sans ce recueillement-là, le recueil de fragments, mis ensemble, bout à bout et cut-cut. Pas de mémoire sans coupe, assemblage, montage, périodicité : « – Arrangements, permutations, combinaisons – est le titre du premier chapitre que l’on étudie en Mathématiques Supérieures : c’est une assez bonne définition du travail auquel je me suis livré », écrit Claude Simon à propos de La route des Flandres5. De fait, le portrait d’une mémoire ne va pas sans une poétique du montage.
Le jardin public : récit de l’être-partagé
Les mémoires de Claude Simon sont donc fort éloignées de quelque exaltation du « jardin privé » de l’égotisme auquel nous a habitués le canon littéraire. C’est au contraire à l’enseigne du jardin public6 où cultiver l’art d’écrire que Le Jardin des plantes tente de faire le portrait de l’être-partagé qu’est l’humain : toujours sous le coup de la mémoire, dans le survenir, traversé d’autre(s) à tout propos. C’est, par la suite, un récit de la défaite et du renouveau qui peint l’être du passage, et Montaigne placé en exergue à l’entrée du volume affiche, précisément, quel travail de marqueterie entreprend le livre. « Aucun ne fait certain dessain de sa vie, et n’en délibérons qu’à parcelles. […] Nous sommes tous de lopins et d’une contexture si informe et diverse, que chaque pièce, chaque momant faict son jeu. »
C’est donc à l’injonction de trouver (inventer) une forme de l’informe que répond l’écriture de Claude Simon. Le Jardin des plantes retient ainsi la leçon de Flaubert c’est-à-dire la nécessité de peindre « par tableaux détachés », mais l’entreprise ici se fait plus radicale : elle prend par les racines, celles, linguistiques, du texte même, donnant ainsi la portée d’une ontologie négative à l’écriture de la mémoire. Car le rigoureux calcul de la composition fictionnelle laisse du jeu à l’essai, n’oubliant jamais qu’« il est impossible à qui que ce soit de raconter ou de décrire quoi que ce soit d’une façon objective », qu’« il n’existe pas de style neutre ou comme on l’a aussi prétendu d’écriture – blanche – » ; et c’est par la voix de Conrad, en exergue de la partie III, que le narrateur souligne le paradoxe de sa tentative : « il est impossible de communiquer la sensation vivante d’aucune époque donnée de son existence – ce qui fait sa vérité, son sens – sa subtile et pénétrante essence. C’est impossible. Nous vivons comme nous rêvons – seuls. »
La forme de fragments marqués de larges interruptions, sorte de fondu au blanc de la narration, la diversité des corps typographiques, des alinéas et des indentations du texte sont donc autant de tracés de ces jardins publics de l’être : une singularité travaillée de pluriel, un singulier-pluriel irréductiblement. Le récit de vie présente ainsi un découpage calculé : des massifs contournables, des allées, des croisées, des plates-blandes aux dessins rares, des espaces à l’écart ou au contraire des lieux plus communs. Mais tous ces dispositifs font aussi mouvement l’un vers l’autre, ou lancent des appels d’un bout à l’autre du livre sous l’effet des chemins de lecture. Le singulier narrateur y vole en éclats dans la variabilité des fils narratifs, tour à tour « je », « il », « il (S) », « CS ». La surface de la page se fait partition, assemblage de parcelles et lopins, lotissant le texte selon les règles de la géométrie et de la topographie. La description d’un tableau de Gastone Novelli se trouve par exemple mise en regard, par l’irruption d’une diagonale, avec le récit d’un épisode de la débâcle de 40. La page, ainsi audacieusement lacérée, coup de mémoire comme d’un obus, porte le lecteur à lire non seulement les liaisons mais les déliaisons du souvenir, ainsi que des coups d’écriture qu’elles requièrent. Les vingt premières pages du volume présentent, de la sorte, une écriture divisoire, c’est-à-dire en fait les modalités d’une autre grammaire à l’œuvre. Où la littérature entend donner à lire accords et accrocs, ajointements et disjointures, le clin d’œil, le rien de temps, bref, l’intervalle où se tient le récit de l’être au-partage-au passage.
Dans L’acacia7, il y avait le narrateur écrivant auprès de l’arbre. Avec Le Jardin des plantes, récit qui fait don de généalogies inconnues ou méconnues, de reprises, de repousses, c’est le livre même qui est arbre. Un arbre de vie, c’est-à-dire de connaissances comme d’inconnaissances, arbre dont chaque lecteur ou lectrice a la chance de devenir un rameau. Menu rejeton. De tous les arbres évoqués dans Le Jardin des plantes de Claude Simon, « pin d’Alep », « jeune acacia », « magnolia », « Platane d’Anatolie planté par Jussieu en 1785 », c’est celui qui s’inscrit dans la fenêtre du convalescent qu’il m’importe de retenir : « Dans les ténèbres le pommier en fleurs semblait luire faiblement, comme phosphorescent. »
1. Le Jardin des plantes, par Claude Simon, Minuit, 1997.
2. La route des Flandres, par Claude Simon, Minuit, 1960.
3. Dans une lettre qu’il m’adresse de Paris le 30 décembre 1998, Claude Simon précise sur ce point : « En même temps qu’à eux, S. pense paradoxalement : ‘Pauvres bougres, pauvres bougres, etc.’, lorsque par les fenêtres de l’appartement des Leiris, il voit passer de l’autre côté de la Seine, sur le quai du Louvre, la colonne des camions camouflés de feuillages emmenant les jeunes soldats allemands vers le front de Normandie en juillet 44. Je dis ‘paradoxalement’, car c’est de son propre appartement où travaillent au même moment les gens des Renseignements Militaires du F.L.N. (Front de libération nationale) que partira le soir même (ou est déjà partie) la dépêche – ou plutôt le message – signalant à Londres le mouvement de cette colonne qui va, sans tarder, être bombardée à mort par la R.A.F. Je pensais que ces jeunes Allemands (même peut-être S.S.) étaient, eux aussi, de ‘pauvres bougres’. »
4. Les initiales désignent respectivement « Jean Ricardou » et « Alain Robbe-Grillet » (NDR).
5. « Notes sur le Plan de montage de La route des Flandres », dans Claude Simon, Chemins de la mémoire, textes réunis et présentés par Mireille Calle-Gruber, Le griffon d’Argile/Presses universitaires de Grenoble, 1993, p. 186-187.
6. C’est sous ce titre : Les jardins publics, que Claude Simon a publié en 1995 quelques extraits inédits du livre, dans Les sites de l’écriture, Colloque Claude Simon, Queen’s University, textes réunis et présentés par Mireille Calle-Gruber, Éditions Nizet, Paris, 1995, p. 25-37.
7. L’acacia, par Claude Simon, Minuit, 1989.
Claude Simon a publié :
Le tricheur, Sagittaire, 1946 ; La corde raide, Sagittaire, 1947 ; Gulliver, Calmann-Lévy, 1952 ; Le sacre du printemps, Calmann-Lévy, 1954 ; Le vent, tentative de restitution d’un retable baroque, Minuit, 1957 ; L’herbe, Minuit, 1958 ; La route des Flandres, Minuit, 1960 ; Le palace, Minuit, 1962 ; Femmes, Sur vingt-trois peintures de Joan Miró, Maegh, 1966 ; Histoire, Minuit, 1967 ; La bataille de Pharsale, Minuit, 1969 ; Orion aveugle, Skira, 1970 ; Les corps conducteurs, Minuit, 1971 ; Triptyque, Minuit, 1973 ; Leçon de choses, Minuit, 1975 ; Les Géorgiques, Minuit, 1981 ; La chevelure de Bérénice, Minuit, 1984 ; Le discours de Stockholm, Minuit, 1986 ; Album d’un amateur, Rommerskirchen Verlag, 1988 ; L’invitation, Minuit, 1988 ; L’acacia, Minuit, 1989 ; Photographies, Maeght, 1992 ; Le Jardin des plantes, Minuit, 1997.