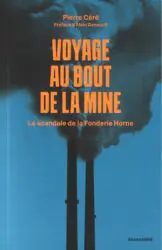L’histoire d’une ville érigée pour satisfaire les besoins d’une compagnie extractiviste ne peut être qu’une histoire d’horreur. Dans Voyage au bout de la mine1, Pierre Céré expose en détail comment, de la Noranda Mines dans les années 1920 à Glencore aujourd’hui, la population de Rouyn-Noranda paye de sa santé la prospérité de la grande entreprise.
Comme le souligne Alain Deneault dans sa préface, Voyage au bout de la mine met en lumière « l’exploitation polluante et coloniale » qui constitue l’histoire de l’Abitibi. L’ouvrage fait notamment ressortir l’incurie des pouvoirs publics placés devant les faits, ce que Deneault nomme « l’incapacité politique à imaginer autre chose qu’un statut de quêteux auprès des investisseurs d’envergure mondiale ».
Le parti-pris de Pierre Céré pour plus de justice sociale est notoire, lui qui se porte à la défense des intérêts des chômeurs depuis plus de 25 ans. Son engagement se vérifie une fois de plus ici, par la rigueur avec laquelle il réalise l’enquête à la base de son livre. Les faits étayés dans son ouvrage sont vérifiables et dûment appuyés par des sources écrites et des témoignages de première main. Par ailleurs, Pierre Céré ajoute de la crédibilité à sa démarche en exposant dans son introduction une source majeure de sa motivation. En effet, l’auteur est né et a grandi à Rouyn-Noranda, là où les résidus miniers et la fumée « suffocante et puante » ont trop longtemps été considérés comme une normalité dans le paysage. Aussi, il est piqué au vif lorsque, en 2022, l’opinion publique est alertée par la prévalence inquiétante des cas de cancer parmi la population de la ville et par la quantité d’arsenic rejetée dans l’air par la Fonderie Horne. Il n’en revient pas qu’on en soit encore là, alors que les données incriminantes sur les rejets de la mines’accumulent depuis plus de 40 ans. C’en est trop. Déterminé à dépasser le sentiment d’impuissance trop souvent ressenti face au poids des événements, il s’attelle à la tâche de dénoncer en étalant l’ensemble des faits. Il en résulte une synthèse remarquable, une importante contribution à la prise de conscience nécessaire pour engager l’action.
Une histoire de dépossession autorisée
Tout d’abord, Voyage au bout de la mine inscrit le cas de la Fonderie Horne dans une lignée. En Abitibi, comme dans d’autres régions du Québec et du monde, les ressources naturelles sont le plus souvent accaparées par une minorité d’exploiteurs, encouragés par un système et des lois qui leur sont favorables. Ainsi, la découverte des premiers gisements d’or le long de la formation géologique abitibienne nommée faille de Cadillac, sans surprise, reviendrait aux Autochtones présents sur le territoire. Des prospecteurs blancs allaient prestement se les approprier, faisant fi des premiers occupants.
À partir de 1911, le prospecteur ontarien Edmund Horne explore les rives du lac Osisko et y découvre le fort potentiel minier du sous-sol, qui recèle notamment du cuivre, de l’or et de l’argent. En 1922, Horne vend ses droits d’exploitation à des entrepreneurs états-uniens qui fondent la même année la Noranda Mines. La compagnie se dote bientôt d’une mine et d’une fonderie qui portent le nom du prospecteur Horne. Les premières fusions de métaux ont lieu en 1927. Il s’ensuit un véritable boum du développement minier dans la région. À partir de ce moment, le gouvernement du Québec mettra tout en œuvre pour permettre l’exploitation de la ressource, sans égard au bien-être des populations locales. En plus de faciliter l’accès au territoire et le recrutement d’une main-d’œuvre bon marché, le gouvernement dédouanera à l’avance la Noranda et les autres compagnies minières pour les torts causés à l’environnement. En effet, on savait dès les années 1920 que les activités industrielles pouvaient s’avérer dommageables, tant pour l’environnement que pour la santé des populations, mais cela devait être sacrifié sur l’autel du sacro-saint développement.
La ville de Noranda est une ville de compagnie, une « company town » prend soin de préciser Pierre Céré. Elle est érigée sur un sol appartenant à la Noranda Mines. Pour accommoder la compagnie, la ville est exemptée de certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec. La compagnie sera dispensée de payer des taxes municipales jusqu’en 1939. Des gens de partout viennent s’installer dans la ville minière, « à la recherche d’une nouvelle vie, en plein bois, parfois pour s’arracher à la pauvreté, mais allant parfois aussi à la rencontre d’une autre misère ».
Pendant des décennies, tandis que les ouvriers subissent de pénibles conditions de travail pour obtenir de maigres salaires, la compagnie prospère. En 2005, Noranda acquiert sa rivale Falconbridge et en adopte le nom. En 2006, Xstrata devient propriétaire de Falconbridge. Enfin, en 2013, Xstrata est achetée par Glencore, une entreprise suisse qui, comme le note Céré, se présente aujourd’hui comme l’« une des plus importantes sociétés de ressources naturelles diversifiées au monde ». Incidemment, cette entreprise fut fondée par Marc Rich, un homme d’affaires crapuleux décédé en 2013, qui avait constitué sa fortune à coups de fraudes et de corruption à grande échelle.
Un monde à l’envers
Alors que la richesse accumulée par la Noranda était due au travail des ouvriers de la mine et de la fonderie, les règles du jeu n’étaient pas d’emblée à leur avantage. Ils ont dû s’organiser et mener de dures batailles pour améliorer leur sort. Pierre Céré rappelle quelques chapitres de ce versant négligé de l’histoire de Rouyn-Noranda.
Au début des années 1930, les ouvriers de la mine et de la fonderie sont en grande majorité des immigrants, notamment d’origines polonaise, hongroise, ukrainienne et scandinave. Héritiers d’une culture politique d’où ils tiennent pour acquis leur droit de revendiquer, ils créent en 1934 un syndicat d’orientation communiste. S’ensuit une grève de dix jours, déclarée illégale, qui sera brutalement réprimée. Des centaines de travailleurs immigrants sont forcés de quitter la région, quand ils ne sont pas emprisonnés, laissant la place à des sans-emploi moins revendicateurs, en grande partie des Canadiens français. Pendant plusieurs décennies par la suite, la compagnie parvient à maintenir une forme d’ascendant sur le syndicat, jusqu’à la fondation en 1979 du Syndicat des travailleurs de la Mine Noranda, affilié à la CSN. Les travailleurs de la Noranda renouent alors avec la combativité des origines, se dotant d’un syndicat qui allait se préoccuper plus sérieusement de la santé et de la sécurité de ses membres.
En 1980, le syndicat fait appel à des chercheurs de l’École de médecine Mont Sinaï de l’Université de la ville de New York pour examiner l’état de santé de près de 1 000 travailleurs et retraités de la Fonderie Horne. Leur étude confirme ce que de nombreux experts locaux avaient suspecté ou observé : « [L]e plomb, le cadmium et l’arsenic pénètrent dans l’organisme ». L’équipe d’experts indépendants établit hors de tout doute un ensemble d’effets néfastes des émissions polluantes de la fonderie sur la santé des travailleurs et de la population. Avant même que les résultats de l’étude soient rendus publics, la Noranda Mines menace de quitter la région si des investissements trop importants devaient lui être imposés pour dépolluer.
De déni en voie d’évitement, au mépris des travailleurs et des citoyens
Après de multiples études et rapports alarmants produits depuis 45 ans, on se rendait compte en 2022 que la population de Rouyn-Noranda était toujours en proie aux effets délétères des activités industrielles de la Fonderie Horne. Pierre Céré dit n’avoir pas été surpris des résultats de l’étude de biosurveillance réalisée en 2018 par la Direction régionale de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue. « Pas surpris qu’on nous parle d’un air vicié à l’arsenic, avec des taux dépassant les normes québécoises par des multiples de 20, 30, 100 fois. Pas surpris qu’on évoque des taux de cancer du poumon 30 % plus élevés que pour l’ensemble du Québec ainsi que des cas d’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, voisin de la Fonderie Horne. » Aucunement surpris des conclusions de cette nouvelle étude, il est surtout choqué du fait que si peu ait été fait depuis plus de quatre décennies pour protéger la santé de la population et de l’environnement. Et l’on est effaré de comprendre avec lui que si la compagnie pollue l’environnement à l’arsenic depuis près d’un siècle, la diversification de ses activités avec le temps a produit des impacts probablement encore méconnus. Ainsi, le journaliste Thomas Gerbet, de Radio-Canada, a mis en lumière qu’en 2021 la Fonderie Horne rejetait dans l’atmosphère au moins 23 contaminants différents. Il semble qu’au cours des ans, de la Noranda Mines à Glencore, le chantage de la compagnie sur le maintien des emplois a suffi pour entretenir un laisser-faire toxique. Il semble aussi que les signaux d’avertissement répétés n’ont entraîné que des demi-mesures, tandis que l’entreprise continuait par ailleurs à intensifier ses activités polluantes.
Pierre Céré se montre très critique à l’endroit des gouvernements et des politiciens qui se sont succédé tout ce temps sans que soient adoptées des mesures adéquates pour civiliser la compagnie. Il donne tout de même l’exemple d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec solidaire pour la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue de 2018 à 2022, qui avait tiré la sonnette d’alarme à partir de 2019. Vraisemblablement, pour avoir pleinement joué son rôle de représentante des citoyens de Rouyn-Noranda, la députée a perdu son siège aux élections provinciales de 2022. Céré affirme, ses dires étant confirmés par certains commentaires journalistiques, que l’establishment de Rouyn-Noranda s’est rangé derrière la Coalition Avenir Québec et a repris les propos démagogiques de François Legault pour barrer la route à celle qui parlait trop. Le parti au pouvoir a ainsi fait élire Daniel Bernard, ex-député libéral et ingénieur minier, enregistré jusqu’en octobre 2022 comme lobbyiste pour l’Association minière du Québec, laquelle association compte parmi ses membres la Fonderie Horne.
Face au tollé suscité par les données rendues publiques à partir de 2019, les gouvernements fédéral et provincial vont offrir à Glencore de généreuses aides financières pour qu’elle diminue ses émissions polluantes. Par ailleurs, un quartier de Rouyn-Noranda sera détruit, sans que la décision d’en venir là ait été prise en concertation avec les citoyens touchés.
Un combat à poursuivre
Malgré les mesures d’atténuation promises et le déplacement de la population de tout un quartier, la Fonderie Horne demeure autorisée à polluer au-delà des normes en vigueur ailleurs au Québec. Fondamentalement, le problème n’est pas résolu. La compagnie continue d’obtenir des dérogations à des normes, parfois elles-mêmes minimales. À la fin de son Voyage au bout de la mine, Pierre Céré, en accord avec les avis d’experts sur la question, soutient que la voie raisonnable à suivre serait d’adopter une approche résolument écosystémique d’exploitation des ressources. Selon une telle approche, le déséquilibre criant entre les profits d’une société multinationale et les préjudices subis par une population se révèle intolérable.
Le livre de Céré nous apprend qu’une grande partie de la population de Rouyn-Noranda ne considère plus comme normal aujourd’hui de laisser une entreprise polluer l’environnement à son gré, sous prétexte que cela est bon pour l’économie. Il serait grand temps aussi de reconsidérer la normalité de notre mode économique, ce système dont les bénéfices appartiennent à une minorité et qui se définit lui-même comme normal.
1. Pierre Céré, Voyage au bout de la mine. Le scandale de la Fonderie Horne, Écosociété, Montréal, 2023, 271 p.
EXTRAITS
J’ai été ramené à ce qui composait notre quotidien et notre normalité quand j’étais jeune. La sirène de la mine qui se déclenchait à l’heure du midi le vendredi pour annoncer qu’elle rejetterait sur la ville une épaisse fumée suffocante et puante. On mettrait, un jour, des mots sur cette fumée : anhydride sulfureux.
p. 21
Je n’avais jamais eu le sentiment, ni conscience, d’être né dans une company town. Une ville construite par la compagnie, existant parce qu’il y avait la compagnie. Une ville, encore aujourd’hui, profondément marquée et en maints aspects tissée par cette compagnie, de Noranda Mines à Glencore. Cent ans de colonisation, cent ans de pollution, de contamination, d’effets sur la vie et sur la santé des gens, sur l’environnement.
p. 22
[L]e seul fait de s’organiser en syndicat et, pire, de revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail s’est toujours heurté, historiquement, à un monde fermé, souvent répressif, toujours manipulateur.
p. 61-62
On va déraciner des gens, briser un tissu social, pendant que le vrai responsable de cette contamination va agrandir sa propriété, sous les bons auspices du gouvernement québécois. On déplace ici le problème vers ceux qui en sont les victimes.
p. 167
On ne peut plus accepter que nos régions soient ainsi dépravées, dépossédées de leurs ressources et contaminées. L’État, celui-là même qui invoque si régulièrement la fierté nationale, doit prendre les choses en main et imposer un cadre normatif au « développement » industriel, qu’il soit minier ou autre : tout doit être pensé en fonction d’un développement écosystémique.
p. 238