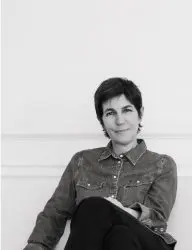Ravir comme dans usurper, voler, violer.
À l’exact opposé de ravir comme dans enchanter, charmer, réjouir.
Convenons avant tout d’une perspective de lecture du dernier ouvrage de Christine Angot1. Fidèle à son habitude, la romancière a choisi la forme narrative au « je » et, pour ajouter de la force (ou, selon le point de vue, de la confusion) à sa proposition, elle nomme son personnage principal Christine. De plus, Angot nous prévient ne pas croire à l’autofiction, qu’elle rejette. Partons de là où se trouve une histoire inventée, un roman donc, pour cheminer dans les anfractuosités de son récit. « Il n’y a pas de vérité hors de la littérature », nous rappelle-t-elle.
Sa première phrase, frontale, nous propulse dans cet hôtel de Strasbourg où Christine rencontre le père qu’elle n’a pas connu. Il a 44 ans, elle, 13 ans. Dès après ce tête-à-tête initial, il l’embrasse sur la bouche : le mot inceste surgit à l’esprit de l’adolescente. Les intentions paternelles sont déjà claires. Il veut la soumettre à la turgescence de ses désirs. Il l’emportera haut la main sur les timides mais constantes réprobations de sa fille. Elle sait. Elle ne sait pas. Déchirée, elle essaie tant bien que mal d’exprimer ses sentiments, violés eux aussi. « J’aimerais bien avoir des relations avec toi comme celles qu’ont les autres enfants avec leur père. » « On n’est pas censé avoir ces rapports-là avec son père. Moi, j’ai peur que ça me perturbe. » « Et si ma vie est gâchée… »
Tout est dit. Du visage, encore juvénile, souillé par le sperme à la sodomie. Rien n’est appuyé. Aucune place pour le voyeur de s’y délecter très longtemps. Elle écrit : « Gérardmer, la bouche. Le Touquet, le vagin. L’Isère, l’anus. La fellation, c’est venu tôt ». Affolée, Christine a trois options de conduite. Pourquoi parmi ces options, y inclus celle désespérée de renoncer à la personne qu’elle était, ne peut-elle pas envisager de rompre, simplement ?
À l’adret et l’ubac
L’expression « à l’adret et l’ubac » saisie par la plume d’Angot résonne dans toute son histoire. Elle y a déjà recours dans son ouvrage L’inceste (1999). À l’adret, un père fantasmé, polyglotte virtuose, à l’allure de Jean-Louis Trintignant (en moins beau), ce genre d’hommes vus à la télé ou au cinéma, qui subjugue l’adolescente sous-développée, sans figure paternelle depuis la naissance, issue de la classe très moyenne dans la « ville merdique » de Reims. À l’ubac, le père est abject à la ville comme au lit. L’homme que la romancière retrace par à-coups secs et brefs est profondément antipathique. Son égoïsme n’a d’égal que sa perversité. Je cherche en vain le mot juste capable d’évoquer ce qui émane de ce type, mot qui cumulerait dégoût, veulerie, pleutrerie, bassesse, fourberie, rapacité. J’en passe. Il raconte à sa fille être amoureux d’une étudiante de Sciences Po, Marianne. Du ton qu’on utiliserait pour parler d’un vin ou d’un livre, il lui dit : « La sodomie ne la dérange pas du tout, elle, au contraire ». En l’absence de sa conjointe et de ses deux autres enfants, il l’amène à son appartement strasbourgeois qu’il lui fait visiter. Plus tard, en léchant sa fille dans le lit conjugal, il commente le sexe de sa femme, lequel « sentait le poisson pourri ».
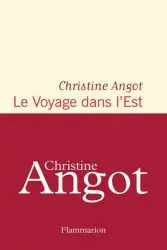 Du côté du père, on discerne le modus operandi connu des pédocriminels. Il veut. Il consomme. Puis décrète qu’il n’a fait que ce qu’elle voulait. La victime, c’est lui. La fille voit pour sa part son avenir gangréné, son destin, irréversible. Pourtant, elle ne veut pas se suicider. Qui connaît la question de l’inceste sait le déni de la chose advenue, l’arrangement avec l’intenable réalité en la travestissant ou l’embellissant. Michelle Lapierre-Dallaire traduit fort justement l’anarchie des sentiments qu’induit l’inceste dans son roman qui vient de paraître. « En un sens, je transformais ma terreur en prouesse. Je catalysais ma détresse en victoire. On appelle ça de la résilience2. »
Du côté du père, on discerne le modus operandi connu des pédocriminels. Il veut. Il consomme. Puis décrète qu’il n’a fait que ce qu’elle voulait. La victime, c’est lui. La fille voit pour sa part son avenir gangréné, son destin, irréversible. Pourtant, elle ne veut pas se suicider. Qui connaît la question de l’inceste sait le déni de la chose advenue, l’arrangement avec l’intenable réalité en la travestissant ou l’embellissant. Michelle Lapierre-Dallaire traduit fort justement l’anarchie des sentiments qu’induit l’inceste dans son roman qui vient de paraître. « En un sens, je transformais ma terreur en prouesse. Je catalysais ma détresse en victoire. On appelle ça de la résilience2. »
Christine est un rare cas de figure. Voilà qu’à l’âge adulte, après avoir mis à l’écart pendant dix ans ce père impossible, avoir réussi ses études à la Sorbonne, avoir rédigé un premier roman et amorcé une cure psychanalytique, elle lui écrit, le revoit et retombe dans ses rets, un comportement peu habituel. Comment l’appréhender ? Passage à l’acte ? Désir fou, destructeur mais irrépressible, de trouver enfin son père, le vrai, celui dont elle a été privée, celui « qui refuse que vous soyez sa fille » ? Autre possible, tel que suggéré dans L’inceste, une reprise de son pouvoir, celui de refuser la sodomie.
Faire littérature utile
« Il fallait que je puisse prétendre, à mes propres yeux, que j’étais heureuse. » Distorsion de la réalité. Peur. Tristesse. Honte. Culpabilité. Émotions toutes mises au jour par Angot qu’une valse-hésitation accompagne. « Il y a probablement eu des sentiments. Je ne peux pas tout mettre sur le compte de la manipulation. » Le premier amant de Christine, deux fois son âge, devient aussi le premier confident qui alerte le père. Celui qu’elle croit être son sauveur, elle le découvrira « intégré au dispositif » du père, et se trouvera gisant dans un triangle inouï. Quant à la mère, elle se tait comme tant d’autres. Son silence lui coûtera cher. Dès que sa fille lui révèle l’inceste, elle fait une grave infection qui nécessite une hospitalisation. Ironie féroce, le seul épargné dans cette histoire semble le père, désormais réfugié dans l’oubli de l’Alzheimer.
Échecs, boulimie, insomnie, désespérance, apathie pendant des années s’ajoutent aux autres maux de vivre de Christine. Puis, peu avant que le délai de prescription imparti par le système judiciaire soit dépassé, elle se présente au commissariat avec l’intention de porter plainte, pour vite battre en retraite dans la crainte intenable que la justice prononce un non-lieu. Qui n’aurait pas eu lieu, ça non, elle ne peut le supporter.
C’est dans le dernier tiers du Voyage dans l’Est que le rideau de brume tombe et que la lumière se pose doucement sur le tabou des tabous, depuis la nuit des temps, dans toutes les sociétés. La faute paternelle est rédhibitoire. « Vous ne savez plus qui vous êtes, lui, c’est qui, c’est votre père, votre compagnon, votre amant, celui de votre mère, le père de votre sœur ? » Quant à la question, maintes fois posée sur un ton vaguement lubrique, du plaisir que l’enfant a pu éprouver, la réponse cingle. « C’est la question qui est obscène. Ça m’a révoltée. L’inceste est une mise en esclavage. » À sa façon allusive, l’autrice traque sans merci la substantifique moelle de ce mal sans nom qui ravit la vie. Traque qui lui vaudra en revanche de ravir le prix Médicis 2021.
Plus de vingt ans se sont écoulés entre la parution de L’inceste et celle du Voyage dans l’Est. Entre la phrase qui clôt le premier, « C’est terrible d’être un chien », et celle du second, « Ça s’est très bien passé ? Très bien », on constate que la plaie s’est refermée, mais que la cicatrice demeure à vif, dans ce lieu intime de solitude absolue.
On quitte Angot à la fin de son voyage, là où flotte dans notre imaginaire la nostalgie déchirante de Barbara, à Nantes, au 25 rue de la Grange-au-Loup.
1. Christine Angot, Le voyage dans l’Est, Flammarion, Paris, 2021, 214 p. ; 36,95 $.
2. Michelle Lapierre-Dallaire, Y avait-il des limites si oui je les ai franchies mais c’était par amour ok, La Mèche, Montréal, 2021, p. 26.
EXTRAITS
Il fallait ignorer des pans de réel entiers, éclairer les points positifs, faire semblant d’avoir oublié certaines scènes, maintenir à flot un niveau de fierté.
p. 52
Se taire. Ça permettait de ne pas avoir d’images dans la tête, de continuer de faire semblant. De ne pas savoir vraiment, de ne pas avoir peur, de ne pas donner corps à l’inquiétude, de ne pas donner de réalité à l’impression d’avoir une vie gâchée.
p. 77
À cette époque, le mot « inceste » ne figurait pas dans la loi.
p. 92
Est-ce qu’on demande à un enfant battu s’il a eu mal ? Pourquoi demande-t-on à un enfant violé s’il a eu du plaisir ?
p. 189
L’inceste s’attaque aux premiers mots du bébé qui apprend à se situer, papa, maman, et détruit toute la vérité du vocabulaire dans la foulée.
p. 190