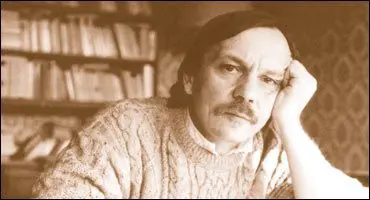« On pourrait recenser les livres selon l’embarras d’en parler », écrit Christian Bobin dans La part manquante. Si tel était le cas, ses livres se retrouveraient assurément en tête de liste. Et une fois cela dit, écrit, l’embarras ne se serait pas pour autant dissipé. Car comment décrire la démarche d’un auteur qui s’attarde avant tout à traquer le vide, le manque, l’absence, pour aussitôt s’emparer de ce vide, de ce manque, de cette absence et en faire apparaître une lumière jusque-là insoupçonnée. C’est un peu cela Christian Bobin : un enchanteur, un sourcier qui fait jaillir les images enfouies dans les mots du quotidien.
Comme chez Prévert – rappelez-vous ce qu’il faut pour faire le portrait d’un oiseau –, l’attente est source de plénitude, l’attitude souveraine à adopter face au tumulte incessant du quotidien. S’il est une chose qui n’effraie pas Christian Bobin, c’est bien le silence, l’attente. « J’attends. Parfois quelque chose arrive – une affirmation brutale de lumière, un soudain élargissement de la vue. Le plus souvent il ne se passe rien. Telle est, au plus près, ma manière de vivre et d’aller sur la terre enchanteresse1. »
Voilà qui déroutera sans doute plus d’un lecteur. Il n’y a pas d’histoire à proprement parler dans les livres de Christian Bobin. Pas de grand ni de petit drame ; pas de personnage taillé à même l’étoffe des héros. Pas davantage d’antihéros. Rien d’autre que les mots qui s’offrent sans les artifices de la narration. Quelque chose qui ressemble à une respiration, au mouvement de la vie. Ou qui cherche à s’en approcher pour en épier le rythme, les battements. On pourrait tout aussi bien parler de lumière, de musique. « Je n’imagine rien. Je n’ai rien à vous dire que vous ne sachiez déjà. Si je vous écris c’est pour ne pas cesser d’écrire, jamais, et c’est pur chant, pure célébration du chant, de cette vibration de l’air contre le tympan du cœur2. »
Autoportrait au radiateur, comme le titre le laisse entendre, se présente sous la forme d’un carnet dans lequel sont tour à tour consignés l’agitation de la lumière, le réel contemplé d’une fenêtre mal fermée, les différents visages qu’emprunte la mort pour ne pas nous effrayer, la disparition de l’être aimé, des réflexions sur l’amour, la beauté et l’écriture. À cet égard, Christian Bobin cite le poète Henri Pichette qui dit que « l’on ne devrait jamais écrire une seule phrase que l’on ne puisse chuchoter à l’oreille d’un agonisant. Eh bien c’est exactement ça. L’écriture que j’aime, c’est exactement ça. Et nous sommes tous des agonisants, n’est-ce pas ? Où me mènent de telles réflexions ? À rien, à rien. Ce n’est pas grave : une petite poussée de fièvre3. »
Le rappel incessant du quotidien, de tous ces petits riens qui le composent, de ce radiateur d’où émane toute la chaleur du livre, désamorce toute tentative de vouloir se prendre au sérieux. Il n’y a ici de ronflant que les borborygmes de la tuyauterie. « Je cherche dès le réveil, écrit Bobin, ce qui est nécessaire au jour pour être un jour : un rien de gaieté. Je cherche sans chercher4. »
On ne s’étonnera pas qu’il y soit beaucoup question de brins d’herbe sur lesquels on se penche, de nuages qui défilent au-dessus de nos têtes, d’enfants qui jouent dans la rue, de fleurs qui suffisent à meubler une pièce, de fleurs qui nous rappellent l’éphémère de toutes choses, et encore de fleurs.
Une constante chez Christian Bobin : la quête ne s’inscrit pas dans le tragique, mais dans la gaieté, la légèreté. Sans la joie, rappelle-t-il sans cesse, la gravité n’est que lourdeur.
Écrire sur rien, mais avec grâce, avec plaisir, générosité. Tel est le défi constamment renouvelé. Écrire dans la joie, sinon se taire. « Je n’écris pas avec de l’encre. J’écris avec ma légèreté. Je ne sais pas si je me fais bien entendre : l’encre, je l’achète. Mais la légèreté, il n’y a pas de magasin pour ça. Elle vient ou ne vient pas, c’est selon5. »
Autre constante : la mort est intimement, intrinsèquement liée au désir de vivre. Un rappel incessant à célébrer la vie, doublé d’une obligation de bonheur à l’égard des morts qu’on ne pleure pas, mais dont on s’efforce plutôt de commémorer le souvenir pour les soustraire à l’oubli. Cette attitude n’est pas sans rappeler La cinquième saison de Philippe Delerm où les mots seuls permettaient de suppléer à l’absence de l’être aimé. « J’aimerais que mes mots dans ce carnet, écrit encore Christian Bobin, soient aussi légers que ce qui reste – ce qui insiste, demeure, triomphe – de ta vie aujourd’hui passée au crible – au tamis, au pressoir – de ta mort6. »
Christian Bobin est né au Creusot, en 1951. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont les titres s’éclairent les uns les autres comme les fragments d’un seul puzzle, peut-on lire en page de garde de plusieurs de ses ouvrages. Pour une fois, la formule reflète bien la réalité, s’avère autre chose qu’un argumentaire de vente. Entre autres titres : Une petite robe de fête, Souveraineté du vide, Éloge du rien, Le très-bas, La part manquante, Isabelle Bruges, La folle allure. À cela j’ajouterais qu’il n’y a pas de nette démarcation d’un livre à l’autre, mais plutôt un réseau de correspondances, de résonances qui s’amplifie à chaque nouvelle parution. Parce qu’un livre est parfois de la littérature, pour reprendre les mots d’Annie Dillard.
Dans Souveraineté du vide, Christian Bobin se livre à une réflexion sur notre aptitude, voire notre inaptitude à être présent, d’abord à soi, puis à l’autre et, enfin, au monde dans lequel nous vivons. Et cette présence requiert que nous sachions regarder, retrouver la pureté du regard de l’enfant. Cette distance entre l’enfant et nous, c’est aussi celle que nous avons pris l’habitude de voir entre nous et notre vie. Distance que le narrateur traduit de la façon suivante : « Je ne crois pas vous avoir dit que j’ai un travail, que je suis, comme tout un chacun, soumis à ce mensonge obligé d’un travail, à cette considérable perte de temps, de vie. Je crois que le mieux est de ne pas en parler. Écrire, seulement7. »
Christian Bobin écrit à la manière d’un musicien ambulant actionnant la manivelle de son instrument d’où s’échappe un air qu’on croit reconnaître pour aussitôt se rendre à l’évidence : « Ce qui éclaire notre vie, ce n’est rien que l’on puisse dire, ou tenir. Ce que l’on dit se tait. Ce que l’on tient se perd. Nous n’avons guère plus de prise sur notre vie que sur une poignée d’eau claire8. »
Chacun des livres de Christian Bobin est un appel à renouer avec l’aptitude naturelle de l’enfant à s’émerveiller devant la vie, à rêver. Accepter de perdre son temps, c’est en quelque sorte se dépouiller des peurs qui s’entassent au fond de nous et finissent par nous asphyxier. Le véritable leurre n’est pas toujours celui qu’on croit, nous rappelle Christian Bobin dans « Le thé sans le thé », réflexion sur la propension des adultes à tout prendre au sérieux, à commencer par eux-mêmes, à parler pour l’unique plaisir de s’entendre psalmodier, pour se conforter dans leurs certitudes, comme en témoignent ces deux psychologues venus livrer leur pensée dans le cadre d’un colloque sur la psychothérapie familiale. Rien de tel pour enterrer la parole vivante, pour lui ériger un mausolée de première classe. À ce monde obnubilé par sa propre image, Christian Bobin oppose le jeu d’enfants venus prendre le thé au fond d’une cour, où le désir suffit à faire naître des volutes au-dessus de chaque tasse.
Pour écrire, rappelle Christian Bobin, il faut accepter de se mettre en position de vulnérabilité. Ne pas tant chercher à percer des mystères qu’à capter la lumière qui émane de partout autour de nous. « Tout le mal dans cette vie provient d’un défaut d’attention à ce qu’elle a de faible et d’éphémère9. »
Ailleurs encore : « Écrire, c’est avoir une très haute conscience de soi-même, et c’est avoir conscience que l’on n’est pas à cette hauteur, que l’on n’y a jamais été10. »
Voilà. Lire Christian Bobin, c’est à son tour accepter de se mettre en situation de vulnérabilité, c’est accepter de prendre le thé sans thé. C’est peut-être surtout le relire, soulignant des phrases, en recopiant d’autres, en récitant d’autres encore pour le seul plaisir de les entendre à voix haute. Pour le seul plaisir des petites étincelles qui jaillissent par moments au détour d’une phrase. Pour le seul plaisir.
1. Autoportrait au radiateur, par Christian Bobin, Gallimard, 1997, p. 164.
2.Souveraineté du vide suivi de Lettres d’or, par Christian Bobin, Gallimard, 1995, p. 29.
3. Autoportrait au radiateur, op. cit., p. 101 et 102.
4. Ibidem, p. 10.
5. Ibidem, p. 25.
6. La folle allure, par Christian Bobin, Gallimard, 1995, p. 63.
7. Souveraineté du vide suivi de Lettres d’or, op. cit., p. 56.
8. La part manquante, par Christian Bobin, Gallimard, 1989, p. 56.
9. L’inespérée, par Christian Bobin, Gallimard, 1994, p. 111.
10. Souveraineté du vide suivi de Lettres d’or, op. cit., p. 82.
Christian Bobin a publié entre autres :
Souveraineté du vide, Fata Morgana, 1985 ; L’homme du désastre, Fata Morgana, 1986 ; Lettres d’or, Fata Morgana, 1987 ; La part manquante, Gallimard, 1989 ; La femne à venir, Gallimard, 1990 ; Éloge du rien, Fata Morgana, 1990 ; Une petite robe de fête, Gallimard, 1991 ; L’épuisement, Le temps qu’il fait, 1992 ; Isabelle Bruges, Le temps qu’il fait, 1992 ; Un livre inutile, Fata Morgana, 1992 ; Le très-bas, Gallimard, 1992 ; L’éloignement du monde, Lettres Vives, 1993 ; L’inespérée, Gallimard, 1994 ; L’homme qui marche, Le temps qu’il fait, 1995 ; La folle allure, Gallimard, 1995 ; La plus que vive, Gallimard, 1996 ; Mozart et la pluie/Un désordre de pétales rouges, Lettres Vives, 1997 ; Autoportrait au radiateur, Gallimard, 1997 ; L’enchantement simple, Lettres Vives, 1997 ; Donne-moi quelque chose qui ne meure pas, avec Edouard Boubat, Gallimard, 1998 ; L’équilibriste, Le temps qu’il fait, 1998 ; Geai, Gallimard, 1998 ; La présence pure, Le temps qu’il fait, 1999.