André Langevin est de ces romanciers canadiens-français dont l’œuvre commande à la fois une relecture et un certain brio éditorial afin de ne pas sombrer dans la partie fantomatique du canon littéraire.
Pensons à la série de rééditions en format poche qui a permis à Gilbert La Rocque de ressurgir dans toute sa majesté postmoderne. Après la boue, Serge d’entre les morts et Les masques – qui fut aussi l’objet d’une édition critique – se sont ainsi affirmés comme des œuvres très peu datées, hautement stimulantes pour les romanciers actuels en quête d’une écriture forte. Pensons également à Gérard Bessette, pour qui un tel travail demeure encore à effectuer. Victime d’un succès qui l’a dépassé, celui du « maudit Libraire », comme il l’appelait lui-même, il a ainsi vu tomber plus ou moins dans l’ombre La bagarre, mais aussi l’étonnante expérimentation qu’est Les anthropoïdes, alors que Les pédagogues, souvent considéré comme mineur, est un exemple précoce de ce qu’on nomme aujourd’hui un campus novel (bien que l’action émane du corps professoral d’un collège). Quant à Langevin, il a fallu un certain purgatoire et sa mort en 2009 avant que les éditions du Boréal ne prennent en main une meilleure promotion de sa production romanesque.
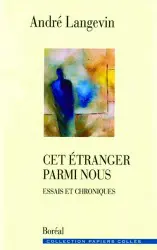 Tout comme Bessette, Langevin a terminé sa carrière littéraire longtemps avant sa disparition, gardant un silence romanesque final de trente-cinq ans (dix de plus que Bessette). Comme les deux autres, il avait subi l’influence du nouveau roman et considérablement complexifié ses structures narratives (il suffit de comparer Poussière sur la ville avec L’élan d’Amérique pour constater le contraste), une évolution qui ne facilitera pas nécessairement l’inscription durable de l’œuvre comme un tout.
Tout comme Bessette, Langevin a terminé sa carrière littéraire longtemps avant sa disparition, gardant un silence romanesque final de trente-cinq ans (dix de plus que Bessette). Comme les deux autres, il avait subi l’influence du nouveau roman et considérablement complexifié ses structures narratives (il suffit de comparer Poussière sur la ville avec L’élan d’Amérique pour constater le contraste), une évolution qui ne facilitera pas nécessairement l’inscription durable de l’œuvre comme un tout.
Maintenant qu’on relit Langevin, on peut également le découvrir en tant qu’essayiste, grâce à une première édition de ses écrits publiés dans divers périodiques entre les années 1940 et 1970. Préparée par Karim Larose, professeur à l’Université de Montréal, l’anthologie Cet étranger parmi nous1 offre une coupe minutieuse dans cette production, avec un souci de ne conserver que les textes comportant une valeur littéraire minimale. Il en résulte un autoportrait indirect de Langevin, de même qu’un outil privilégié pour qui veut comprendre plus avant la place de cet écrivain dans son époque, ce qui permettra d’approfondir sous certains angles l’interprétation de ses œuvres de fiction.
Une résistance à la folklorisation
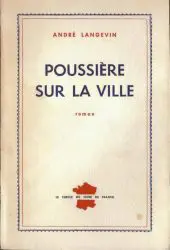 Malgré la tripartition qu’on trouve dans la présentation (textes de jeunesse, textes de maturité, textes épars), on pourrait regretter l’absence d’un classement supplémentaire des essais, ne fût-ce que dans la table des matières. Cela aurait peut-être rendu l’ouvrage plus pédagogique, mais en revanche, la lecture en un seul bloc quasi chronologique permet d’assister sur le vif à l’évolution d’une pensée. Les premiers textes, écrits pour le journal Le Devoir dès 1945, tiennent de l’éditorial tout en laissant sentir le regard de l’écrivain même. Se faisant l’écho lointain d’Arthur Buies, l’auteur favorise l’intellectuel laïc et se désole du décalage entre nos lettres et celles de l’Europe, tout en condamnant le pessimisme qui a cours dans certaines fictions en vogue. Cela pourrait d’ailleurs conduire à considérer autrement les destins tragiques et les ambiances souvent taciturnes de ses futurs récits. « Le rôle de l’écrivain moderne, écrit-il, est de trouver au laboureur sur sa terre une raison de travailler qui ne soit pas celle de se nourrir ; aux peines de l’ouvrier une autre raison que celle de l’argent ; à l’étudiant une autre raison à ses études que sa vie future à gagner ; à la femme qui enfante et nourrit une autre raison à son dévouement que la nécessité. » S’il constate qu’on « ne libère pas l’individu imprudemment sans qu’il en résulte une démoralisation générale », il n’en reste pas moins que son œuvre romanesque témoignera d’une épreuve constante et souvent périlleuse contre cette noirceur morale. S’il préfère Malraux à Camus, justifiant son choix par l’effroi que lui a causé le second, il semble que sa fiction hésitera davantage entre ces deux types de posture.
Malgré la tripartition qu’on trouve dans la présentation (textes de jeunesse, textes de maturité, textes épars), on pourrait regretter l’absence d’un classement supplémentaire des essais, ne fût-ce que dans la table des matières. Cela aurait peut-être rendu l’ouvrage plus pédagogique, mais en revanche, la lecture en un seul bloc quasi chronologique permet d’assister sur le vif à l’évolution d’une pensée. Les premiers textes, écrits pour le journal Le Devoir dès 1945, tiennent de l’éditorial tout en laissant sentir le regard de l’écrivain même. Se faisant l’écho lointain d’Arthur Buies, l’auteur favorise l’intellectuel laïc et se désole du décalage entre nos lettres et celles de l’Europe, tout en condamnant le pessimisme qui a cours dans certaines fictions en vogue. Cela pourrait d’ailleurs conduire à considérer autrement les destins tragiques et les ambiances souvent taciturnes de ses futurs récits. « Le rôle de l’écrivain moderne, écrit-il, est de trouver au laboureur sur sa terre une raison de travailler qui ne soit pas celle de se nourrir ; aux peines de l’ouvrier une autre raison que celle de l’argent ; à l’étudiant une autre raison à ses études que sa vie future à gagner ; à la femme qui enfante et nourrit une autre raison à son dévouement que la nécessité. » S’il constate qu’on « ne libère pas l’individu imprudemment sans qu’il en résulte une démoralisation générale », il n’en reste pas moins que son œuvre romanesque témoignera d’une épreuve constante et souvent périlleuse contre cette noirceur morale. S’il préfère Malraux à Camus, justifiant son choix par l’effroi que lui a causé le second, il semble que sa fiction hésitera davantage entre ces deux types de posture.
Préoccupé par la sempiternelle question de l’ici et de l’ailleurs, l’auteur se rapprochera plus tard des positions du Frère Untel. Appelant de tous ses vœux la création d’institutions culturelles autonomes, il se montre en effet réticent à une valorisation sans réserve des mœurs et du parler locaux, et encore plus à une image puérile de la collectivité. Cela donne un beau moment d’emportement à propos de « l’immortel et succulent navet » Aurore, l’enfant martyre, dont il constate avec effroi qu’il sera représenté aux États-Unis dans une version traduite. « L’on s’étonnera après cela, écrit-il, de l’étrange réputation dont jouit notre province à l’étranger. Ceux qui ont fait ça méritent d’être cloués au pilori pour le reste de leur vie. » S’il reconnaît une âme typiquement canadienne, elle s’avère pour lui sujette au changement, sous l’effet de diverses circonstances que l’écrivain doit s’affairer à illustrer, mais avec ce soupçon de recul qui, justement, fait de l’artiste un étranger parmi nous. Il ne suffit donc pas de concourir à la création d’une littérature nationale : encore faut-il lui confier les plus grandes aspirations, exiger d’elle une tension vers l’universel. « Et puis, écrit-il en 1956, on s’occupe peut-être trop de nos écrivains […]. Serait-il possible de les rayer de la liste des bonnes causes ? Cela leur donnerait peut-être confiance. »
Conscient de l’incomplétude de la Révolution tranquille, habité par des idéaux communistes mais affectionnant par-dessus tout la parole démocratique, André Langevin est certes un écrivain à idées, mais celles-ci n’ont rien de fixe. D’où l’admiration éloquente qu’il porte à Hubert Aquin, maître des masques, « poète de la déflagration » et « desperado désarmé », dont les mystifications successives pourraient selon lui offrir un outil contre le mensonge généralisé. Hostile au désespoir plus équivoque de Réjean Ducharme, dont il regrette que son succès en France ait porté ombrage à Prochain épisode, il persiste à dénicher le noyau tendre du labyrinthe aquinien. « Je ne prétends pas posséder la clé de cette œuvre ni de cet ami qui avait la confidence rare et fausse, mais je sais qu’un prisonnier se terrait dans la profondeur de la machine cérébrale qu’il donnait volontiers en représentation, qu’un enfant inconnu, qui n’avait pas surmonté la terreur de vivre, avait les bras coupés, et qu’il s’épuisait en ruses pour ne pas l’affoler. »
Ces lignes de 1977 concordent admirablement avec le roman final de Langevin, Une chaîne dans le parc, publié trois ans plus tôt et qui approfondit l’idéal de l’enfance comme rempart contre le cynisme. Dans cette forme de testament qu’est le discours de réception du prix Athanase-David en 1998 – texte inédit présent dans cette anthologie –, il rappellera d’ailleurs combien, à sa sortie de huit ans d’orphelinat, la générosité de certains lui demeura fondatrice. Cela, non sans y aller d’une dernière salve à l’endroit de l’abêtissement collectif auquel lui semblent concourir quelques mandarins des institutions culturelles québécoises.
1. André Langevin, Cet étranger parmi nous, Boréal, Montréal, 2015, 264 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Pourquoi ne pas avouer carrément que nous avons plus en commun avec les écrivains des États-Unis qu’avec ceux de la France ? Ceux-là éclairent une réalité qui nous est plus proche que celle de ceux-ci. Faut-il souligner, par ailleurs, que devant la page blanche la volonté de « faire » français ou américain est le plus grand malheur qui puisse arriver à un écrivain. Il perd du coup son authenticité.
p. 93
Coincé entre l’hostilité du clergé pour toute instruction qu’il n’avait pas lui-même dispensée et le mépris de l’habitant, aussi fier de son ignorance que de la terre à ses talons, l’intellectuel laïc, qui n’avait même pas la ressource d’enseigner les humanités, sans parler de celle de s’exprimer par l’écrit, devait consentir à s’amoindrir pour subsister aux niveaux les plus humbles et les plus utilitaires de la société. On ne pourra jamais mesurer l’appauvrissement de l’âme et de l’esprit qu’exige une telle soumission.
p. 105
Je ne sais s’il est permis à un écrivain qui s’éloigne de son œuvre d’exprimer des inquiétudes, mais nous avons fait trop de chemin pour ne pas frémir en entendant des enseignants, des linguistes, des universitaires fonder notre originalité en terre d’Amérique sur l’invention d’un français sans grammaire, sur un dialecte sans écriture et incompréhensible aux autres. Nous sortons à peine d’un ghetto imposé par une autre langue qu’on veut à nouveau nous enfermer.
p. 260










