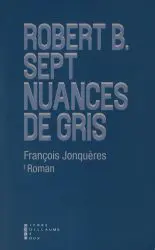Est-ce cela le courage, d’attendre le nom du vainqueur pour accabler le vaincu ?
François Jonquères, Robert B., sept nuances de gris
Avocat, admirateur des Hussards, ces jeunes romanciers insolents des années 1950 regroupés autour de Roger Nimier, François Jonquères publiait en 2019, après La révolution buissonnière et Voix de fées, un troisième roman, Robert B., sept nuances de gris1.
Le personnage du titre, c’est Robert Brasillach2, brillant écrivain mais journaliste abject fusillé le 6 février 1945 pour intelligence avec l’ennemi, moins d’un an après la Libération. Ni son avocat ni François Mauriac et d’autres écrivains n’avaient convaincu le général de Gaulle de commuer la peine de mort prononcée contre l’écrivain. Le romancier Jonquères milite pour la réhabilitation de l’œuvre littéraire de Brasillach, ostracisée en raison de la position idéologique du journaliste de Je suis partout, hebdomadaire antisémite et collaborationniste. Si l’œuvre fictionnelle de Brasillach n’a pas la grandeur de celle de L.-F. Céline ou des Deux étendards, monumental roman du collègue Lucien Rebatet3 à Je suis partout, il est pourtant évident qu’elle ne mérite pas l’oubli qu’on lui impose depuis très longtemps. L’enfant de la nuit (1934), Comme le temps passe (1937) ou Les sept couleurs (1939), ces dernières renvoyant à sept techniques narratives qui composent le roman, ont conservé quelque chose d’enchanteur et de captivant.
François Jonquères met en scène des personnages qui vont prendre la défense de l’écrivain et chercher à réhabiliter son œuvre, et donc lui permettre de faire flèche de tout bois dans son apologie de Brasillach. Cela se fait habilement autour d’une histoire forte en aventures, imprévisible.
Le roman s’ouvre sur la rencontre de ses deux principaux personnages à bord d’un camion qui, à travers les routes clandestines des Pyrénées, conduit nuitamment des Juifs en Espagne. Cette traversée est en réalité un guet-apens dont ne sortira sauve qu’une jeune fille, Esther ; et ce passe-droit, elle le doit au roman de Brasillach qu’elle est en train de lire et à sa candeur, à une attitude qui a séduit celui qui est responsable de cette traversée, Valérius. Cet homme est un mercenaire redoutable et sans scrupules : s’il a choisi de s’engager auprès des fascistes, il est aussi un grand admirateur des livres de Brasillach. Et cela peut peser lourd sur le destin.
Depuis les années de l’Occupation jusqu’à la guerre d’Algérie, on suit ces personnages dans le feu des événements et de leurs tourments. Car Valérius trouvera son chemin de Damas lors de la guerre d’Indochine, quand il fera la découverte d’enfants affreusement mutilés. Ce moment où l’horreur appelle enfin la lumière le transforme complètement, lui donne accès à la bonté, à une part d’humanité en lui qu’il avait toujours ignorée, refoulée. Mais que sa faiblesse auprès d’Esther, au début du roman, laissait présager. Il était dès lors écrit qu’ils devaient un jour se retrouver pour le meilleur.
Valérius et Brasillach ont sans doute quelque chose en commun : ils ont pactisé avec le mal. Bien que le mal fasse couler le sang chez Valérius le carnassier, cependant qu’il appelait le sang chez l’écrivain Brasillach ; l’un agit, l’autre trempait sa plume dans le vitriol. Et si Valérius devient « bon » au terme de son évolution morale, Brasillach, radicalisé par les circonstances historiques, a en quelque sorte connu le cheminement inverse. Ces croisements de vie, mais aussi le parcours tortueux de Valérius lui-même, qui est passé du noir au blanc, permettent à Jonquères de montrer la relativité des choses, des événements et des hommes, qui seront toujours plus complexes que toute forme de justice commandée par le pouvoir politique.
Ce qui soulève par ricochet quelques questions essentielles qui débordent le roman, au premier chef celle touchant à la décision de fusiller un écrivain pour ses opinions. Car Brasillach n’a tué personne. « Depuis quand la liberté d’expression constitue-t-elle un délit en France ? » demande Valérius. Corrélativement, concevoir pour la France une autre forme de régime politique, est-ce un crime ? C’est André Thérive, autre magnifique romancier de l’entre-deux-guerres4, quant à lui placé sur la liste noire dressée par le Comité national des écrivains en 1944, qui demandait dans son Traité de l’intolérance (1948) : « L’autre année dans un procès qui ne fut pas sans émouvoir la France, car on y poursuivait un jeune écrivain qui ne tarda pas à être fusillé, l’avocat de cet inculpé de marque s’écria, dans le feu de sa péroraison : ‘Est-ce que la République n’est pas d’abord le droit de n’être pas Républicains ?’5 » Question troublante qui interroge, dans un raccourci saisissant, les limites de la démocratie. Question par ailleurs on ne peut plus actuelle, toutes proportions gardées entre le contexte de l’Occupation et notre époque.
Évidemment, la teneur des articles de Brasillach aura inévitablement contribué à enflammer la haine et la violence en ces temps pour le moins troublés. Encore que cela n’est pas quantifiable, pas plus que n’est parfaitement mesurable le positionnement des uns et des autres à l’égard de la collaboration, compte tenu de la multiplicité et de la complexité des formes prises par celle-ci au gré des circonstances, des tempéraments, des croyances individuelles et des élans collectifs. Les choses ont la plupart du temps la couleur du gris, et s’il existe une vérité en toute chose, toute loi est faillible. Il faut du reste avoir lu les romans de Brasillach pour comprendre tout le romantisme de sa posture, laquelle était marquée par un manque paternel fondamental et une profonde nostalgie du passé qui lui avaient fait rechercher un ordre fort. Cela ne justifie rien, mais fait comprendre certaines choses. Collabo, Brasillach se caractérisait plus profondément par une sensibilité en quête de grandeur, d’héroïsme et de sens que son pays ne lui offrait pas ou que, du moins, il ne savait pas (ou plus) y trouver. Une manière de voirque l’Histoire lui refusa violemment.
Par rapport à des événements qui engagent l’avenir d’un État, jusqu’où va la responsabilité de l’écrivain ? Je citerai encore André Thérive, cette fois-ci dans son Traité de la délation (1947) : « Lorsque le malheureux Robert Brasillach écrivait, dans son article lu par deux cent mille personnes : ‘Qu’attend-on pour fusiller les otages communistes ?’. Il ne croyait peut-être pas donner un conseil au gouvernement d’alors. Il n’eût sans doute jamais signé un ordre d’exécution si brusquement on l’eût nommé ministre. Il pensait encore bien moins que le fossé de Montrouge l’attendait, reconventionnellement, lui-même par un matin d’hiver ». Et Thérive, amer, d’ajouter avec sa perspicacité habituelle : « Nous devons d’ailleurs distinguer ce genre de dénonciation collective qu’il [Brasillach] avait commis, et dont la légèreté fut irréparable, de la délation personnelle, explicite, où peu de gens de lettres ont cédé avant la Révolution de 1944, mais qu’ils pratiquent depuis lors couramment6 ». Certes, deux poids deux mesures, mais en temps de guerre, peut-il en être autrement ? Le vainqueur ne fait pas qu’écrire l’histoire, il a aussi pour lui la vérité.
Il en fut ainsi et il en sera toujours ainsi tant que la vérité sera considérée comme un absolu, alors qu’elle est une construction idéologique. L’idéologie comme absolu, alors ? Oui, et c’est bien cela qui est dangereux. Il ne faut surtout pas l’oublier, d’autant plus aujourd’hui, alors que de nouvelles formes de censure et de dictature de l’esprit nous font la vie dure. À travers ce tumulte, la littérature, comme toujours, et Brasillach, à jamais.
François Jonquères a publié :
La révolution buissonnière, Pierre-Guillaume de Roux, 2016 ; Voix de fées, La Thébaïde, 2018 ; Robert B., sept nuances de gris, Pierre-Guillaume de Roux, 2019 ; Nouvelles de mes nuits, Balland, 2019 ; Michel Déon, Duetto, 2019.
1. François Jonquères, Robert B., sept nuances de gris, Pierre-Guillaume de Roux, Paris, 2019, 280 p.
2. Voir l’article consacré à Robert Brasillach dans la rubrique « Écrivains méconnus du XXesiècle » dans le numéro de l’automne 2000 (Nuit blanche, no80).
3. Voir l’article consacré à Lucien Rebatet dans la rubrique « Écrivains méconnus du XXe siècle » dans le numéro de l’été 2016 (Nuit blanche, no 143).
4. De Thérive, on lira Anna, remarquable roman de 1932 qu’ont réédité en janvier 2020 les éditions La Thébaïde.
5. Publié sous le pseudonyme de Romain Motier, Traité de l’intolérance, La Couronne, Paris, 1948, p. 108.
6. Publié sous le pseudonyme de Romain Motier, Traité de la délation, Aux dépens des Amis de Romain Motier, 1947, p. 113-114.