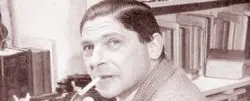C’était une prison extrêmement humaine, et presque aimable – pique-nique au bord des tombes.
Un testament espagnol, 1939
Arthur Koestler1 est né le 5 septembre 1905 – la même année que Jean-Paul Sartre – à Budapest. Il est issu de l’« ancien monde » façonné par l’Empire austro-hongrois,qui chapeautait une mosaïque de nations. Son père était hongrois, sa mère autrichienne, l’un de ses grands-pères russe et l’autre tchèque. C’est dire qu’il est né à la croisée d’univers et de cultures – la Mitteleuropa – qui en feront un intellectuel unique au siècle passé.
La chute de l’Empire, sa dévastation par la Grande Guerre vont initier Koestler à une « pédagogie du Mal », celui-ci parcourant tout le vingtième siècle – sa première moitié, en particulier – dans ses divers fascismes, totalitarismes et génocides. L’histoire va ainsi entrer dans sa vie « noire de poudre et rouge de sang ». Comme il l’écrira lui-même dans son autobiographie : « Je suis né au moment où le soleil se couchait sur l’âge de la raison ». Les chemins de l’histoire sont énigmatiques, sinon erratiques
Pérégrinations d’un écrivain dans le siècle
Comme plusieurs de ses contemporains, il sera fasciné par le communisme comme « principe espérance » (il rompra avec le Parti communiste en 1939, à cause de ses excès et limites : on ne cerne pas sottement, dira-t-il, la condition humaine). Lorsque Arthur Koestler, avec sa famille, arrive à Vienne en 1919, l’antisémitisme – toutes classes sociales confondues – sera en train de vampiriser la vieille Europe et la Russie. On peut déjà deviner contre quoi Arthur Koestler se battra toute sa vie : contre toutes les « puissances maléfiques » désirant asservir l’humain. En 1923, il deviendra sioniste et s’engagera dans la lutte pour la création d’un État juif ; il participera, vers 1926, à la mise sur pied d’un kibboutz en Palestine. Attiré par le journalisme, comme beaucoup d’intellectuels de son temps, il contribuera à créer le journal sioniste Zafon et sera correspondant de presse au Caire et à Paris. En tant que « Juif assimilé », Koestler fera preuve assez tôt d’un esprit plutôt cosmopolite, à la manière de ses goûts littéraires issus de sa mosaïque originelle. C’est en 1930 qu’il reviendra à Berlin et assistera à la première grande victoire du Parti nazi au Reichstag : 107 députés seront élus.
Arthur Koestler, on l’a évoqué, a adhéré au Parti communiste allemand pour s’en détacher par la suite. À la demande de l’Organisation internationale des écrivains révolutionnaires (MORP), il aura d’ailleurs l’occasion de visiter l’ensemble du territoire soviétique. Lors de son séjour à Kharkhov en Ukraine, il sera témoin de la grande famine provoquant la mort de sept millions de personnes. Le Kominterm lui ordonnera, en 1933, de revenir en Europe occidentale : c’est le début des grandes « croisades antifascistes », de la lutte contre les dictatures, la terreur hitlérienne en particulier. Mais Arthur Koestler est essentiellement un « écrivain » plutôt qu’un « fonctionnaire » du Parti communiste : il envisage ainsi la création de son roman Spartacus. Et Un testament espagnol n’est pas très loin
En 1936, la guerre civile espagnole l’interpellera comme journaliste au News Chronicle : le fameux roman va naître de son engagement et d’un emprisonnement. Il a dû rencontrer le général franquiste Queipo de Lhano à Séville et, par la suite, enquêter à Madrid sur l’éventuelle participation de l’Allemagne nazie ainsi que de l’Italie de Mussolini à la préparation du Pronunciamiento instaurant Franco « dictateur à vie ». Il sera arrêté à Málaga en 1937 quand les nationalistes prendront la ville. Il publiera Un testament espagnol la même année après un court et pénible séjour en prison : il aura tout de même été condamné à mort par les franquistes ! Un échange de prisonniers le sauvera.
Les procès truqués de Moscou le pousseront à s’éloigner définitivement des communistes, ce qui lui permettra d’achever Spartacus et d’amorcer la rédaction du Zéro et l’infini : nous sommes en 1938. Il sera encore arrêté l’année suivante, à Paris, peu après la déclaration de guerre, et interné quelque temps comme « étranger indésirable » au camp du Vernet situé dans les Pyrénées. Le zéro et l’infini paraîtra à Londres en 1940, à la suite de multiples arrestations et internements Croisade sans croix, dernier volet d’une trilogie incluant Spartacus et Le zéro et l’infini, sera publié en 1943. Ce roman évoque, aussi, les monstruosités propres à tous les fascismes quels qu’ils soient peu importe leurs origines et leurs visages
L’année 1946 sera un moment charnière, celui de la rencontre de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, d’Albert Camus ainsi que de Raymond Aron. Mais les communistes et l’intelligentsia française auront de la difficulté à saisir une pensée ne se laissant pas figer dans un système, même si elle dénoncera des aliénations connues. La proclamation de l’État d’Israël est effective en 1948 ; Koestler choisira la nationalité britannique après un bref séjour aux États-Unis. C’est aussi à ce moment qu’il va rompre avec toutes les « modes intellectuelles » – dont l’aventure sartrienne – et promouvoir la « liberté de la culture ». Il s’installera définitivement à Londres en 1952, et se consacrera à son autobiographie (Arrow in the Blue, 1952 ; The invisible Writing, 1953). C’est l’époque des voyages en Orient, de la publication, en 1960, de l’ouvrage Le lotus et le robot, après une pénétrante réflexion sur les sciences – en plus d’une incursion dans le domaine de la parapsychologie –, fondant Les somnambules (1958). En 1977 il sentira les premiers symptômes de la maladie de Parkinson et, en 1981, une leucémie lymphoïde le terrassera. Il mettra fin à ses jours, auprès de sa compagne Cynthia, dans sa résidence de Montpelier Square à Londres en 1983, à l’âge de 78 ans.
Quant aux « prisons de l’histoire », elles surgissent des zones grises d’une humanité prenant, hélas, trop souvent de dangereux, d’affreux « détours » en ce qui a trait à la nécessité, pour l’humain, de s’accomplir Cette humanité qui s’offre en « parade sauvage », en cirque grotesque. « Tous s’évadaient de leur passé et aspiraient à un rivage sûr pour l’avenir ; le présent dans lequel ils vivaient était un no man’s land entre les deux ; c’était cela sans doute qui leur donnait cette apparence de fantôme, cet air d’irréalité Leur voyage ressemblait à une excursion d’aveugles2. »
De la guerre civile espagnole
Si l’« univers est un endroit sauvage », comme l’a écrit Boris Pasternak, la lutte des nationalistes et des républicains en Espagne, en 1936, est très révélatrice. En effet, le roman Un testament espagnol – qui peut se lire comme un journal – rend compte de la guerre civile espagnole à laquelle Koestler, comme journaliste, a participé à sa manière, à Málaga en particulier. Sous des airs de « fiction », ce roman est la chronique d’un enfermement et, potentiellement, d’une condamnation à mort.
Arthur Koestler amorce son œuvre en nous disant qu’aucun « des personnages de ce récit n’est imaginaire ». Lui-même, comme journaliste-écrivain, envoyé spécial à Málaga par le News Chronicle de Londres, sera arrêté et condamné à mort par les franquistes à la suite de la prise de Málaga. Un testament espagnol se présente comme une variation sur la peur de mourir dans un univers qui ne concerne en rien le personnage. Il va ainsi attendre pendant quatre mois d’être exécuté, et jour après jour il rendra compte de sa condition de prisonnier sur le point d’être effacé de l’histoire Des images de chaos vont surgir, s’imposant contre la raison du narrateur. Une « horreur archaïque » effrayera tout un chacun dans cette chronique quasi infernale. Et tout cela se vivra dans le silence propre d’une prison quelconque de Málaga, sur fond de guerre civile. La lumière sera même qualifiée de « sale », infiltrant une cellule qui « était comme un cercueil triplement plombé, entourée qu’elle était des trois murailles du silence, de la solitude et de la peur ».
Une grande souffrance morale, un malaise de l’être vont s’imposer au « prisonnier » qui vit, raconte. Roubachof, dans Le zéro et l’infini, supportera, lui aussi, tout cela comme esclave d’une existence carcérale. Koestler dira même que ces « habitudes de pensée » dominent autant le prisonnier que l’être dit « libre ». « Quand j’écrivais mon roman sur la guerre des gladiateurs, je m’étonnais continuellement que les esclaves de Rome, deux fois, trois fois plus nombreux que les hommes libres, n’aient pas renversé les rôles. Je commence à entrevoir ce que c’est que l’état d’esprit de l’esclave. Je souhaite à tous ceux qui parlent de psychologie des foules l’expérience d’un an de prison. Je n’avais jamais cru que la dictature d’une minorité pût se maintenir à la seule pointe des baïonnettes. Mais je ne savais pas le pouvoir de ces forces ataviques qui paralysent par l’intérieur l’action de la majorité. Maintenant, je sais3. »
Et l’on peut comprendre pourquoi l’écrivain américain William Burroughs a pu crier : « Prisonniers de la terre – sortez ».
Les procès truqués de Moscou
Arthur Koestler commence Le zéro et l’infini en spécifiant que ses personnages sont imaginaires mais que les circonstances historiques sont, quant à elles, authentiques. Le régime soviétique a fait mentir l’histoire afin d’éliminer des éléments gênants. Ce roman est une allégorie représentant la terreur stalinienne qui effaçait de la mémoire collective, du décor de l’histoire, ce qui la « dérangeait » : « Le Parti n’a jamais tort » Chacun n’aura qu’à se soumettre, car l’histoire « connaît son chemin ». Roubachof tourne en rond dans son cachot. Qui est fautif ? Lui, un des fondateurs du parti de la révolution ? Ou bien les « détours » obscurs de celle-ci ?
Il a bien le temps de réfléchir avant l’élimination. Il peut aussi, curieusement, sortir de la substance et de l’anonymat de l’histoire, surtout de ce parti qui le condamne arbitrairement ou par nécessité. Pourquoi les germes d’une société nouvelle ont-ils produit une scandaleuse horreur ? Ou est-ce, tout simplement, comme le crie Kurtz, l’indéfinissable « héros » d’Au cœur des ténèbres (1902) de Joseph Conrad : « L’horreur ! L’horreur ! » Roubachof se dit : « Nous avons creusé dans la boue primitive de l’histoire et nous y avons découvert ses lois. Nous connaissons l’humanité mieux qu’aucun homme ne l’a jamais connue ; voilà pourquoi notre révolution a réussi. Et maintenant, vous avez tout fait rentrer sous terre ». Tout va ainsi sombrer dans un odieux mensonge. Et celui-ci servira-t-il mieux la supposée « vérité » du moment ? Celle qui écarte certains individus pour en faire des damnés de l’histoire, brisés par la « machine-contrôle ». Mais une lumière même « sale » passe entre les barreaux
Le mouvement de l’histoire est vertigineux, il donne la nausée. « Nous semblons nous trouver, dans l’histoire, en face d’un mouvement de pendule, d’un balancement de l’absolutisme à la démocratie, de la démocratie à la dictature absolutiste. »
Une simple balle dans la nuque de Roubachof va mettre fin à son tourment et l’histoire, qui continue sans lui, est-elle si noire, si tortueuse sinon affreuse ? Quel est le sens de cette obscure « ruse de la raison » qui a tant fasciné Hegel ? « Pourquoi fallait-il que l’histoire n’eût que des cauchemars ? Pourquoi ne se réveillerait-elle pas un jour et ne suivrait-elle pas sa propre voie ? Quelle voie ? Toutes ces souffrances, ces détours tortueux qu’il fallait emprunter pour atteindre le but, n’était-ce pas la loi historique elle-même au lieu d’être un moyen vers une fin ? Le but ? N’était-ce pas une illusion volontaire que se forgeaient les hommes ? »
Spartacus ou les gladiateurs en furie
Voici un impossible rêve de liberté qui aura pour conséquence que 6000 esclaves seront mis en croix. La « détresse individuelle » se mue littéralement en « détresse universelle » – ce qu’elle est, du reste, toujours. Nous sommes en présence d’une dialectique de l’individuel et de l’universel, du particulier et du général. La différence, ici, c’est que le cachot du prisonnier de Málaga et celui de Roubachof prennent la figure de l’Empire romain, surtout de Spartacus, qui conteste l’Empire avec la grande guerre des esclaves fomentée de 73 à 71 avant notre ère, quelque part dans le sud de l’Italie. Spartacus désirera « organiser la liberté » de milliers d’esclaves et se fera lui-même, ainsi, quasiment « dictateur » dans un siècle de fer qui n’est pas tellement différent, à bien des égards, du siècle passé ou de notre début de millénaire
Spartacus et ses « bandes », en se révoltant, vont essayer de mettre sur pied, de créer une Cité idéale – la Cité du Soleil – fondée sur l’idée d’égalité, de liberté. Mais cette cité, érigée dans un univers hostile, devra elle-même adopter une discipline de fer axée sur le militarisme sinon l’impérialisme. Les travers de l’ancien monde seront recréés, et cela donnera lieu à une nouvelle servitude qui mènera cette société à sa perte : la méchanceté et la haine, en renaissant, vont tout faire échouer. L’ancien empire n’aura pas beaucoup de difficulté à abattre un idéal déjà lézardé. C’est, encore une fois, cette tournure d’esprit d’Arthur Koestler voyant un éternel retour des choses, des grandes espérances aux amères déceptions et désillusions, cela s’incarnant, dans ce roman, par la lutte à finir entre des « rebelles » échevelés et la sûre République romaine.
Et la Cité du Soleil, bâtie par des esclaves libres et un imperator déterminé, se retrouvera prise dans les « mailles invisibles » de l’ordre du monde ne pouvant totalement s’en libérer mais, somme toute, demeurant autarcique. « Non pas que chaque jour n’amenât de nouveaux transfuges au camp ; soixante-dix mille hommes avaient construit la Cité du Soleil ; elle en abrita bientôt cent mille ; mais elle restait isolée. Elle se dressait, solitaire et maussade, au pied des montagnes dans la plaine, entre le Sybaris et le Krathis ; ses habitants vivaient selon des lois qu’on eût dit importées d’une autre planète. »
La Cité du Soleil deviendra un univers oppressif, répressif, « situé » dans l’ordre ancien, hostile aux rêves. Où se trouve donc la libération dans une cité isolée, coincée à l’intérieur d’un monde hyper structuré ? L’histoire n’est-elle qu’un cul-de-sac dans lequel se fracassera le principe espérance ? C’est dire qu’il y a toujours des milliers et des milliers de murs à abattre. Arthur Koestler a, semble-t-il, constamment envisagé une nouvelle humanité, un « principe espérance », même si la liberté est « entourée de murs ». « Chaque période de gothique est peut-être suivie d’une période de Renaissance Et peut-être notre civilisation actuelle n’est-elle pas morte, mais seulement avide de rêves. » C’est à nous d’y voir, pauvres somnambules
1. Pour en savoir plus sur Arthur Koestler et son œuvre, on lira : Michel Laval, L’homme sans concessions, Arthur Koestler et son siècle, Calmann-Lévy, Paris, 2005, 706 p.
2. Arthur Koestler, Croisade sans croix, Livre de poche, 1965, p. 47-48.
3. Arthur Koestler, Un testament espagnol, Livre de poche, p. 179-180.
Arthur Koestler a publié, entre autres :
Le zéro et l’infini, Livre de poche, 1974 et 1991 ; La pulsion vers l’autodestruction, L’Herne, 1997, 2006 et 2007 ; Les militants, Mille et une nuits, 1997 ; Réflexions sur la peine capitale, avec Albert Camus, Folio, 2002 ; La treizième tribu, Tallandier, 2008.
Chez Calmann-Lévy : Le zéro et l’infini, 1994 et 2005 ; Janus, 1979 et 1994 ; Croisade sans croix, 1994 et 2005 ; Le cheval dans la locomotive, 1994 ; Le cri d’Archimède, 1994 ; L’étranger du square, 1994 ; Le démon de Socrate, 1994 ; Analyse d’un miracle, Naissance d’Israël (épuisé), 1994 ; L’ombre du dinosaure, 1994 ; Les somnambules, 1994 ; Spartacus, 1994 et 2005 ; Suicide d’une nation ?, 1994 ; Les hommes ont soif, 1994 ; Au chat qui louche 1996.
EXTRAITS
Nous suivîmes de nouveau le long corridor nu, longeant une file sans fin de portes fermées.
À travers tous les judas, de chaque côté du couloir, un œil regardait.
C’était un espalier d’yeux, de prunelles écarquillées, d’yeux sans visages ni corps.
Un testament espagnol, p. 85.
Quand je m’éveillai, je ne sus pas tout de suite où j’étais et quand je le sus je ne m’en trouvai pas mieux à travers la vitre sale de la fenêtre grillée, une lumière sale entrait dans la cellule. Un silence nu, absolu, régnait. L’air n’est ainsi muet que dans les prisons.
Un testament espagnol, p. 87.
Des souvenirs l’assaillaient ; ils bourdonnaient et bruissaient sourdement à ses oreilles. Des visages et des voix surgissaient et s’évanouissaient ; chaque fois qu’il tentait de les retenir, il lui faisaient mal ; tout son passé était devenu douloureux au toucher et suppurait au moindre contact. Son passé, c’était le Mouvement, le Parti ; présent et avenir, eux aussi, appartenaient au Parti ; mais son passé, c’était le Parti même. Et c’était ce passé qui était soudain remis en question. Le corps chaud et vivant du Parti lui apparaissait couvert de plaies – des plaies pustuleuses, des stigmates ensanglantés. Où donc dans l’histoire trouvait-on des saints aussi malades ? Une bonne cause avait-elle jamais été plus mal représentée ? Si le Parti incarnait la volonté de l’histoire, alors l’histoire elle-même était malade.
Le zéro et l’infini, p. 60-62.
Il faut trouver la cause des défaillance du Parti. Tous nos principes étaient bons, mais nos résultats ont été mauvais. Ce siècle est malade. Nous en avons diagnostiqué le mal et ses causes avec une précision microscopique, mais partout où nous avons appliqué le bistouri, une nouvelle pustule est apparue. Notre volonté était pure et dure, nous aurions dû être aimés du peuple. Mais il nous déteste. Pourquoi sommes-nous ainsi odieux et détestés ?
Le zéro et l’infini, p. 61.
Ils étaient soixante-dix mille esclaves, tous marqués au fer rouge, vomis par le destin, venus de partout, qui maintenant construisaient leur cité, charroyaient des troncs, transportaient des pierres, martelaient, sciaient, ajustaient. Leur ville devait être une ville comme on n’en aurait encore jamais vu ; elle serait la propriété des gueux, la patrie des sans-patrie, la cité libre des asservis.
Spartacus, p. 249.
Discipline et terreur ! Avons-nous combattu ? Avons-nous accumulé les victoires pour remplacer le joug d’autrefois par un autre joug ? Autrefois, nos boyaux hurlaient de faim ; aujourd’hui, ils hurlent de discipline ! La vie s’est rétrécie et avilie dans la Cité du Soleil. Où sont l’enthousiasme et l’esprit fraternel de jadis ? Le vieil abîme qui séparait le peuple de ses chefs s’est ouvert une fois de plus…
Spartacus, p. 292.