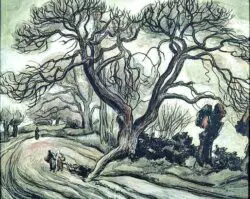Enfant prodige, Antoinette Peské (1904-1985) aurait pu connaître un brillant destin littéraire. Ses poèmes, qu’elle avait commencé à écrire à sept ans, fascinaient Apollinaire, mais celui-ci mourut avant de donner suite à son projet de les publier.
Ses romans, qu’elle écrivit seule – L’insaisissable rival (1924), La boîte en os (1941) – ou en collaboration avec son mari Pierre Marty – Ici le chemin se perd (1955), Le bal des angoisses (1957) – n’ont pratiquement pas trouvé leurs lecteurs, même si, avec leur écriture nimbée de mystère, ils soutiennent la comparaison avec les récits d’Ann Radcliffe, d’Edgar Allan Poe et de Julien Gracq.
« Une sœur inattendue d’Emily Brontë1 »
La famille Brontë est déjà bien pourvue en grandes écrivaines et pourtant, c’est à l’auteure des Hauts de Hurlevent que pense Jean-Pierre Sicre lorsqu’il réédite en 2004 L’insaisissable rival d’Antoinette Peské sous l’intrigant nouveau titre de Que cherches-tu ? Vingt ans plus tôt, la réédition de La boîte en os – « Un livre qui ne ressemble à aucun autre », selon Cocteau – avait suscité des échos positifs dans la presse. Jean Tordeur, dans Le Soir (Bruxelles), y avait vu « [u]ne insidieuse et subversive déviation vers les catégories les plus inattendues de l’étrange ». Jean-Louis Kuffer, dans Le Matin (Lausanne), déclarait que « La boîte en os nous captive d’abord, puis nous prend au piège d’une réflexion vertigineuse ». Pour autant, le nom d’Antoinette Peské ne parvint pas à émerger de l’anonymat qui pèse toujours contre elle 30 ans après sa mort.
Le patronyme sera toutefois familier aux amateurs de peinture, qui penseront au peintre postimpressionniste Jean Peské, élève de Pissarro et ami de Sérusier, Signac et Toulouse-Lautrec. Il était le père d’Antoinette. Né Jan Mirosław Peszke dans une petite ville de la goubernia de Kherson dans l’Empire russe en 1870, il avait émigré en France en 1891 et y avait vécu jusqu’à sa mort survenue au Mans en 1949. On sait peu de choses au sujet de la mère d’Antoinette, Catherine Louchnikoff, sinon qu’elle est née à Kiakhta en 1870, qu’elle était sculptrice et qu’elle mourut à Paris en 1934. Myrrha Claudine Antoinette (c’est son nom complet) aurait eu deux sœurs (Marie, Hélène) et un frère (Alexis).
Monsieur Apollinaire et l’enfant poète
En juin 1914, Antoinette n’était encore qu’une fillette quand la galerie Malpel à Paris exposa des poèmes et des dessins qu’elle avait réalisés à l’âge de huit ans2. Apollinaire, qui s’était lié d’amitié avec Jean Peské et fréquentait son atelier, voulut voir les cahiers où Antoinette consignait des poèmes qu’elle signait « Claudine Peské » et qu’elle illustrait de dessins colorés. Le poète d’Alcools, y décelant « la simplicité et l’art délicat de quelques poètes du XVIe siècle3 », fut fasciné au point qu’il lui promit de les publier à La Sirène, la maison d’édition fondée par Paul Laffitte en mars 1917. L’écrivaine raconte : « Je reverrai toujours Guillaume Apollinaire dans son costume bleu horizon de lieutenant, sa tête blessée serrée par des courroies (il avait subi à deux reprises l’opération du trépan), assis sur un méchant tabouret avec mes cahiers de poésie ouverts sur ses genoux. Il lisait à voix haute les poèmes qu’il avait particulièrement aimés et je ne reconnaissais pas mes vers. Je l’écoutais, assise sur un coussin à ses pieds. De temps en temps, mon père me soufflait à l’oreille : ‘Tiens-toi droite… Ne mets pas la main sur le genou de Monsieur Apollinaire…’ Monsieur Apollinaire une fois l’entendit et lui répondit : ‘Laissez-la rester une enfant. Tant de vieux ‘font’ les enfants4…’ »
La mort du poète, survenue le 9 novembre 1918, l’empêcha d’honorer sa promesse : « Guillaume Apollinaire mourut de la grippe espagnole le jour où nous devions aller ensemble à ‘La Sirène’ pour signer. Je pleurai mon premier grand ami5… » Peu après, Antoinette délaissa l’écriture poétique pour composer des contes. Cette réorientation vers la forme narrative est significative puisque c’est avant tout en tant que romancière qu’Antoinette Peské laissera sa marque en littérature.
Un amour inavouable
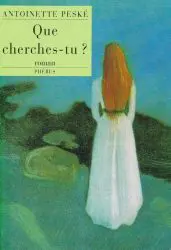 Son premier roman, achevé à dix-huit ans, paraît à partir d’octobre 1924 dans La Grande Revue. Cette publication juridique créée par Fernand Labori avait été investie par Jacques Rouché d’un caractère culturel. Gide, Giraudoux, Renard et Shaw y collaborèrent. Suarès, en plus d’y tenir une chronique littéraire, y fit paraître Le voyage du condottière. Antoinette n’aimait pas le titre de L’insaisissable rival qui lui fut imposé au moment de mettre sous presse. Aussi, quand Jean-Pierre Sicre exhuma ce texte pour le publier chez Phébus 80 ans plus tard, opta-t-il pour un autre intitulé, « mieux conforme au souhait de l’auteur ». Ce nouveau titre provient en effet de la fin du récit, quand la narratrice évoque un amour malséant : « Que veux-je au juste ? Que cherches-tu ? / Ah ! c’est le parfum du flacon clos dont j’ai respiré un jour l’odeur enivrante et mystérieuse… C’est le parfum que j’eusse désiré et que vous avez emporté, Edward, dans la tombe ! » La narratrice s’adresse ici à Sir Edward O’Perk, le propriétaire du lugubre château du nord de l’Angleterre où, jeune Française tout juste sortie du collège, elle était entrée comme institutrice. Les O’Perk formaient un couple mal assorti. Sir Edward, avoué à la Cour de Newcastle et Irlandais d’origine, était passionné de littérature. Sa femme, Mrs O’Perk, était quant à elle hostile aux livres, à la musique et à l’art. Elle semblait avoir inculqué à Hester, leur fille unique de cinq ans, une haine profonde de son père.
Son premier roman, achevé à dix-huit ans, paraît à partir d’octobre 1924 dans La Grande Revue. Cette publication juridique créée par Fernand Labori avait été investie par Jacques Rouché d’un caractère culturel. Gide, Giraudoux, Renard et Shaw y collaborèrent. Suarès, en plus d’y tenir une chronique littéraire, y fit paraître Le voyage du condottière. Antoinette n’aimait pas le titre de L’insaisissable rival qui lui fut imposé au moment de mettre sous presse. Aussi, quand Jean-Pierre Sicre exhuma ce texte pour le publier chez Phébus 80 ans plus tard, opta-t-il pour un autre intitulé, « mieux conforme au souhait de l’auteur ». Ce nouveau titre provient en effet de la fin du récit, quand la narratrice évoque un amour malséant : « Que veux-je au juste ? Que cherches-tu ? / Ah ! c’est le parfum du flacon clos dont j’ai respiré un jour l’odeur enivrante et mystérieuse… C’est le parfum que j’eusse désiré et que vous avez emporté, Edward, dans la tombe ! » La narratrice s’adresse ici à Sir Edward O’Perk, le propriétaire du lugubre château du nord de l’Angleterre où, jeune Française tout juste sortie du collège, elle était entrée comme institutrice. Les O’Perk formaient un couple mal assorti. Sir Edward, avoué à la Cour de Newcastle et Irlandais d’origine, était passionné de littérature. Sa femme, Mrs O’Perk, était quant à elle hostile aux livres, à la musique et à l’art. Elle semblait avoir inculqué à Hester, leur fille unique de cinq ans, une haine profonde de son père.
Même s’il ne recèle pas la maîtrise des romans ultérieurs, Que cherches-tu ? en impose par sa singulière tonalité, où un onirisme gothique confère aux terres embrumées du Northumberland un halo fantastique. « Finement pervers », selon Pierre Maury6, le roman est d’une saisissante ambiguïté. Sous le couvert d’une respectabilité toute british, Peské a construit une histoire scabreuse. « On ne se méfie jamais assez des romancières de dix-huit ans », de conclure Jean-Pierre Sicre dans sa « Note de l’éditeur ».
Ossuaire d’amour
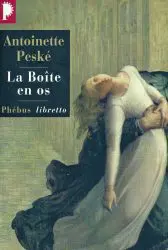 Le mystérieux surgissement du désir plutôt que son simple assouvissement : voilà ce qui intéressait la jeune romancière dans L’insaisissable rival. Son deuxième roman, La boîte en os, qui lui vaudrait les compliments de Cocteau, Fénéon, Follain et Mac Orlan, reprend le même motif tout en accentuant son côté sombre. Peské a voulu montrer comment l’amour peut conduire à la folie. Sa rencontre avec un homme sortant d’une maison de santé lui a fourni certains détails pour son livre. Le roman, achevé en 1931, fut cependant refusé par plusieurs éditeurs. Ce n’est qu’en 1941 que Peské parvint à le publier à compte d’auteur aux éditions Denoël. À sa réédition en 1951 chez Frédéric Chambriand – cette maison, fondée par Pierre Bonnier, fut la première à publier des œuvres de Céline après la guerre –, le récit était précédé d’une préface de Mac Orlan.
Le mystérieux surgissement du désir plutôt que son simple assouvissement : voilà ce qui intéressait la jeune romancière dans L’insaisissable rival. Son deuxième roman, La boîte en os, qui lui vaudrait les compliments de Cocteau, Fénéon, Follain et Mac Orlan, reprend le même motif tout en accentuant son côté sombre. Peské a voulu montrer comment l’amour peut conduire à la folie. Sa rencontre avec un homme sortant d’une maison de santé lui a fourni certains détails pour son livre. Le roman, achevé en 1931, fut cependant refusé par plusieurs éditeurs. Ce n’est qu’en 1941 que Peské parvint à le publier à compte d’auteur aux éditions Denoël. À sa réédition en 1951 chez Frédéric Chambriand – cette maison, fondée par Pierre Bonnier, fut la première à publier des œuvres de Céline après la guerre –, le récit était précédé d’une préface de Mac Orlan.
La boîte en os est un récit déconcertant, comme l’indique le résumé qu’en fit Robert Coiplet dans Le Monde en février 1951 : « Un homme se fait présenter le cerveau de sa femme morte, et le médecin qui a pratiqué la nécropsie […] tient des propos qui rejoignent Hamlet ou au moins Mrs. Radcliffe : ‘Vois, sens, touche, mais touche donc, plonge la main dans cette cavité humaine…’ Ensuite le mari est enterré vivant, mais le roman n’est pas fini ; son petit-fils revient plus tard faire ouvrir le cercueil, où l’on trouve le squelette retourné. Ce jeune homme, en qui revit le caractère de son grand-père, est amoureux de la petite-fille du narrateur. Le narrateur, qui est devenu un vieil homme, est celui qui a fait enterrer involontairement un peu vite son ami de jeunesse. Le mort se venge en lui prenant sa petite-fille, qui meurt en même temps que le jeune homme revenu d’Amérique pour fouiller la tombe de son grand-père. Le tout se passe en Écosse dans la première moitié du dix-neuvième siècle ».
On croirait lire la mise en pièces d’un roman baroque et décousu. Loin de là. Ébloui, le critique du Monde insiste sur le point culminant (et macabre à souhait) auquel Peské conduit son lecteur au moyen d’une prose parfaitement maîtrisée. Trente ans avant Sicre, Coiplet reconnaissait en Peské une sœur d’Emily Brontë : « Dans la galopade de nuées nordiques qui passent derrière ce livre j’ai vu Heathcliff quand il demande qu’on abatte les parois du cercueil de Catherine et du sien pour qu’ils soient enfin réunis », écrit-il encore dans Le Monde. Car comme le signale Alexandra James, « l’amour fou » ne peut survenir totalement « qu’après la définitive disparition de l’être aimé » ; sans « prétention ‘analytique’ » et en préservant « la fraîcheur de l’inconscient », Peské a livré « l’histoire d’un amour trop fort, à l’‘état pur’7 ». Cocteau n’a donc pas en vain crié à la révélation : « […] le roman d’Antoinette Peské demeure du nombre de ces chefs-d’œuvre incompréhensiblement négligés8 ».
Signé « Peské Marty »
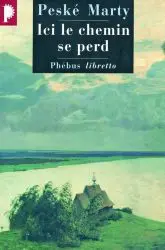 En 1955 paraît chez Gallimard un autre chef-d’œuvre inexplicablement passé inaperçu : le roman Ici le chemin se perd, qu’Antoinette cosigne avec son mari, le juriste Pierre Marty (1896-1957). Après avoir privilégié les décors anglo-écossais, Peské se tourne cette fois vers les confins sauvages de la Mongolie et de la Sibérie. Ici le chemin se perd se lit comme un envoûtant western transposé dans le « ‘Far East’ de la vieille Russie9 ». Il relate la vie cachée qu’aurait menée le tsar Alexandre 1er, vainqueur de Napoléon et instigateur de la Sainte-Alliance, après sa supposée mort en 1825. Fuyard, esclave, aventurier, chercheur d’or puis mendiant de Dieu, il aurait parcouru un immense territoire de Taganrog à la Chine avant de reparaître sous les traits du starets Féodor Kouzmitch. Le sujet intéressa aussi Tolstoï, qui lui consacra un récit (Le journal posthume du vieillard Féodor Kouzmitch).
En 1955 paraît chez Gallimard un autre chef-d’œuvre inexplicablement passé inaperçu : le roman Ici le chemin se perd, qu’Antoinette cosigne avec son mari, le juriste Pierre Marty (1896-1957). Après avoir privilégié les décors anglo-écossais, Peské se tourne cette fois vers les confins sauvages de la Mongolie et de la Sibérie. Ici le chemin se perd se lit comme un envoûtant western transposé dans le « ‘Far East’ de la vieille Russie9 ». Il relate la vie cachée qu’aurait menée le tsar Alexandre 1er, vainqueur de Napoléon et instigateur de la Sainte-Alliance, après sa supposée mort en 1825. Fuyard, esclave, aventurier, chercheur d’or puis mendiant de Dieu, il aurait parcouru un immense territoire de Taganrog à la Chine avant de reparaître sous les traits du starets Féodor Kouzmitch. Le sujet intéressa aussi Tolstoï, qui lui consacra un récit (Le journal posthume du vieillard Féodor Kouzmitch).
Ce n’est pas la première fois (ni la dernière) que le couple publie un texte rédigé à quatre mains. Les époux avaient collaboré en 1951 pour l’essai Les terribles, consacré aux figures d’Arsène Lupin, Rouletabille, Chéri-Bibi, Fantômas et à leurs créateurs. Les terribles est régulièrement cité comme une étude pionnière sur le roman populaire.
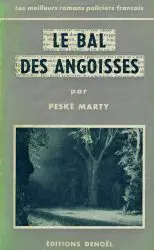 On doit encore au couple un roman policier, Le bal des angoisses, publié en 1957 chez Denoël. Il s’agit du onzième volume de l’éphémère collection « Les meilleurs romans policiers français » (1955-1957), où avaient notamment paru divers titres de Boileau-Narcejac. L’action du Bal des angoisses se déroule à Glengoë, un village fictif « situé à quelque vingt milles de Newcastle ». Le narrateur, Archibald Lamb, est un romancier londonien venu à Glengoë afin de respirer l’air d’un pays « dépourvu de pittoresque, de drame et de mystère ». L’assassinat du vieux Zacharie Mopp a tôt fait de troubler cette quiétude initiale et de déclencher une série de crimes étranges et sanglants. Aidé du docteur Wincles et de l’inspecteur Maines de Scotland Yard, Lamb décide de mener sa propre enquête. Comme chez Agatha Christie, la liste des suspects s’accroît rapidement, mais l’enquête se complique du fait que certains d’entre eux se retrouvent assassinés. De plus, il semble qu’une explication surnaturelle ne soit pas à exclure après que l’on eut vu errer la nuit, près du « Bois des Plaintes », une mystérieuse silhouette au pelage gris. Songeant à L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, Lamb en vient à se demander s’il n’est pas victime d’un dédoublement maléfique l’incitant à commettre à son insu les crimes les plus abjects. Du grand art en matière de suspense.
On doit encore au couple un roman policier, Le bal des angoisses, publié en 1957 chez Denoël. Il s’agit du onzième volume de l’éphémère collection « Les meilleurs romans policiers français » (1955-1957), où avaient notamment paru divers titres de Boileau-Narcejac. L’action du Bal des angoisses se déroule à Glengoë, un village fictif « situé à quelque vingt milles de Newcastle ». Le narrateur, Archibald Lamb, est un romancier londonien venu à Glengoë afin de respirer l’air d’un pays « dépourvu de pittoresque, de drame et de mystère ». L’assassinat du vieux Zacharie Mopp a tôt fait de troubler cette quiétude initiale et de déclencher une série de crimes étranges et sanglants. Aidé du docteur Wincles et de l’inspecteur Maines de Scotland Yard, Lamb décide de mener sa propre enquête. Comme chez Agatha Christie, la liste des suspects s’accroît rapidement, mais l’enquête se complique du fait que certains d’entre eux se retrouvent assassinés. De plus, il semble qu’une explication surnaturelle ne soit pas à exclure après que l’on eut vu errer la nuit, près du « Bois des Plaintes », une mystérieuse silhouette au pelage gris. Songeant à L’étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, Lamb en vient à se demander s’il n’est pas victime d’un dédoublement maléfique l’incitant à commettre à son insu les crimes les plus abjects. Du grand art en matière de suspense.
Invisible Peské
Antoinette Peské semblait parler d’elle-même lorsqu’elle écrivait dans Que cherches-tu ? : « Mon existence est une de celles que l’on n’aperçoit guère ». Il est rare qu’un écrivain, à qui l’on doit des œuvres de la trempe de La boîte en os et d’Ici le chemin se perd, laisse aussi peu de traces. Son éditeur notait, au début de 1984, qu’elle « a pris depuis longtemps son parti de la négligence du siècle10 ». L’année suivante, il indiquait qu’« [e]lle vit aujourd’hui à Paris au milieu de ses souvenirs, quasi retirée du monde, et depuis longtemps désabusée quant au crédit qu’il convient d’accorder aux jugements du siècle11 ». S’étonnera-t-on que sa mort, survenue cette même année 1985, ait à peine retenu l’attention de la presse ? À titre d’exemple, la brève nécrologie publiée par Le Monde le 10 octobre 1985 ne lui est même pas exclusive (le journal rapporte dans le même article la mort de Riccardo Bacchelli), ne fournit presque aucun renseignement biographique et renomme son mari André [sic] Marty.
Trente ans après sa mort, Antoinette Peské jouit toujours d’un lectorat confidentiel, dont émanent parfois certaines surprises, comme l’exposition Inside présentée au Palais de Tokyo, à Paris, du 20 octobre 2014 au 11 janvier 2015. Le commissaire d’exposition, Jean de Loisy, expliquait à Laurent Boudier, de Télérama, que La boîte en os, « [r]écit tragique et initiatique », a servi « de fil rouge à Inside12 ». C’est à la fois formidable et insuffisant pour sortir Antoinette Peské de son purgatoire immérité.
* Aquarelle de Jean Peské (1870-1949)
1. Antoinette Peské, Que cherches-tu ?, Phébus, Paris, 2004, quatrième de couverture.
2. Exposition-concours de dessins d’enfants, galerie Charles Malpel, 2 au 20 juin 1914, Paris. La carte d’invitation fut illustrée par Gaspard Maillol.
3. Guillaume Apollinaire, Anecdotiques, Stock, Paris, 1926, p. 178.
4. Antoinette Peské, La boîte en os, Phébus, « Libretto », Paris, 2001, p. 12-13.
5. Ibid., p. 13.
6. Pierre Maury, Le Soir, 16 avril 2004, p. 2.
7. Alexandra James, « Antoinette Peské, la fiancée du diable », Le Monde, 8 juin 1984.
8. Jean-Pierre Sicre, « Note de l’éditeur », dans Antoinette Peské, La boîte en os, p. 15.
9. Id., « Note de l’éditeur », dans Peské Marty, Ici le chemin se perd, Phébus, « Libretto », Paris, 2001, p. 9.
10. Jean-Pierre Sicre, « Note de l’éditeur », dans Antoinette Peské, La boîte en os, p. 15.
11. Id., « Note de l’éditeur », dans Peské Marty, Ici le chemin se perd, p. 13.
12. http://www.telerama.fr/sortir/l-exposition-inside-explore-l-humain-et-l-inhumain-jean-de-loisy-directeur-du-palais-de-tokyo,120478.php (page consultée le 2 juin 2015).
Antoinette Peské a publié :
L’insaisissable rival, roman, La Grande Revue, 1924 ; La boîte en os, roman, Denoël, 1941.
Avec Pierre Marty :
Les terribles, essai, Frédéric Chambriand, 1951 ; Ici le chemin se perd, roman, Gallimard, 1955 ; Le bal des angoisses, roman, Denoël, 1957.
EXTRAITS
En regardant tomber ces fleurs, je sentis combien l’homme possédait encore de cruauté innée, inconsciente ou le plus souvent irréfléchie. Et je m’étonnai de ce qu’il perdît si aisément le but de son existence quand tant de choses lui murmuraient : « Sois meilleur, perfectionne-toi. »
Mais l’homme s’écoute trop pour entendre la voix des fleurs.
Que cherches-tu ? p. 38.
Que dire de ce que l’on éprouve à la vue d’une aurore sans lueurs, d’une fleur qui se ferme aussitôt entrouverte, d’un enfant dont le regard est abîmé d’amertume ?
Que cherches-tu ? p. 46.
À vrai dire, j’ai éprouvé dans l’Écosse des Highlands ce que je n’ai éprouvé nulle part au cours de mes nombreux voyages à travers l’Europe. Ces monts, dont les sommets presque toujours perdus dans la brume font croire qu’ils touchent le ciel, ces lacs de plomb fondu dont les eaux sont si profondes qu’elles semblent être les ouvertures de l’enfer, font subir tour à tour aux passions humaines des envolées et des descentes incroyables. L’Écosse du Nord est je crois, par excellence, le lieu du rêve, de la contemplation intérieure et de l’amour.
La boîte en os, p. 21.
L’empereur Alexandre 1er, fils de Paul 1er ? L’adversaire de Napoléon ? L’histoire officielle enseigne cependant qu’il mourut à Taganrog, en Ukraine, le 19 novembre 1825, 1er décembre du calendrier orthodoxe.
Il est vrai que cette mort s’accompagne de circonstances étranges. Pourquoi, par exemple, tant de précautions furent-elles prises pour ne pas laisser voir le tsar mort à ses sujets ? Pourquoi le cadavre d’Alexandre ne fut-il pas exposé à visage découvert, ainsi que l’exigeait l’usage orthodoxe toujours respecté ? […] Le bruit courut alors qu’Alexandre était mort non pas de fièvres, selon la version officielle, mais comme son père et son grand-père, assassiné. Plus tard seulement, l’idée se répandit qu’Alexandre n’était pas mort en 1825 à Taganrog, mais qu’à la faveur de cette mort simulée il s’était enfui en secret.
Ici le chemin se perd, p. 496.
J’ai connu des jeunes filles qui avaient plus de sex-appeal comme disent les Américains, et moins de gentillesse. En celle-ci, tout est sourire… Peut-être n’a-t-elle point trop de distinction. Une pointe de vulgarité donne à son charme plus d’accent. J’aime entendre parler Icy. D’autres jeunes filles sont préoccupées de sport, de littérature, d’enfants, de progrès social, de politique. Elle pense à l’homme, rien qu’à l’homme. Pourtant, c’est une vraie jeune fille, j’en suis sûr. Je ne sais si ma méthode d’investigation psychologique m’apportera la vérité ; elle me donne en tout cas bien du plaisir.
Le bal des angoisses, p. 64.