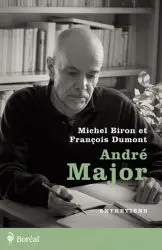Il faut saluer l’initiative de Michel Biron et de François Dumont de nous livrer, dans le cadre des entretiens1 qu’ils ont eus avec André Major, le portrait de l’un des acteurs importants qui ont marqué la littérature québécoise et son développement au cours des 50 dernières années.
En s’attardant aux années de formation, à la naissance et au mûrissement de l’œuvre d’André Major, ils nous livrent plus largement une rétrospective des transformations qu’a connues la société québécoise depuis la Révolution tranquille, notamment le rôle qu’a été appelée à jouer la littérature au cours de cette même période qui a vu le Québec s’ouvrir sur le monde. Des maisons d’édition allaient susciter et soutenir de nouvelles voix, des revues appeler le changement, et une radio d’État s’imposer comme un phare culturel. C’est dans ce contexte en constante ébullition qu’André Major a navigué, tantôt à la barre d’une revue, tantôt à celle d’une émission littéraire, sans oublier, en toile de fond, la poursuite d’une œuvre multiforme qui n’a cessé de se déployer. Le résultat est d’autant plus intéressant que Major a revu l’ensemble des entretiens qu’il a accordés aux deux universitaires avec le même souci de clarté, de rigueur et d’exactitude que l’on retrouve dans ses carnets.
Pour mener à bien leur projet, les auteurs ont tenu trois rencontres, dont deux en présence d’André Major et une troisième en mode virtuel, pour les raisons que l’on connaît. Le premier entretien retrace la jeunesse et les premiers écrits de l’auteur du Cabochon. Aux éléments biographiques propres à André Major, comme le fait d’avoir étudié dans un collège classique avant d’en être renvoyé, se superpose l’émergence d’une société qui se transforme rapidement au tournant des années 1960. De clérical et rural, le Québec se laïcise et s’urbanise, ce qui donne lieu à des débats de société auxquels le jeune André Major participe activement. Membre fondateur de la revue Parti pris et de l’UNEQ, il est au cœur de tous les combats et son nom apparaît au sommaire de la plupart des revues qui foisonnent alors. Il n’en défend pas moins jalousement sa liberté de pensée et d’action, et d’aucuns s’étonneront parfois de le retrouver là où on ne l’attendait pas. C’est sans doute que le choc des idées et la recherche constante d’une voie privilégiant la justice sociale autant que la liberté primeront tout au cours de sa vie sur le sentiment d’appartenance à tel ou tel groupe. Les années de jeunesse sont aussi celles des lectures marquantes et des rencontres qui seront déterminantes pour celui qui entreprend, comme l’écrivent Biron et Dumont, une ambitieuse trilogie, Histoires de déserteurs, à laquelle il sera longtemps associé. Nombreux sont ceux qui, à un moment ou à un autre, ont croisé sa route et avec lesquels il a parfois entretenu des correspondances, ce qui amène l’un des intervieweurs à observer : « On a l’impression que vous avez connu tout le monde… » Ce qui est sans doute en partie vrai, mais davantage sous l’angle de l’action et des échanges d’idées que par besoin ou désir d’entretenir des relations sociales. Esprit libre, André Major se révèle avant tout jaloux de son indépendance, et préfère de loin la liberté de mouvement et la solitude aux attroupements et au brouhaha médiatique.
Le deuxième entretien accorde une large place aux années passées à Radio-Canada à titre de réalisateur d’émissions littéraires, à une époque où l’on croyait encore à l’importance de produire de telles émissions. André Major verra progressivement se déliter les fondements du formidable outil qu’était alors la radio publique pour démocratiser la culture. « On peut dire, confie-t-il à ses intervieweurs, qu’on est passé d’une période faste à une austérité qui a soumis la chaîne culturelle à rien de moins qu’un appauvrissement, qui changera peu à peu nos façons de faire. » Au-delà de la déception et de l’amertume qui émanaient de l’évocation que l’on retrouve dans ses carnets lorsqu’il faisait allusion à cette période, André Major se souvient ici avec bonheur du rôle de passeur de culture, d’éveilleur de sensibilité qui était le sien quand il réalisait des émissions littéraires telles que Book-Club. Il n’en perd pas pour autant son esprit mordant lorsque, revenant sur cette période faste intellectuellement parlant, il conclut : « On pourrait dire qu’on est passé du temps des poètes au temps des farceurs ».
Enfin, le troisième entretien aborde les années où André Major s’est en quelque sorte mis en retrait de la société, comme l’indique le titre de cette troisième conversation à trois. Les questions liées aux positions politiques qu’il avait adoptées et défendues, notamment au regard de l’indépendance du Québec, de l’accession à sa maturité politique, de la justice sociale, sont évoquées avec franchise et lucidité. « Si la collectivité évolue, confie-t-il, c’est vers quelque chose d’assez confus. On en vient à ne plus savoir pour qui voter, même si on sait pour qui on ne votera jamais. » Bien qu’il n’ait plus aucune illusion en ce qui concerne l’avenir politique du Québec, André Major demeure un fervent défenseur de l’importance de préserver sa culture. Il partage en ce sens avec Gérard Bouchard la vision de ce que pourrait être le Québec de demain : une société tout à la fois soucieuse de préserver son identité et de favoriser l’inclusion des minorités.
Maintenant qu’il a renoué avec la fiction, la publication de ses carnets, forme qui correspond davantage à son rythme de vie, comme il le souligne, prend aujourd’hui la part importante de son temps d’écrivain. Ne serait-il pas devenu le personnage de ses carnets, comme on le lui a déjà fait remarquer ? Il en convient, le rôle du personnage qui raconte et se raconte lui permet sans doute de synthétiser le parcours d’une vie riche à maints égards. À ce titre, les entretiens qui nous sont ici livrés en sont un fidèle reflet et constituent un document des plus captivants pour qui s’intéresse à l’œuvre d’André Major tout autant qu’à l’histoire récente de la littérature québécoise.
1. Michel Biron et François Dumont, André Major. Entretiens, Boréal, Montréal, 2021, 256 p. ; 27,95 $.
EXTRAITS
Le retour brutal au petit monde d’où j’étais issu m’avait fait prendre conscience que l’écrivain œuvre dans la solitude et que c’est là que l’écriture s’épanouit vraiment. Parce qu’elle se nourrit de ce qu’on porte et de ce qu’on ressent. On doit suivre son instinct.
p. 62
J’ai peu à peu pris conscience que mon activisme politique cachait un profond pessimisme. J’irais jusqu’à dire que j’ai été d’autant plus engagé que je désespérais de l’avenir du peuple québécois. Au fond, c’est ce que j’écrivais qui témoignait le mieux de ce constat, fondé ou non.
p. 185
Quant à la langue, je crains qu’à l’intérieur du cadre canadien, aucun gouvernement québécois ne puisse en assurer la pérennité.
p. 194
Pour le romancier, comme pour le poète ou le carnettiste, il importe de ne jamais laisser l’idéologie pervertir le regard qu’on porte sur la complexité de l’existence.
p. 243
C’est la culture de l’image qui occupe tout l’espace médiatique, et encore faut-il y représenter un courant dominant, quel qu’il soit. Être un humoriste ou un influenceur sur les réseaux sociaux. Ça, c’est « vendeur », comme on dit.
p. 168