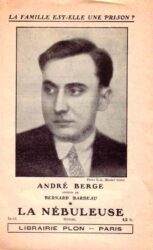André Berge (1902-1995) a connu une enfance heureuse dans ce qu’on appelait encore, avant la Grande Guerre, le « quartier de Chaillot », dans le 16e arrondissement de Paris. La famille est politisée et lettrée. L’écrivain est le petit-fils du président de la République française à l’époque de l’affaire Dreyfus, Félix Faure, dont la mort est restée célèbre : il se serait écrasé, dans son bureau de l’Élysée, entre les bras de sa jeune maîtresse, Marguerite Steinheil, désormais surnommée « la pompe funèbre », référence délicieusement inélégante à ce que vous imaginez…
En mai 1924, alors qu’il étudie à la Sorbonne, André Berge fonde, avec son frère François, Les Cahiers du mois, une revue qui, pendant ses trois années d’existence, fera une place aux préoccupations littéraires de la jeune génération. C’est dans cette revue que, à la fin de 1924, il fait paraître son premier roman, Le crépuscule de M. Dargent. Il s’agit d’un très bon premier titre, aujourd’hui introuvable, où M. Dargent est tout à fait à l’image des antihéros velléitaires de l’époque, que toute chose épuise à la simple pensée d’avoir à se remuer. Par le moyen de ce personnage, Berge cherche surtout à faire la critique du milieu bourgeois provincial, si bien que la médiocrité de M. Dargent s’explique par la petitesse de convenances et traditions repliées sur elles-mêmes.
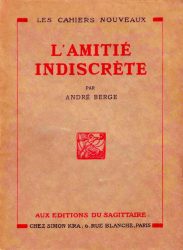 Deux ans plus tard, Berge publie un bref récit d’un intérêt mitigé, L’amitié indiscrète, dans la jolie collection des « Cahiers nouveaux » aux éditions Simon Kra. Écrit à la première personne et entièrement voué à l’analyse psychologique, le récit raconte les retrouvailles de deux amis adolescents, dont l’un porte le secret de sa liaison platonique avec une femme mariée.
Deux ans plus tard, Berge publie un bref récit d’un intérêt mitigé, L’amitié indiscrète, dans la jolie collection des « Cahiers nouveaux » aux éditions Simon Kra. Écrit à la première personne et entièrement voué à l’analyse psychologique, le récit raconte les retrouvailles de deux amis adolescents, dont l’un porte le secret de sa liaison platonique avec une femme mariée.
L’essentiel de l’œuvre romanesque de Berge vient au tournant des années 1930 et consiste dans les trois volumes consacrés au personnage de Bernard Bardeau, qui sont un excellent témoignage de l’esprit inquiet qui caractérise la jeunesse de l’après-guerre et de la remise en question des valeurs et principes de la famille bourgeoise.
L’histoire d’une occupation
Bernard a sept ans dans le premier tome, La nébuleuse (1929), dont il n’est pas encore le personnage principal. Bien qu’il ait peu d’autonomie narrative, l’histoire tourne autour de lui (d’où le titre astronomique du roman) ; il est comme un astre en devenir autour duquel s’agite la constellation familiale, où chacun exerce sur l’enfant des forces contraires. Bernard n’est qu’un territoire occupé.
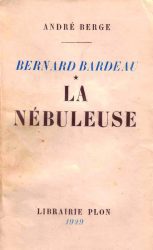 C’est néanmoins un membre extérieur à la famille, Gérard Ducellier, qui tient le rôle le plus important. C’est un indolent, incapable de grandes actions et de grandes décisions. « Si j’étais très riche, je paierais quelqu’un pour préparer la vie devant moi », dit-il. Il reste profondément marqué par une enfance malheureuse et la mort de son enfant. Or, lorsqu’il découvre Bernard, le jeune fils mal aimé d’un ancien ami de ses années de collège, Gérard a le sentiment de retrouver « miraculeusement » l’enfant qu’il a été. Pour Gérard, Bernard devient ainsi une sorte de fils par procuration, qui lui offre l’occasion de donner un but à son existence ; en guidant Bernard, Gérard pourrait en quelque sorte racheter sa propre enfance et l’échec de sa vie. Par ailleurs, ce projet prend forme contre l’attitude du frère de la mère de Bernard, René Dartois, un révolté qui, dans sa haine contre l’institution familiale, voudrait prendre sa revanche contre l’éducation bourgeoise qu’il a subie en corrompant le jeune Bernard. Entre ces deux « forces » extérieures, l’ami et le beau-frère, Paul Bardeau, le père de Bernard, se fait fort d’imposer son autorité ; mais la plupart du temps il ne fait que blesser son fils, qu’il trouve idiot, et heurter sa femme, Madeleine, à qui le mariage a été imposé. René Dartois sera finalement écarté par sa famille, qui le force à accepter un emploi en Indochine. Quant à Gérard, sa faiblesse l’a conduit jusqu’à aimer Madeleine, comme s’il allait lui être possible de reconstruire la cellule familiale dont il a été privé depuis la mort de son enfant. Mais Madeleine l’ayant repoussé après qu’ils ont fait l’amour, Gérard se laisse heurter à mort par une voiture. Décidément, Gérard n’était pas armé pour la vie.
C’est néanmoins un membre extérieur à la famille, Gérard Ducellier, qui tient le rôle le plus important. C’est un indolent, incapable de grandes actions et de grandes décisions. « Si j’étais très riche, je paierais quelqu’un pour préparer la vie devant moi », dit-il. Il reste profondément marqué par une enfance malheureuse et la mort de son enfant. Or, lorsqu’il découvre Bernard, le jeune fils mal aimé d’un ancien ami de ses années de collège, Gérard a le sentiment de retrouver « miraculeusement » l’enfant qu’il a été. Pour Gérard, Bernard devient ainsi une sorte de fils par procuration, qui lui offre l’occasion de donner un but à son existence ; en guidant Bernard, Gérard pourrait en quelque sorte racheter sa propre enfance et l’échec de sa vie. Par ailleurs, ce projet prend forme contre l’attitude du frère de la mère de Bernard, René Dartois, un révolté qui, dans sa haine contre l’institution familiale, voudrait prendre sa revanche contre l’éducation bourgeoise qu’il a subie en corrompant le jeune Bernard. Entre ces deux « forces » extérieures, l’ami et le beau-frère, Paul Bardeau, le père de Bernard, se fait fort d’imposer son autorité ; mais la plupart du temps il ne fait que blesser son fils, qu’il trouve idiot, et heurter sa femme, Madeleine, à qui le mariage a été imposé. René Dartois sera finalement écarté par sa famille, qui le force à accepter un emploi en Indochine. Quant à Gérard, sa faiblesse l’a conduit jusqu’à aimer Madeleine, comme s’il allait lui être possible de reconstruire la cellule familiale dont il a été privé depuis la mort de son enfant. Mais Madeleine l’ayant repoussé après qu’ils ont fait l’amour, Gérard se laisse heurter à mort par une voiture. Décidément, Gérard n’était pas armé pour la vie.
L’histoire d’une transition
Dans La jeunesse interdite (1930), Bernard a quinze ans. Ce roman est formellement très différent du précédent. Alors que le premier roman faisait de Bernard l’objet du regard des autres dans le premier roman, ce deuxième volume, entièrement déterminé par son point de vue et ses interrogations existentielles, le fait advenir comme sujet.
Avec les années, sa mère s’est renfermée en elle-même, dans un silence religieux et résigné. Son père, qui a maintenant une maîtresse, a plus que jamais l’autorité d’un propriétaire. Parce que sa famille est bornée par l’argent et de grands principes auxquels il ne croit pas, Bernard aspire à quelque chose de plus grand : son désir de justice et de beauté lui fait chercher la vérité du côté de Dieu, traquant le mal autour de lui. Puis une conversation avec son ami Serge Marcos, dans la famille de qui il passe les vacances d’été en Normandie, met sa foi à rude épreuve. Bernard comprend d’un seul coup que Dieu n’existe pas, que les arguments pour en prouver l’existence n’expliquent rien. Tout son monde intérieur se trouve instantanément réduit à néant. À Serge qui lui conseille de s’amuser et de laisser le temps arranger les choses, Bernard explique : « Mais comment veux-tu ?… Il faut bien que tu comprennes ce qui se passe en moi. Je suis à peu près comme l’habitant d’une maison qui se serait écroulée… Je dois sans perdre une minute tout reconstruire sur de nouvelles fondations, sous peine de coucher à la belle étoile et de périr gelé sans défense ».
C’est dans ce contexte que le titre du roman acquiert son sens. La jeunesse interdite, c’est l’isolement malheureux de Bernard pendant que les autres se baignent, s’amusent, ont du plaisir. Il est seul avec ses tourments et ses angoisses, rongé par « un examen de conscience » continu, incapable, par souffrance et par orgueil, de départager le bien du mal et de participer à la joie des autres, d’accepter l’amitié d’Inès, la sœur de Serge, qui pourtant l’attire. Il ignore comment vivre. Les vacances auront permis à Bernard de faire des découvertes fondamentales sur la vie et lui-même, qu’il mesure à l’aune de son éducation. Six semaines plus tard, la veille de son retour dans sa famille, il couche sur le papier des pensées qu’il intitule : « Conseils de moi-même à moi plus âgé ». Il s’agit d’une sorte de bréviaire de la paternité, dont les principaux points traités sont orientés par cette question préalable : « Si, plus tard, j’ai des enfants moi-même, tomberai-je à mon tour dans les mêmes erreurs ? Est-ce inévitable ? Y a-t-il toujours des murs, des murailles épaisses… partout » ? À son père il fait lire ses « Conseils » ; mais Paul les déchire, se moquant de son fils qui se mêle de « faire le pédagogue ». Le roman se clôt sur le désespoir de Bernard, dont l’âme est un gouffre à la surface duquel surnage un mélange de souffrance, d’injustice et de tristesse que domine le sentiment douloureux de la perte de la capacité d’aimer.
L’histoire d’une libération
Avec Le bonheur difficile (1933), dernier roman du cycle, on comprend que la vie n’ira pas de soi pour Bernard. Le roman a les mêmes qualités que le précédent : d’excellents dialogues et une très grande finesse dans les réflexions psychologiques du personnage sur lui-même. Âgé maintenant de vingt ans, Bernand choisit d’abandonner ses études et de quitter sa famille pour faire son chemin seul. La grande question qui sous-tend ce roman se rapporte à la quête d’indépendance de Bernard par rapport à son éducation : comment se forger un tempérament et une situation qui n’appartiendraient qu’à soi et qui ne seraient pas redevables aux autres ?
Après avoir travaillé quelque temps comme commis voyageur, Bernard se trouve un emploi de secrétaire auprès d’un jeune homme, Jean-Louis Martial, qu’un héritage vient de placer à la tête d’une agence de voyage. Bernard travaille avec un enthousiasme qui lui fait recevoir des responsabilités plus importantes ; il a sans cesse de nouvelles idées pour développer l’agence. Rapidement, les bénéfices sont suffisamment importants pour que Martial ouvre deux succursales à l’étranger. C’est à cette période que Bernard épouse Paulette, une fille simple capable de le comprendre et de l’aimer. Son mariage témoigne de son progrès moral ; conscient que les choses sont difficiles, il arrive à mieux s’installer dans la vie, à mieux maîtriser les obstacles, « menant une lutte silencieuse, mais acharnée, contre certaines parties de lui-même, de son tempérament, de son hérédité, de ses souvenirs ».
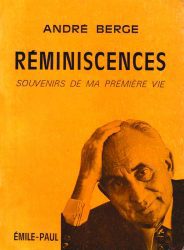 Les dernières pages du roman, âpres mais lumineuses, le conduisent au bois de Boulogne, où il prend place dans une barque et dérive au fil de ses réflexions. Bernard songe aux enfants qu’il aimerait avoir, comme s’il avait soudainement la révélation de ce qui devait confirmer son indépendance et son acceptation à vivre. « J’ai décidé de vivre… », scande-t-il tout bas, répétant cette phrase. « Il la répétait toujours sur le même ton et au mot ‘vivre’ il abaissait les rames dans l’eau, d’un mouvement rapide. Il recommençait : ‘J’ai dé-ci-dé de vivre’ ; son geste se trouvait ainsi décomposé en trois temps ». Ces trois temps sont aussi ceux de la trilogie romanesque, mais comme un parcours symbolique qui inverserait le cours normal des choses, puisqu’il irait de la naissance (La nébuleuse) à la mort (La jeunesse interdite) puis à la vie (Le bonheur difficile). Ainsi Bernard a-t-il le sentiment de revivre, se sachant désormais capable de se construire une vie et sûr de son indépendance spirituelle, plus importante que la réussite matérielle bourgeoise. Ici, ce qui importe, c’est de se mesurer à soi-même et non plus dans un rapport orgueilleux aux autres. « Bernard Bardeau avait l’impression d’être parvenu au terme d’une lente construction de soi-même ; il avait peine à retenir l’espèce d’enthousiasme qui le saisissait. Il était fier et allègre de n’être plus un jouet entre ses propres mains. Voilà ce que depuis si longtemps il avait rêvé, voilà le but que plus ou moins consciemment il poursuivait sans cesse depuis l’éveil de sa pensée. À présent, il prenait pied sur un sol plus ferme. Être un homme, se dit-il, mais sans détruire jamais l’enfant que l’on fut. »
Les dernières pages du roman, âpres mais lumineuses, le conduisent au bois de Boulogne, où il prend place dans une barque et dérive au fil de ses réflexions. Bernard songe aux enfants qu’il aimerait avoir, comme s’il avait soudainement la révélation de ce qui devait confirmer son indépendance et son acceptation à vivre. « J’ai décidé de vivre… », scande-t-il tout bas, répétant cette phrase. « Il la répétait toujours sur le même ton et au mot ‘vivre’ il abaissait les rames dans l’eau, d’un mouvement rapide. Il recommençait : ‘J’ai dé-ci-dé de vivre’ ; son geste se trouvait ainsi décomposé en trois temps ». Ces trois temps sont aussi ceux de la trilogie romanesque, mais comme un parcours symbolique qui inverserait le cours normal des choses, puisqu’il irait de la naissance (La nébuleuse) à la mort (La jeunesse interdite) puis à la vie (Le bonheur difficile). Ainsi Bernard a-t-il le sentiment de revivre, se sachant désormais capable de se construire une vie et sûr de son indépendance spirituelle, plus importante que la réussite matérielle bourgeoise. Ici, ce qui importe, c’est de se mesurer à soi-même et non plus dans un rapport orgueilleux aux autres. « Bernard Bardeau avait l’impression d’être parvenu au terme d’une lente construction de soi-même ; il avait peine à retenir l’espèce d’enthousiasme qui le saisissait. Il était fier et allègre de n’être plus un jouet entre ses propres mains. Voilà ce que depuis si longtemps il avait rêvé, voilà le but que plus ou moins consciemment il poursuivait sans cesse depuis l’éveil de sa pensée. À présent, il prenait pied sur un sol plus ferme. Être un homme, se dit-il, mais sans détruire jamais l’enfant que l’on fut. »
Le cycle de Bernard Bardeau raconte donc le long apprentissage de la vie, de soi-même dans la vie et par rapport à sa famille. Bernard triomphe progressivement de ses misères et de ses démons, ce qui lui permet de trouver peu à peu sa place dans la société, de se marier et évidemment d’envisager de devenir père. Cela aurait été un quatrième temps romanesque, si besoin avait été de le raconter. À la fin de La jeunesse interdite, il théorisait la paternité (ses « Conseils »). Dans le dernier volume, prenant la vie à bras-le-corps et donnant de lui-même sa mesure concrète, il envisage peut-être la paternité comme exercice de la réalité. À la dernière ligne, sa jeunesse est derrière ; devant lui, il y a toute l’étendue d’une vie d’homme.
Une deuxième vie
En menant son héros à la libération, Berge aura mis un point final à sa carrière littéraire ; un roman policier, Le visiteur nocturne (1933), paraît la même année que Le bonheur difficile, puis Berge embarque progressivement dans sa deuxième vie, mettant le pied à l’étrier pédagogique qu’il n’allait plus lâcher, amorçant une carrière professionnelle à laquelle son œuvre littéraire l’avait préparé. À trente-cinq ans, père de cinq enfants, il entreprend une psychanalyse, puis, désirant compléter sa formation, retrouve le chemin de la faculté, cette fois-ci de médecine plusieurs années après celle des lettres. Devenu directeur, après la guerre, du Centre psycho-pédagogique Claude Bernard, André Berge publiera quelques dizaines d’ouvrages d’intérêt psychologique et pédagogique sur l’enfance et la famille.
André Berge a publié, entre autres :
Le crépuscule de M. Dargent, roman, Les Cahiers du mois, nos 4-5, 1924 ; L’amitié indiscrète, récit, Simon Kra, 1926 ; La nébuleuse, roman, Plon, 1929 ; La jeunesse interdite, roman, Plon, 1930 ; L’esprit de la littérature moderne, essai, Librairie académique Perrin & Cie, 1930 ; Le bonheur difficile, roman, Plon, 1933 ; Le visiteur nocturne, roman, Librairie des Champs-Élysées, 1933 ; André Berge : écrivain, psychanalyste, éducateur, anthologie, Desclée de Brouwer, 1995.