On sait bien que le rapport à l’écriture est différent lorsque l’auteur doit s’astreindre au rythme particulier des médias, à leurs contraintes d’espace et de temps et à leur objectif, qui est de s’inscrire dans la plus grande proximité qui soit avec l’actualité. Même celles et ceux qui ont, parmi la grande famille du journalisme, plus de liberté dans le style, dans le ton et dans les opinions subissent ces mêmes contraintes qui nous poussent souvent à affirmer que l’écriture journalistique a une portée éphémère.
Pourtant, certains éditeurs se risquent à publier des recueils de textes journalistiques, principalement des chroniques, misant sur un potentiel intérêt pérenne pour ce type d’écrits. Les éditions Somme toute en ont même fait une spécialité avec leur collection « Écrits Chroniques », qui compte maintenant huit titres. Retour sur trois d’entre eux.
Le recul de l’éditorialiste
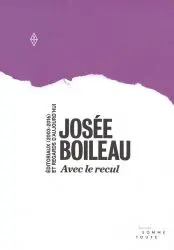 Les textes qu’a réunis Josée Boileau dans son ouvrage Avec le recul1 couvrent les années où elle était éditorialiste pour Le Devoir, entre 2003 et 2016. Encore plus que la chronique, qui peut avoir un aspect plus personnel et atemporel, l’éditorial est un genre journalistique franchement collé au présent. Il faut donc saluer le choix de l’éditorialiste et de son éditeur de regrouper les textes en fonction de certains thèmes et de proposer une introduction de chacune des sections qui nous permette à la fois une mise en contexte et une perspective. On a beau suivre de près l’actualité, notre rapport au temps est parfois incertain. Quand a commencé la grogne qui mena à la commission Charbonneau ? En quelle année l’affaire Bertrand Cantat ? En quelle année la dernière réforme scolaire ? Ces textes fort à propos nous permettent de relire les éditoriaux en ayant rafraîchi nos souvenirs de l’époque.
Les textes qu’a réunis Josée Boileau dans son ouvrage Avec le recul1 couvrent les années où elle était éditorialiste pour Le Devoir, entre 2003 et 2016. Encore plus que la chronique, qui peut avoir un aspect plus personnel et atemporel, l’éditorial est un genre journalistique franchement collé au présent. Il faut donc saluer le choix de l’éditorialiste et de son éditeur de regrouper les textes en fonction de certains thèmes et de proposer une introduction de chacune des sections qui nous permette à la fois une mise en contexte et une perspective. On a beau suivre de près l’actualité, notre rapport au temps est parfois incertain. Quand a commencé la grogne qui mena à la commission Charbonneau ? En quelle année l’affaire Bertrand Cantat ? En quelle année la dernière réforme scolaire ? Ces textes fort à propos nous permettent de relire les éditoriaux en ayant rafraîchi nos souvenirs de l’époque.
Parmi les six sections du livre, la première, celle sur l’éducation, retient tout particulièrement l’attention. Voilà un sujet que Josée Boileau maîtrise particulièrement bien, mais voilà surtout un sujet dont on parle sans arrêt sans pourtant qu’il soit vraiment au cœur des débats de société. Le texte de mise en contexte et les éditoriaux abordent ainsi les enjeux de l’analphabétisme, le débat sur les subventions aux écoles privées, les ratés administratifs ou communicationnels autour de différentes réformes, etc. La lecture de cette première section nous rappelle que souvent nous entamons les débats en ce domaine sans jamais les finir et jusqu’à quel point nous avons du mal à sortir de nos ornières familiales pour envisager l’éducation comme un enjeu de société. À propos des écoles privées, Boileau ne mâche pas ses mots et renvoie chacun à sa propre conscience : « Comment admettre que c’est son choix individuel, cumulé à celui des autres, qui a des effets déstructurants sur le système scolaire ? »
D’autres thèmes comme la corruption, l’accident de Lac-Mégantic et le féminisme offrent de très belles pages. Évidemment, un tel exercice exige des choix déchirants : une cinquantaine d’éditoriaux en treize ans de pratique, c’est trois fois rien. Bien qu’on comprenne pourquoi Josée Boileau décide, par exemple, de ne pas revenir sur la polémique autour du mariage homosexuel qu’elle considère comme enterrée depuis l’adoption de la loi, le petit harpon de la nostalgie nous donne envie de la relire à ce propos, ne serait-ce que pour attiser nos souvenirs de ce débat qui semble maintenant relever d’un autre siècle. Ce sera à chacun de mener, dans les archives, des recherches complémentaires puisque c’est aussi le mérite de ce livre que de nous donner envie de raviver notre mémoire proche.
L’artiste et le monde
Si le recueil de Tristan Malavoy, Feux de position2, couvre presque la même période (2004-2016), sa forme et son fond sont bien différents. Première différence majeure : pendant cette période, Malavoy a écrit pour plus d’un média. Une large part du recueil est constituée de chroniques parues dans Voir, mais on y trouve aussi des textes de diverses natures parus dans L’Actualité. Le dernier tiers du livre est d’ailleurs consacré à des entretiens menés par le journaliste avec des artistes. Le recueil de Malavoy présente donc une liberté de ton, très caractéristique de la chronique, et on retrouve dans ses textes la patte du littéraire autant que celle du journaliste.
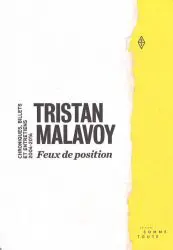 Normand Baillargeon le souligne dans la préface : Malavoy n’est pas un polémiste. Dans le paysage actuel, les chroniqueurs qui ne le sont pas font moins jaser que les autres. Avec la distance, ses propos n’en sont que plus forts. Même sur des sujets explosifs, il tente toujours de trouver la juste distance, non pas celle de la vaine objectivité, mais celle qui permettra un nouvel éclairage. L’écrivain-journaliste est en effet particulièrement posé, et si ce trait frappait le téléspectateur lorsqu’il était chroniqueur à Voir.tv, on « entend » cette même tempérance dans ses écrits, ce que Baillargeon appelle des « chuchotements ». Qu’il revienne sur l’affaire Cantat ou l’affaire Jutra, qu’il réfléchisse aux coupures en culture ou à la situation politique québécoise, Malavoy fait toujours preuve d’un calme bienvenu sans pour autant cacher ses convictions.
Normand Baillargeon le souligne dans la préface : Malavoy n’est pas un polémiste. Dans le paysage actuel, les chroniqueurs qui ne le sont pas font moins jaser que les autres. Avec la distance, ses propos n’en sont que plus forts. Même sur des sujets explosifs, il tente toujours de trouver la juste distance, non pas celle de la vaine objectivité, mais celle qui permettra un nouvel éclairage. L’écrivain-journaliste est en effet particulièrement posé, et si ce trait frappait le téléspectateur lorsqu’il était chroniqueur à Voir.tv, on « entend » cette même tempérance dans ses écrits, ce que Baillargeon appelle des « chuchotements ». Qu’il revienne sur l’affaire Cantat ou l’affaire Jutra, qu’il réfléchisse aux coupures en culture ou à la situation politique québécoise, Malavoy fait toujours preuve d’un calme bienvenu sans pour autant cacher ses convictions.
Comme dans d’autres recueils du même genre, on mesure le temps qui passe plus ou moins vite. On n’avait pas oublié, évidemment, l’hymne national du Québec écrit par Raôul Duguay, mais on avait oublié jusqu’à quel point cela se voulait sérieux. On avait aussi oublié qu’il fut une époque pas si lointaine où les prises de position de Mathieu Bock-Côté étonnaient encore.
Certains morceaux choisis touchent particulièrement. On pense au récit que Malavoy tire de sa rencontre avec Gaston Miron, mais aussi à l’entrevue avec Nelly Arcan parue en août 2004 à la sortie de son roman Folle, qui va droit au cœur. On y retrouve l’écrivaine brillante et réflexive qu’on connaît et en Tristan Malavoy, un lecteur attentif et humaniste. Le paragraphe final rappelant que le roman se termine sur le suicide du personnage de Nelly Arcan ne peut, aujourd’hui, être lu sans égratigner notre mémoire.
Le reportage que le journaliste tire de son voyage dans le Transsibérien et dont il me semblait au premier abord qu’il était moins cohérent avec le reste du livre se révèle pourtant une pièce maîtresse de celui-ci. Récit de voyage, journal littéraire, réflexions sociologiques, le texte d’une douzaine de pages d’abord paru dans L’Actualité méritait tout à fait d’être inclus dans cet ouvrage, qui permettra à ce récit de voyage d’atteindre de nouveaux lecteurs.
L’odeur de son prochain
Pour sa part, Émilie Dubreuil publie dans un recueil au titre caustique – L’humanité, ça sent fort3– une série de chroniques parues entre 2011 et 2017 principalement dans Voiret sur le site de MSN. Journaliste de profession, Dubreuil s’adonne à la chronique avec une plume d’écrivaine. Elle propose un genre de chroniques qui peut vraiment déranger – Dubreuil est la plus polémiste des trois auteurs présentés – mais dont il nous faut pourtant reconnaître l’efficacité et le style.
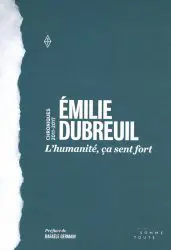 C’est donc en écrivaine que Dubreuil décrit le centre-ville de Montréal en janvier avec son « ciel de pot de mayonnaise vide », la Gaspésie et « ses noms de villages comme un poème de Gaston Miron », mais aussi les gens qu’elle croise, qu’ils soient des proches ou des inconnus. La description qu’elle fait de la jeune Bat Sheva, ancienne étudiante de français dans une école hassidique, a quelque chose de cinématographique. Cette chronique baptisée « Un jour, j’aurai une jolie perruque rousse », sans doute l’une de mes préférées, nous rappelle aussi qu’Émilie Dubreuil, en tant que journaliste, a travaillé sur des sujets qui ne sont pas banals. Pour ma part, c’est quand je sens cette rigueur de la journaliste que la chroniqueuse m’intéresse le plus.
C’est donc en écrivaine que Dubreuil décrit le centre-ville de Montréal en janvier avec son « ciel de pot de mayonnaise vide », la Gaspésie et « ses noms de villages comme un poème de Gaston Miron », mais aussi les gens qu’elle croise, qu’ils soient des proches ou des inconnus. La description qu’elle fait de la jeune Bat Sheva, ancienne étudiante de français dans une école hassidique, a quelque chose de cinématographique. Cette chronique baptisée « Un jour, j’aurai une jolie perruque rousse », sans doute l’une de mes préférées, nous rappelle aussi qu’Émilie Dubreuil, en tant que journaliste, a travaillé sur des sujets qui ne sont pas banals. Pour ma part, c’est quand je sens cette rigueur de la journaliste que la chroniqueuse m’intéresse le plus.
Parce que si Dubreuil fait preuve d’un niveau d’exigence qui est à son honneur – en matière culturelle, en ce qui concerne la langue française, en ce qui concerne les aspirations du peuple, etc. –, celui-ci se traduit parfois par un mépris qui se comprend mal. L’exemple le plus patent demeure le texte « Il ne se passe jamais rien au Québec », dont je me suis étonnée qu’il trouve sa place dans ce recueil. Même avec cinq ans de distance, on ne s’explique pas le traitement qu’elle réserve à une autre chroniqueuse, Judith Lussier, qui dénonçait en 2013 le harcèlement de rue dont elle s’estimait victime. Émilie Dubreuil semble croire qu’il s’agit là de faux problèmes, d’une espèce de narcissisme mal placé et compare la démarche de Lussier aux chroniqueurs qui nous parlent de leur passion pour la course à pied.
Ça étonne d’autant plus que dans le même livre on trouve une section essentiellement consacrée aux déboires amoureux et au célibat de la chroniqueuse et de nombreux textes dont la bougie d’allumage est très anecdotique (une chicane avec une certaine N.). Je n’ai rien contre ce type de chroniques qui, bien que personnelles, dessinent à traits incisifs des réalités qui résonnent très fort chez de nombreux lecteurs. Mais si on s’y adonne, il faut éviter d’insinuer que la vie des autres chroniqueurs a nécessairement moins de substance que la nôtre.
Mais ce bémol n’en est pas vraiment un puisque dès le titre le ton est annoncé : les gens puent un peu, et Émilie Dubreuil est de ces chroniqueurs qui veulent nous le rappeler. Elle s’inscrit ainsi dans une longue tradition où la chronique assume son fiel et où la qualité de la plume est un magnifique véhicule pour les colères, grandes et petites. Même quand elle nous enrage, son sens de la formule nous tire des sourires en coin.
1. Josée Boileau, Avec le recul. Éditoriaux (2003-2016) et regards d’aujourd’hui, Somme toute, Montréal, 2017, 320 p. ; 29,95 $.
2. Tristan Malavoy, Feux de position. Chroniques, billets et entretiens, 2004-2016, Somme toute, Montréal, 2017, 232 p. ; 24,95 $.
3. Émilie Dubreuil, L’humanité, ça sent fort. Chroniques 2011-2017, Somme toute, Montréal, 2017, 196 p. ; 22,95 $.
EXTRAITS
Et [le Parti québécois] ne voit toujours que ces souverainistes rendus ailleurs n’attendent pas un plan d’attaque, un calendrier, un mode d’emploi : ils veulent surtout que l’on respecte ce que eux ont à dire. Un Pierre Karl Péladeau, seul concurrent sérieux dans cette course à la chefferie qui n’est pas encore lancée, saurait-il ouvrir ces fenêtres-là ?
Josée Boileau, « Le lien à refaire », Le Devoir, 29 septembre 2014.
Je ressens de nouveau, mais pour d’autres raisons, l’impression ressentie mille fois durant ces longues journées à serpenter dans le paysage sibérien, constellé de cabanes où tant de Russes vivent de trois fois rien, parfois sans eau courante : ce pays est à cheval sur deux siècles. Le 21eet le 19e.
Tristan Malavoy, « Russie : la grande traversée », L’Actualité, 1ernovembre 2013.
Alors que tout le monde se déchire sur la proposition péquiste de charte de la laïcité, moi je pense à Bat Sheva. Elle est probablement heureuse avec une jolie perruque rousse. Le problème, c’est que si elle décidait de devenir fonctionnaire, ce ne serait pas la perruque le frein. Ce serait la déficience de sa scolarité. Déficience qui n’a jamais ému Janette Bertrand.
Émilie Dubreuil, « Un jour, j’aurai une jolie perruque rousse », MSN, 22 janvier 2013.









