« Écrire à quelqu’un, notait Pierre Vadeboncœur dans son essai L’absence. Essai à la deuxième personne, c’est souvent vivre avec lui d’une manière plus précise, plus aiguë, à la pointe du sens qu’il y a dans les êtres et qu’on touche par les mots1. »
C’est à cette enseigne que s’inscrit dès les premiers échanges la correspondance de Pierre Vadeboncœur avec Yvon Rivard, ce dernier lui avouant d’emblée qu’il ne le considère pas comme un aîné mais bien « comme un frère dont l’aventure [lui] est contemporaine et nécessaire ».
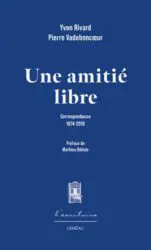 Pierre Vadeboncœur a entretenu plusieurs correspondances avec des essayistes, des philosophes, des romanciers, des journalistes, voire d’anciens camarades de classe devenus politiciens2. Celle qu’il a eue avec Yvon Rivard, regroupée sous le titre Une amitié libre, fait référence à un ouvrage de Vadeboncœur paru en 1970, Un amour libre. Elle prend naissance au moment où Rivard s’apprête à entreprendre une carrière universitaire. La rencontre avec Pierre Vadeboncœur a lieu chez François Ricard peu après la parution d’un ouvrage que le second avait consacré au premier et auquel Rivard avait participé. S’engage alors une conversation, aussitôt suivie par un échange de lettres qui s’étendra sur près de quarante années. Assidue à ses débuts, la correspondance qu’ils ont entretenue au fil des ans gardera la même intensité, la même richesse malgré d’inévitables interruptions. Sitôt qu’ils renouent, l’échange reprend avec la même exigence, la même force d’amitié. Pour Vadeboncœur, l’expression écrite n’a rien d’anodin. C’est presque l’âme même, écrit-il dans L’absence. « Et puis ces lettres offraient non seulement des représentations de nos vies, y écrit encore Vadeboncœur, mais la sensation de celles-ci, autant dire l’expérience même, par le truchement de quelque chose qui est lui-même expérience3. »
Pierre Vadeboncœur a entretenu plusieurs correspondances avec des essayistes, des philosophes, des romanciers, des journalistes, voire d’anciens camarades de classe devenus politiciens2. Celle qu’il a eue avec Yvon Rivard, regroupée sous le titre Une amitié libre, fait référence à un ouvrage de Vadeboncœur paru en 1970, Un amour libre. Elle prend naissance au moment où Rivard s’apprête à entreprendre une carrière universitaire. La rencontre avec Pierre Vadeboncœur a lieu chez François Ricard peu après la parution d’un ouvrage que le second avait consacré au premier et auquel Rivard avait participé. S’engage alors une conversation, aussitôt suivie par un échange de lettres qui s’étendra sur près de quarante années. Assidue à ses débuts, la correspondance qu’ils ont entretenue au fil des ans gardera la même intensité, la même richesse malgré d’inévitables interruptions. Sitôt qu’ils renouent, l’échange reprend avec la même exigence, la même force d’amitié. Pour Vadeboncœur, l’expression écrite n’a rien d’anodin. C’est presque l’âme même, écrit-il dans L’absence. « Et puis ces lettres offraient non seulement des représentations de nos vies, y écrit encore Vadeboncœur, mais la sensation de celles-ci, autant dire l’expérience même, par le truchement de quelque chose qui est lui-même expérience3. »
Au moment où s’amorce leur correspondance, Yvon Rivard n’a rien publié et Pierre Vadeboncœur s’interroge sur la continuité à donner à sa démarche d’essayiste. Bien qu’à des étapes différentes de leur vie, tous deux trouveront dans cet échange matière à approfondir leur réflexion, à leur permettre d’affronter les défis qui se posent à eux, que ce soit pour les questions formelles habitant Yvon Rivard au moment où il travaille à l’écriture de son premier roman ou, dans le cas de Vadeboncœur, pour des questions existentielles liées autant au devenir du Québec, à son évolution comme société libre et indépendante, qu’à son propre avenir comme essayiste, les deux étant chez lui inséparables. La défaite subie lors du premier référendum et la dissolution qui suivra du projet d’un Québec indépendant entraîneront chez Vadeboncœur des élans de pessimisme qu’il confie sans filtre à Rivard : « Mais vraiment, depuis plusieurs années déjà, ma vie est trop rude, et j’ai eu beau me soustraire, me couvrir, m’abriter, me blinder, me distraire, il y a des jours où perce la vérité du fond4 ».
Toute correspondance véritable exige un temps d’arrêt, de réflexion où l’on pose par écrit le sentiment qui nous habite, et qui devient à ce moment la seule vérité à partir de laquelle l’échange est possible, où l’on accepte parfois l’impolitesse de se confier sans fard, de livrer sans artifice le fond de sa pensée, tantôt maladroitement mais avec toute l’honnêteté dont on est capable, en sachant que l’ami lecteur en fera autant à d’autres moments. Pierre Vadeboncœur avouera ainsi ses difficultés existentielles passées, comme celles qu’il a éprouvées, à titre de lecteur, à pénétrer l’univers romanesque de Rivard, à se laisser porter par le mouvement qui s’y déploie, à communier par moments avec ses personnages, tout en lui reconnaissant d’immenses qualités sur le plan littéraire. Le problème, lui confiera-t‑il, c’est que ses romans sont difficiles d’accès. Loin de le contrarier, Rivard lui donnera parfois raison, interrogera sa propre démarche d’écrivain qui cherche à traduire l’harmonie recherchée entre la forme romanesque et l’essai qu’il pratique également, avant de lui répondre, Vadeboncœur lui ayant reproché le recours aux digressions dans Le siècle de Jeanne : « Mais tu as raison : “d’une façon générale, il faut beaucoup réduire” ; mais je dois concilier cette vérité avec cette autre, à savoir que “la force d’un livre c’est aussi son défaut”, que “toute création véritable est unique et se défend par son fait”5 ».
Les commentaires émis par Vadeboncœur sur les romans de Rivard trahissent parfois sa formation classique, les romans qui l’ont marqué et qu’a sans doute également lus Rivard, qui partage cette même culture classique. Mais là comme ailleurs, les sensibilités ont bougé, pourrait-on dire. On n’attend plus des personnages romanesques qu’ils soient porteurs de qualités humanistes, d’un idéal ou d’une morale, qu’ils soient animés de passions et portés par un destin plus grand que soi. On décèle par moments un accueil différencié quant à des expériences, des courants de pensée qu’ils ne partagent pas, pour diverses raisons. Ainsi, à l’attirance que connaît Yvon Rivard pour l’hindouisme, qui teintera son premier roman, Vadeboncœur rétorque ne rien comprendre à ce nirvana ni au reste du bataclan, pour reprendre ses propres termes. De spiritualité chrétienne, il ne recherche pas le vide mais tout élan qui le fera cheminer vers la joie et l’amour, et se moque de ceux qu’il qualifie de touristes de l’essentiel.
Vadeboncœur avouera par ailleurs à Rivard ses difficultés à aborder des œuvres telles que celles de Marie-Claire Blais ou d’Anne Hébert, qui se déployaient au début de leur relation épistolaire, ce qui n’empêche nullement celle-ci d’être riche et dynamisante autant pour l’un que pour l’autre. Leurs échanges sont dénués de toute forme de mollesse visant à épargner la sensibilité de l’autre, ce qui, dans le contexte que nous connaissons présentement, est des plus réjouissant et des plus stimulant pour le lecteur qui s’y engage à leur suite.
La correspondance qu’ont entretenue Yvon Rivard et Pierre Vadeboncœur sur près de quarante ans est riche à plus d’un égard : pour l’engagement qu’elle illustre dès lors que l’on accepte d’échanger véritablement, pour l’honnêteté de se livrer au regard de l’autre sans crainte d’être jugé, pour le refus de toute forme d’imposture intellectuelle mais, surtout, pour la générosité et la leçon d’amitié qu’elle nous offre.
1. Pierre Vadeboncœur, L’absence. Essai à la deuxième personne, Boréal Express, Montréal, 1985, p. 61.
2. Parmi ces correspondants, citons ceux avec qui les échanges épistolaires ont fait l’objet de publication : Paul-Émile Roy, Jean-Marc Piotte, André Major, Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre Elliott Trudeau.
3. Pierre Vadeboncœur, op. cit., p. 62.
4. Yvon Rivard et Pierre Vadeboncœur, Une amitié libre. Correspondance 1974-2010, Leméac, Montréal, 2022, p. 94.
5. Ibid., p. 155.
EXTRAITS
Qu’est-ce que l’âge, en fin de compte ? Ce n’est guère quelque chose de plus, c’est quelque chose de moins. Il n’y a qu’un petit avantage : avoir vu plus longuement les choses, les avoir plus longuement pesées. Pouvoir parler aussi des origines, de ce que vous n’avez point vu. Mais pour ce qui est de la source, c’est-à-dire de l’essentiel et de la création, ce n’est certes pas en être plus proche, c’est risquer d’en être plus loin. Alors il n’y a pas de quoi se vanter !
Une amitié libre, P. Vadeboncœur, le 18 mai 1976, p. 46.
Tu comprends, je descends d’une culture foncièrement positive, non d’une culture de la négation, du scepticisme et du désabusement. Pour une bonne part à cause de cette culture mais à cause de mon tempérament aussi, toute ma vie – affective, sociopolitique, littéraire – a été sous le signe de la plénitude.
Une amitié libre, P. Vadeboncœur, le 7 décembre 1995, p. 122.
C’est cette exigence formelle, par exemple une plus grande incarnation, dans laquelle tu vois très justement le passage du premier au deuxième roman, et surtout la problématique même de la création. Je ne sais pas encore s’il y aura « création » dans le deuxième, mais je sais maintenant qu’écrire consiste à résoudre des problèmes formels de plus en plus complexes. Bref, je commence à comprendre Valéry.
Une amitié libre, Y. Rivard, le 30 janvier 1977, p. 71.
Ces grands problèmes de forme que tu évoques me rassurent : c’est l’œuvre qui se fait sa vraie place, c’est sa matière qui fait sentir ses exigences. Si tu n’avais pas ces problèmes, je croirais beaucoup moins au résultat.
Une amitié libre, P. Vadeboncœur, le 19 février 1978, p. 91.
Un monde s’effrite, un autre se trame. Et voici que cette lettre où tu confesses un désespoir (tu n’aimeras pas ce mot, mais sache qu’il est pour moi synonyme de lucidité et d’espoir) agit sur moi avec la violence bienheureuse des défis. De quels défis s’agit-il ? Je l’ignore encore. L’art, peut-être, mais surtout l’appel d’une conscience élargie (à laquelle l’art n’est pas étranger, bien sûr) qui me permette enfin de connaître, et de vivre dans la fidélité à cette connaissance quelle qu’elle soit.
Une amitié libre, Y. Rivard, le 4 mars 1978, p. 96.
Ce sera vraisemblablement le sujet de mon prochain roman [Le milieu du jour], cette exploration de la vie telle qu’elle se révèle à nous à travers l’expérience des sentiments. Je crois cependant et bien modestement que j’ai fait un pas dans cette direction, que je me suis rapproché un peu de ce que j’appelle depuis quelques années « le réel », c’est-à-dire tout ce qui se trouve à l’extérieur de moi (personnes, choses, lieux, etc.) et qui n’a pas encore été – ou trop peu – transformé ou déformé par mon imagination ou ma raison.
Une amitié libre, Y. Rivard, le 24 janvier 1987, p. 113.











