Qui d’autre que Robert Lévesque pourrait amorcer un article en faisant à la fois référence à Proust, à Lénine, à Breton, à Hitler et à Kafka, en établissant entre chacun un lien, tout en respectant le cadre temporel dans lequel interagissent ces témoins appelés à la barre, et ce, dans une même phrase ?
D’entrée de jeu, le « lecteur impuni » qu’est Robert Lévesque, qui a réuni sous ce titre1 un ensemble d’articles d’abord parus dans la revue Liberté, annonce ses couleurs : il aime les chats, Bernard Frank et les digressions. À l’exception du terme médian, chaque fois remplacé par un auteur différent, ce constat demeure. Robert Lévesque passe d’un sujet à l’autre avec une agilité féline, sautant du canapé où il prend ses aises à l’appui d’une fenêtre où il trouve à méditer, et parfois à médire sur la marche du monde. De Bernard Frank, il retient : « [Il] fit de la digression lettrée un art, de la curiosité journalistique une science, de la nonchalance un sport. J’avais avec lui des affinités électives, l’amour des chats […], le plaisir de la relecture, la désinvolture, la crème sure, la gelée de mûres, l’emprise de la littérature sur la vie réelle ». À cela, j’ajouterais le plaisir évident des allitérations, et cette aptitude à traiter les sujets qu’il aborde, anecdotes le plus souvent liées à ses auteurs de prédilection, avec tout le sérieux qu’ils méritent sans toutefois se prendre lui-même au sérieux.
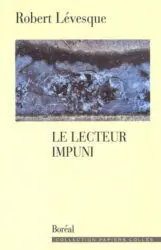 Esprit libre, Robert Lévesque a fait sien ce constat de Jean-Pierre Issenhuth en qui il reconnaît un frère d’armes : « J’ai persévéré dans l’idée que la critique – fausse science – ne se justifie qu’en risquant de se tromper. […] Mais comme elle ne peut prétendre au statut de science exacte qu’en s’illusionnant complètement, il lui faut tendre au statut d’art, sinon elle n’est rien ». Et cet art repose avant tout sur la lecture, qu’on devine ici être le socle d’une vie, et les relectures qui ont développé et aiguisé cette capacité à apprécier une œuvre sans bruit, à discerner l’honnêteté de la démarche de l’artiste. Se référant à Marivaux, Robert Lévesque avoue avoir toujours pensé qu’il écrivait pour un seul lecteur, plus intelligent que lui, ce qui expliquerait ce penchant à vouloir parfois en mettre plein la vue, à verser, comme il le souligne, dans le « badinage de réflexion ». Rendre compte d’une œuvre, littéraire ou théâtrale, l’analyser, la décortiquer pour mieux en apprécier les rouages, les subtilités, voire les zones d’ombre qui peuvent se dérober à une lecture hâtive, échappe ici à l’esprit de sérieux dont certains se revêtent parfois pour épouser une posture, à l’opposé de celle adoptée par Lévesque. « Examiner et s’amuser : le propre des fins chroniqueurs », nous rappelle-t-il fort justement. Le style qu’il adopte, outre son penchant pour les allitérations et les digressions, repose tantôt sur la comparaison, le plus souvent revisitée pour accentuer l’effet de raillerie recherché, et tantôt sur l’ironie, qu’il apprécie chez d’autres et en quoi il excelle.
Esprit libre, Robert Lévesque a fait sien ce constat de Jean-Pierre Issenhuth en qui il reconnaît un frère d’armes : « J’ai persévéré dans l’idée que la critique – fausse science – ne se justifie qu’en risquant de se tromper. […] Mais comme elle ne peut prétendre au statut de science exacte qu’en s’illusionnant complètement, il lui faut tendre au statut d’art, sinon elle n’est rien ». Et cet art repose avant tout sur la lecture, qu’on devine ici être le socle d’une vie, et les relectures qui ont développé et aiguisé cette capacité à apprécier une œuvre sans bruit, à discerner l’honnêteté de la démarche de l’artiste. Se référant à Marivaux, Robert Lévesque avoue avoir toujours pensé qu’il écrivait pour un seul lecteur, plus intelligent que lui, ce qui expliquerait ce penchant à vouloir parfois en mettre plein la vue, à verser, comme il le souligne, dans le « badinage de réflexion ». Rendre compte d’une œuvre, littéraire ou théâtrale, l’analyser, la décortiquer pour mieux en apprécier les rouages, les subtilités, voire les zones d’ombre qui peuvent se dérober à une lecture hâtive, échappe ici à l’esprit de sérieux dont certains se revêtent parfois pour épouser une posture, à l’opposé de celle adoptée par Lévesque. « Examiner et s’amuser : le propre des fins chroniqueurs », nous rappelle-t-il fort justement. Le style qu’il adopte, outre son penchant pour les allitérations et les digressions, repose tantôt sur la comparaison, le plus souvent revisitée pour accentuer l’effet de raillerie recherché, et tantôt sur l’ironie, qu’il apprécie chez d’autres et en quoi il excelle.
Longtemps journaliste, Robert Lévesque a conservé de cette pratique le souci du détail, l’importance de creuser ses sujets, de croiser ses sources et, peut-être l’aspect le plus important pour un chroniqueur, de savoir piquer et maintenir la curiosité du lecteur. Il donne souvent l’impression de tout connaître des écrivains et des créateurs dont il nous entretient, d’avoir été convié sinon à la même table, du moins à celle d’à côté, notant bribes de conversation et anecdotes qui éclaireront la genèse ou un aspect d’une œuvre, ou qui simplement nous feront sourire. Les articles consacrés à François Moreau et à Jean-René Huguenin, figures dans lesquelles il reconnaît des liens fraternels, en sont de bons exemples. Cette curiosité, sans doute innée chez lui, l’amène à déterrer des détails qui échapperaient à plus d’un biographe. Robert Lévesque ne craint pas de donner par moments dans le rocambolesque. Nous apprenons ainsi que Kafka, désireux à un certain moment de quitter la Tchécoslovaquie, avait envisagé de devenir restaurateur à Tel-Aviv et, du même souffle, que son ami Max Brod avait confié, quelques années plus tard, les précieux manuscrits que Kafka lui avait remis, avec obligation de les détruire, à une hôtesse de l’air qui, à son tour, les léguera à sa fille. L’auteur de La métamorphose s’est sans doute plus d’une fois retourné dans sa tombe.
À d’autres moments, Lévesque laisse libre cours à des souvenirs plus personnels, réminiscences d’enfance et de jeunesse qui ont pour cadre Rimouski, d’où il est originaire. La liste de souvenirs qu’il ravive n’aurait sans doute pas déplu à Georges Perec, évoqué ici comme tant d’autres écrivains que Lévesque affectionne. Le théâtre et les écrivains qui auront forgé sa sensibilité demeurent toutefois son territoire de prédilection. Lévesque a un faible pour les auteurs que l’on qualifie souvent de marginaux, en raison de leurs positions politiques ou artistiques. Peter Handke, Patrice Chéreau, Bernard-Marie Koltès, Walter Benjamin, Mordecai Richler, Jean Genet, Valery Larbaud, Louis-Ferdinand Céline, Knut Hamsun figurent parmi tant d’autres au nombre de ces derniers.
Proust, dans une des rares préfaces qu’il signa, nous rappelle Lévesque, disait de la lecture qu’elle ouvre « au fond de nous-même la porte des demeures où nous n’aurions pas su pénétrer ». Robert Lévesque, pourrions-nous dire à notre tour, se plaît à être tout à la fois le cerbère et l’humble serviteur de celles où il nous invite à le suivre dans Le lecteur impuni.
1. Robert Lévesque, Le lecteur impuni, « Papiers collés », Boréal, Montréal, 2020, 202 p. ; 25,95 $.
EXTRAITS
Ce matin-là, le mardi 5 juillet 2011, sur la véranda de la maison d’été de Gabrielle Roy, j’entrai, lecteur décidé et confiant, dans La Nuit morave de Peter Handke, une nuit sur papier qui allait faire 398 pages et je pensai à l’idée d’une nuit-fleuve…
p. 62
Cette découverte d’un jeune homme exalté et chagrin, péremptoire et inquiet, déterminé à se conquérir à coups de cravache et qui se jurait : « Je n’aimerai jamais mon prochain, si mon prochain est un imbécile », avait marqué les jours et les nuits de mes vingt et un ans…
p. 77
« Intempestif » est un adjectif que j’affectionne, il signifie de l’inopportun, du déplacé, quelque chose qu’il n’est pas convenable de faire, et ce Perros était justement un écrivain qui ne se privait point d’inconvenance…
p. 123











