Dire que les médias vivent une transformation profonde est un truisme. Deux essais québécois portent chacun leur regard sur cette crise, chacun avec ses diagnostics et ses pronostics.
La numérisation est certainement un des grands agents de cette transformation. Mais il y en a d’autres, comme l’avènement des médias sociaux et, de plus longue date, celui des chaînes d’information continue. Il y a aussi l’évolution des mentalités : d’une part, l’instantanéité transforme notre rapport à l’actualité. D’autre part, la nouvelle force de consensus autour de certaines vertus – progressisme portant enfin ses fruits pour les uns, fermeture portant le nom d’ouverture dans une logique orwellienne pour les autres – modèle profondément le lectorat et l’auditorat dans un clivage aux contours inquiétants.
Journal d’une extinction annoncée
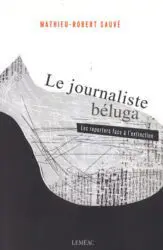 Mathieu-Robert Sauvé, en lançant dans son titre même la formule-choc du « journaliste béluga1 », sonne résolument l’alarme : « D’après le centre de recherche Pew, aux États-Unis, le quart des emplois de journalistes ont disparu au cours de la dernière décennie ». Du côté du journalisme international, même saignée : « Entre 1998 et 2011, pas moins de vingt grands journaux américains ont fermé leurs bureaux à l’étranger ».
Mathieu-Robert Sauvé, en lançant dans son titre même la formule-choc du « journaliste béluga1 », sonne résolument l’alarme : « D’après le centre de recherche Pew, aux États-Unis, le quart des emplois de journalistes ont disparu au cours de la dernière décennie ». Du côté du journalisme international, même saignée : « Entre 1998 et 2011, pas moins de vingt grands journaux américains ont fermé leurs bureaux à l’étranger ».
Ce cri n’est pas seulement celui du journaliste qui se sent lui-même menacé. C’est aussi celui du citoyen qui croit à la nécessité du quatrième pouvoir. À l’ère de l’information-spectacle et de la fake news, on a plus que jamais besoin du journaliste, ce héraut de l’information objective : « Vérifier les sources, authentifier les déclarations, aller voir si c’est vrai, poser des questions, c’est le travail quotidien des reporters ».
Il faut dire que cet idéal d’objectivité du journaliste, né au début du XXe siècle, est mis à mal depuis quelques décennies. D’abord, la notion même d’objectivité perd de son lustre, et notre société n’a pas attendu les fake news pour cela. Par ailleurs, le monde journalistique lui-même ne serait-il pas devenu de plus en plus cynique ? À cet égard, l’anecdote de Jean-François Lisée se voyant refuser par le réseau anglais de Radio-Canada un reportage sur la Chine qui était passé sans problème sur le réseau français est révélatrice : l’angle est un facteur incontournable, partout, toujours. Le filtre est nécessairement dans les médias, pour le meilleur ou pour le pire. Et la désaffection du grand public pour les médias pourrait bien s’expliquer par une justification… objective.
Tout en refusant de renoncer à cet idéal classique qui, sous sa plume, semble parfois sorti tout droit d’un cours universitaire, Sauvé ne ferme pas les yeux sur les travers de son monde. Sa description de la relation entre les scientifiques et les journalistes s’avère à cet égard instructive : cette relation est d’abord marquée du sceau de la méfiance. Méfiance justifiée ? Sauvé ne l’avoue pas, bien qu’il explique les causes de cette attitude de façon convaincante. Le « club des mal cités » regorge de membres chez les chercheurs. Il semble que le souci d’exactitude qui doit animer le journaliste consciencieux n’arrive pas à coïncider avec celui du chercheur. Pourquoi ?
C’est entre autres parce qu’il y a, dans la bien nommée « meute » de journalistes, « le mordant ». « Ce journaliste fait peur. Il peut ruiner votre carrière. Il n’hésitera pas à le faire. D’ailleurs, il est payé pour ça. » Tout le monde s’en méfie : non seulement le scientifique, mais aussi l’artiste, le politicien et même le quidam abordé dans la rue.
Comme autre type de dérive, Sauvé ne passe pas par quatre chemins pour dénoncer, par exemple, les ressources démesurées consacrées par La Presse+ à une nouvelle comme le passage de Gilbert Rozon au poste de police pour soupçons de « violences de nature sexuelle » : « On comprend que quatre personnes de la salle de rédaction […] ont été mobilisées le 8 janvier pour couvrir cette ‘affaire’. […] Je ne veux pas minimiser la gravité des gestes présumés […], mais je m’interroge sur l’effort déployé par tant de journalistes aguerris autour de ce non-événement ».
La profusion de chroniqueurs, historiquement alimentée par la popularité et le talent inégalé de Pierre Foglia, n’aide pas non plus la cause : certes, on a besoin d’opinions, mais il faut aussi des faits pour les étayer. Or pour l’entreprise de presse, les premières coûtent beaucoup moins cher à produire et rapportent nettement plus que les seconds.
C’est ainsi que, mine de rien, au-delà de son titre catastrophe, Sauvé nous livre de manière compacte un solide tour d’horizon du monde du journalisme, incluant non seulement son histoire, mais aussi les diverses formes sous lesquelles il se décline : journalisme sportif, scientifique, politique, d’enquête, de faits divers, de guerre.
Mais on veut quoi ?
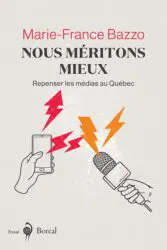 Tout en adoptant elle aussi une posture critique à l’égard des médias dans Nous méritons mieux2, Marie-France Bazzo oriente davantage son propos vers ce qu’on pourrait et devrait faire ; l’idéal présenté ici ne se limite pas à la louange théorique des bienfaits du journalisme objectif, mais prend plutôt la forme de propositions d’une productrice qui a vécu dans sa chair les bousculements médiatiques des 20 dernières années et qui cherche toujours à rendre réel son idéal, malgré des embûches nombreuses et parfois insurmontables en apparence.
Tout en adoptant elle aussi une posture critique à l’égard des médias dans Nous méritons mieux2, Marie-France Bazzo oriente davantage son propos vers ce qu’on pourrait et devrait faire ; l’idéal présenté ici ne se limite pas à la louange théorique des bienfaits du journalisme objectif, mais prend plutôt la forme de propositions d’une productrice qui a vécu dans sa chair les bousculements médiatiques des 20 dernières années et qui cherche toujours à rendre réel son idéal, malgré des embûches nombreuses et parfois insurmontables en apparence.
Cela dit, son diagnostic n’est pas moins dur. Il l’est même plus. Car là où Mathieu-Robert Sauvé reste dans la ligne des gentils idéalistes, Bazzo n’hésite pas à sauter dans le ring. « Voici un livre qui n’enrichira pas ma banque d’amis dans le ‘milieu’ », reconnaît-elle d’emblée. Au Québec, ce « milieu » est petit, tout le monde le sait, et Bazzo a fait partie du « centre du milieu » pendant plus de 25 ans, animant des émissions très populaires à Radio-Canada. Or un beau vendredi matin en 2015, la directrice de la radio lui annonce qu’elle quittera les ondes. « Sans explications. (Je n’en aurai d’ailleurs jamais.) Net frette sec. » Pourrait-on en conclure que son essai est une sorte de vengeance ? La solidité du propos général et la passion sincère qui l’anime ne sauraient étayer cette hypothèse. Le lien entre les deux événements est décrit bien simplement dans l’avant-propos : « Je possède désormais la liberté de parler de ce que je vois et comprends, de ce que je souhaite pour rendre les médias meilleurs ». Elle précise fort justement : « Ma liberté de parole aura été chèrement acquise ».
Bazzo répond d’une certaine façon aux préoccupations de Sauvé en osant une véritable remise en question. Au sujet de la fameuse crise des médias (qu’elle décrit plus exactement comme une « crise de confiance envers les médias, quelque chose comme un désamour »), elle affirme : « [J]e perçois un grand silence sur le fond de l’affaire. Peut-être parce qu’on aime bien voir les raisons de cette crise comme extérieures […]. Oui mais, si la crise des médias était aussi due à un problème grandissant de pertinence ? »
En fait, les défauts prêtés au monde des médias se recoupent en partie dans les deux ouvrages, mais Bazzo n’hésite pas à appeler un chat un chat : la dématérialisation des médias, l’envahissement du marché publicitaire par les GAFAM et la vitesse de l’information ne sauraient expliquer la « rupture avec le public ». La sociologue de formation dénonce ainsi non seulement la mécanique changeante du marché, mais aussi les orientations de contenu, qui, elles, dépendent beaucoup de « nous ». Par exemple, comme d’autres, elle constate que les médias « deviennent des machines à fabriquer du consensus, à propulser des idéologies ». Comment s’étonner dès lors que le public prenne ses distances ? « Ce n’est pas pour rien que de plus en plus de personnes se tournent vers les balados. » D’où une des lignes de force de l’ouvrage : « Dans ce milieu médiatique, on sous-estime constamment […] l’intelligence du public ».
Le politiquement correct et le manque de diversité (des opinions) en prennent évidemment pour leur rhume. Sont aussi dénoncés « l’esprit de clique qui prévaut dans beaucoup d’émissions actuelles » et « la dictature des A », ces vedettes incontournables que tous les producteurs veulent avoir sur leur plateau pour booster l’audience – et tant pis si c’est à une actrice ou à un humoriste et non à une épidémiologiste, à un politologue ou à une intellectuelle qu’on demande son avis trois fois par semaine sur les mesures sanitaires, la liberté d’expression ou tout autre grand enjeu de l’heure.
Par ailleurs, si Bazzo dénonce comme Sauvé la prolifération du commentaire, elle ne l’oppose pas tant à l’amoindrissement du journalisme d’enquête qu’à notre ignorance collective de l’art véritable du débat. Les tables rondes, au Québec, sont soit désespérément consensuelles, soit axées sur un clivage stérile entre le camp du Bien et le camp du Mal, soit chirurgiquement ponctuées de blagues dès que le propos risque de devenir trop sérieux.
Nous méritons mieux
De ces deux panoramas étoffés, on retiendra l’ouvrage didactique de Sauvé pour l’exposé informationnel et l’ouvrage percutant de Bazzo pour le plan de match.
1. Mathieu-Robert Sauvé, Le journaliste béluga. Les reporters face à l’extinction, Leméac, Montréal, 2020, 199 p. ; 24,95 $.
2. Marie-France Bazzo, Nous méritons mieux. Repenser les médias au Québec, Boréal, Montréal, 2020, 210 p. ; 19,95 $.
EXTRAITS
Dans le débat sempiternel sur la crise des médias, on ne dira jamais assez à quel point ces derniers se ressemblent de manière confondante lorsqu’il s’agit de l’orientation de la pensée.
Nous méritons mieux, p. 102.
Ce n’était pas à une discussion que j’étais invitée ni à un débat, mais à un tribunal : comment avais-je osé ? J’étais accusée, campée dans le rôle de la traîtresse.
Nous méritons mieux, p. 172.
Nous méritons des médias qui nous ressemblent : curieux, ouverts, dynamiques, et qui tendent vers le meilleur.
Nous méritons mieux, p. 208.
Les recettes publicitaires des médias imprimés ont baissé de 25 % en cinq ans […].
Le journaliste béluga, p. 20.
Bienvenue à l’ère du journaliste qui se regarde le nombril.
Le journaliste béluga, p. 96.
Si votre journal vous présente une information inexacte ou carrément mensongère, vous n’allez pas le racheter. […] Or dans le web, c’est tout le contraire qui se produit. Plus une nouvelle est grossière et mensongère, plus elle circule.
Le journaliste béluga, p. 192.










