Dans son premier livre, Émilie Turmel empruntait ces mots de Nelly Arcan : « La honte est une lignée de femmes à perte de vue, qui se boucle en cercles, en nœuds de pendu qui accouchent les uns des autres ». Avec Vanités1, la poète se penche sur l’une des femmes de cette lignée.
Après avoir offert un livre qui dressait sa filiation littéraire, la poète s’adresse à celle qui l’a mise au monde et explore les glissements de la fille à la mère, de la mère à la fille. Suivant le mouvement du sang qui coule comme rivière, à la manière d’une illusion, l’enfant, pendant un moment, est épargnée, protégée. Pourtant, sur elle, la mère a un pouvoir immense : elle peut idolâtrer, elle peut détruire.
Deux femmes se tiennent chacune d’un côté du miroir. Entre ressemblances physiques et legs émotif, mémoire et blessures transmises, la poète défriche des territoires intérieurs calmes, mais aussi des espaces où tout flambe. Les poèmes de la suite « Feux et figures » disent l’éblouissement face à la beauté autant qu’ils exposent la découverte de zones sombres où se terrent la haine de soi, le corps à apprivoiser, les dangers d’être née femme. Comment trouver l’équilibre et le maintenir, entre les jeux de la séduction, les gestes de la beauté, l’envie d’être désirée ? Comment éviter que le piège ne se referme sur ces corps fardés, maquillés, à entretenir ?
« [B]lanc jaune bleu violet rose / de mes tripes empêtrées j’extirpe / mouchoirs et bouquets / un semblant de magie » : dans un jeu d’échos, ce poème reprend les couleurs qui donnent leurs noms aux sections de « Casse-gueules ». Le désir de se lier à d’autres femmes n’est pas loin, comme en témoigne ce poème en clin d’œil à Virginia Woolf : « [J]e porte débâcles et feux / organes sacrés / d’un même printemps / où se pendent aux branches / les fruits rares et brillants de l’art », mais la poète choisit ici de quitter les filiations adoptives pour embrasser le lien du sang.
Dans l’entre-miroirs
Dans « Foyers et visages », deuxième partie du livre, les blessures enfouies de la mère attendent, « dorment dans mon sang / comme une portée de chiots / noyés avant l’hiver ». Elles menacent de se réveiller à tout moment. L’histoire se répète. On transmet le meilleur comme le pire, la mort comme la vie : « [À] bout d’encre et d’électricité / tu prends la mesure de la catastrophe / nous avons tous les âges de l’abandon / et l’art infus du sabotage / c’est ainsi trahir / toujours intime ».
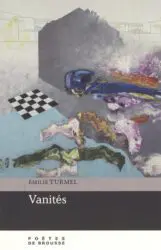 La poète s’infiltre dans l’intime, creuse le désir de plaire et ses contradictions, interroge ce qu’on y laisse, ce qu’on y gagne. Face à la colère partagée, elle hésite : y céder ou lutter ? Le thème de l’héritage traverse tout le livre. Émilie Turmel nomme ce que la mère lui lègue, « une joie de fortune », l’apprentissage du dessin, l’art du maquillage et tout ce qu’il camoufle de douleur, « la grâce des postures intenables ». Vanités est fait de nombreuses collisions : le désir de liberté, la conscience de ses contradictions, le fait d’aimer être aimée et la tentative d’assumer cet aveu, « le plus délicat dédale du sang ». Les femmes de Vanités en appellent à une force plus grande qu’elles pour se libérer du poids de l’héritage, incapables de le fuir ou de bien vivre avec lui.
La poète s’infiltre dans l’intime, creuse le désir de plaire et ses contradictions, interroge ce qu’on y laisse, ce qu’on y gagne. Face à la colère partagée, elle hésite : y céder ou lutter ? Le thème de l’héritage traverse tout le livre. Émilie Turmel nomme ce que la mère lui lègue, « une joie de fortune », l’apprentissage du dessin, l’art du maquillage et tout ce qu’il camoufle de douleur, « la grâce des postures intenables ». Vanités est fait de nombreuses collisions : le désir de liberté, la conscience de ses contradictions, le fait d’aimer être aimée et la tentative d’assumer cet aveu, « le plus délicat dédale du sang ». Les femmes de Vanités en appellent à une force plus grande qu’elles pour se libérer du poids de l’héritage, incapables de le fuir ou de bien vivre avec lui.
« Dérèglement des focales », dernière partie du livre, vient distordre le regard. La poète joue sur la métamorphose, la dévoration. Il y a une femme en larmes, dans une salle de bain, avant la fracture, avant la brèche, là où tout craque. Le regard de la fille se fait plus direct. On plonge au cœur de la dépression, de la douleur, du trop-plein sur les épaules, du « cri dédoublé de la mère à l’enfant ». Cette suite est le reflet déformé de la première, les poèmes se déploient suivant de nouveaux axes, dans un jeu de miroirs et de répétitions.
Les monstres guettent, mère et fille tentent de les contenir, de les dominer. Où se trouvent ces lieux où les masques tombent une fois pour toutes, où il n’y a plus de rôles à tenir, simplement deux femmes côte à côte ? « [J]e cherche le foyer / où nos voix résonnent à rebours / l’entre-miroirs comme outre-limbes », « l’entre-miroirs / n’est ni souvenir ni prémonition / mais chambre d’écho ».
À travers une écriture charnelle qui fait appel au lexique du corps, de la féminité (lèvres, jupes, cheveux, seins, hanches, fards, maquillages, fluides et imaginaire de l’eau, de la salle de bain, des miroirs, ces lieux que connaissent si bien certaines femmes), Émilie Turmel offre des poèmes brefs qui éclatent comme pierres précieuses, qui se tendent comme des fils de fer entre mères et filles, semés de dépendance, d’amour, de haine, de rejet et d’adoration. N’est-il jamais possible d’échapper à la force d’attraction des miroirs, à la transmission qui contamine le sang ? Quoi faire, finalement, de cette attache belle et monstrueuse, sinon y céder, ou alors la briser à jamais ?
* Photo d’Émilie Turmel : © Jérôme Luc Paulin
1. Émilie Turmel, Vanités, Poètes de brousse, Montréal, 2020, 78 p. ; 17 $.
EXTRAITS
l’entre-miroirs n’est pas une zone neutre
ni une tranchée ni même une frontière
personne ne franchit le seuil
de la nudité
il faut avoir arraché soi-même les peaux
à l’extrémité d’étreindre
pour le savoir
p. 75
quand je reviens sur tes pas
je te retrouve toujours en larmes
dans la même pièce froide
la salle de bain de mon enfance
marbre vert murs verts
forêt
ta couleur préférée
avant le grand incendie
p. 62
à bout d’encre et d’électricité
tu prends la mesure de la catastrophe
nous avons tous les âges de l’abandon
et l’art infus du sabotage
c’est ainsi trahir
toujours intime
p. 43











