Récemment, la rectitude politique mettait à sa main l’un des monstres sacrés de la littérature policière occidentale. Oubliez les Dix petits nègres d’Agatha Christie (Ten Little Niggers / Ten Little Indians / And Then There Were None) ; dorénavant, vous pourrez lire, en lieu et place du classique, Ils étaient dix. La plus récente version française de l’ouvrage, réédité par les éditions du Masque, a aussi été expurgée de ses 74 occurrences du N* word. Au même moment, la reporter Wendy Mesley payait de son poste à l’émission The Weekly de la CBC pour avoir prononcé l’imprononçable, en référence à la charge anticolonialiste de Pierre Vallières, N* blancs d’Amérique. Puis le dernier esclandre en date est venu de l’Université d’Ottawa. La professeure Verushka Lieutenant-Duval, expliquant le concept de resignification subversive, a commis l’impair de citer en exemple la réappropriation positive de l’insulte n*gger par la communauté noire américaine. L’histoire a fait le tour des médias.
On muselle la parole sous le prétexte qu’elle blesse. On la formate, on l’euphémise afin de la rendre bien lisse et qu’elle ne crée d’accrocs nulle part. Mais alors que les accusations de rectitude étaient traditionnellement formulées par la droite, qui se positionnait de fait en gardienne de la liberté d’expression, elles proviennent aujourd’hui de l’intérieur même d’une gauche plus que jamais divisée, en partie d’ailleurs à cause de cette même rectitude. Quatre essais parus au cours de la dernière année apportent un éclairage utile sur ces questions complexes et les nouvelles formes qu’elles revêtent.
L’origine de l’impasse
 Les impasses de la rectitude politique1 offre un virulent réquisitoire contre la bien-pensance doucereuse qui, de plus en plus, dicte les règles de la conversation démocratique. De l’avis de Pierre Mouterde, spécialiste des mouvements sociaux de l’Amérique latine, la rectitude politique se comprend donc, en première analyse, comme un regard particulier sur les choses et les événements. Un regard déterminé en outre par un ensemble de puissantes injonctions sociales en dehors desquelles dire son avis peut s’avérer périlleux.
Les impasses de la rectitude politique1 offre un virulent réquisitoire contre la bien-pensance doucereuse qui, de plus en plus, dicte les règles de la conversation démocratique. De l’avis de Pierre Mouterde, spécialiste des mouvements sociaux de l’Amérique latine, la rectitude politique se comprend donc, en première analyse, comme un regard particulier sur les choses et les événements. Un regard déterminé en outre par un ensemble de puissantes injonctions sociales en dehors desquelles dire son avis peut s’avérer périlleux.
Pour l’auteur, cette « tyrannie soft des bonnes manières » s’installe lentement dès le début des années 1980, portée par la montée du néolibéralisme et l’émergence parallèle de logiques culturelles dites postmodernes. Ensemble, ces nouveaux paradigmes établissent la prévalence des droits individuels sur les droits collectifs : « [L]a pensée postmoderne, précise-t-il, va s’attacher plutôt à l’individu et aux multiples discriminations individuelles qui pourraient éventuellement l’affecter, ou encore aux oppressions et discriminations diversifiées qui pèsent sur des secteurs particuliers de la société, sur certains groupes identitaires ».
Vu son lien constitutif avec le langage, la rectitude se cantonne à la surface des phénomènes qu’elle rebaptise. Car le mot n’est malheureusement pas la chose, pas plus que les effets ne se confondent avec les causes. En ce sens, la rectitude équivaut à une sorte de culte des apparences, elle revient à balayer sous le tapis bien propre de la moralité des problèmes qui demeurent, dans leur fondement, irrésolus. Pour cette raison, elle est aussi le domaine par excellence de la vertu ostentatoire et de l’indignation facile.
Ce changement de cap a une incidence sur l’action politique. Dans l’un des passages les plus intéressants de son essai, le sociologue distingue deux types d’action, moral et politique. Le premier est adopté sur la base d’une réponse individuelle à la question éthique « Que dois-je faire ? » La rectitude, par exemple, se situe du côté de l’action morale. Le second répond collectivement, par des moyens organisés, à la question « Que pouvons-nous faire ensemble ? » D’un côté le devoir être individuel, de l’autre, le pouvoir faire collectif, résume l’essayiste. On peut à bon droit se demander dans quelle mesure ces deux types d’action s’excluent mutuellement. Pour un homme engagé comme Mouterde, on devine toutefois que l’action politique est la plus méritoire. C’est bien pourquoi il déplore la dégradation de la lutte collective sous l’impulsion malsaine de la rectitude.
S’il est souvent très juste, le propos du sociologue se teinte par moments d’une nostalgie qui le pousse à idéaliser le passé pour mieux s’accabler devant le présent. Et son alarmisme un peu forcé rejoue alors la rengaine d’une époque aux abois. Par exemple, là où il perçoit les indices d’une crise – le Printemps érable, les Indignés, les Gilets jaunes –, on peut tout autant entendre la saine expression démocratique du mécontentement populaire. Son essai n’en dessille pas moins les yeux sur de nombreux aspects pervers de la rectitude, dont l’appropriation culturelle, une de ses variantes, n’est pas non plus exempte.
L’appropriation culturelle
 La notion d’appropriation culturelle est source de bien des malentendus. Elle a, au cours des dernières années, alimenté plusieurs controverses dont les plus bruyantes ont résonné autour des pièces SLĀV et Kanata, de Robert Lepage. Alors que Mouterde aborde la question comme un épiphénomène de la rectitude, et brille plutôt par la théorisation globale du phénomène qu’il décrit, Ethel Groffier l’attaque de front dans Dire l’autre. Appropriation culturelle, voix autochtones et liberté d’expression2.
La notion d’appropriation culturelle est source de bien des malentendus. Elle a, au cours des dernières années, alimenté plusieurs controverses dont les plus bruyantes ont résonné autour des pièces SLĀV et Kanata, de Robert Lepage. Alors que Mouterde aborde la question comme un épiphénomène de la rectitude, et brille plutôt par la théorisation globale du phénomène qu’il décrit, Ethel Groffier l’attaque de front dans Dire l’autre. Appropriation culturelle, voix autochtones et liberté d’expression2.
Selon la définition qu’en donne l’Oxford English Dictionary, l’appropriation culturelle serait à comprendre comme l’adoption, de la part de membres d’une culture dominante, de coutumes, pratiques, idées, ou toute autre forme d’expression culturelle, non consentie par la culture d’emprunt. Les deux idées centrales ici sont celles de la domination et du consentement. Une adolescente américaine vêtue d’une robe chinoise à son bal de fin d’études s’approprie-t-elle indûment les codes d’une culture dominée ? Non, et pourtant, les indignés ont été prompts à calomnier la jeune femme en question, et à reproduire plus de quarante mille fois sur Twitter le slogan caustique : « Ma culture n’est pas ta maudite robe de promotion ». Quant à la question du consentement, elle pose elle aussi problème : sur qui, au sein d’une culture donnée, celui-ci doit-il en effet reposer ?
En l’absence de bases rigoureusement déterminées, l’appropriation culturelle continue d’alimenter les accusations marquées au coin de l’opprobre social et devient vite un obstacle à la liberté d’expression. Après tout, les cultures sont faites d’emprunts et d’échanges. Impitoyable, le tribunal populaire est porté à l’oublier, de sorte que les dérives sont aussi malheureuses que courantes. Au Québec, parce qu’elles ont été victimes de l’oppression coloniale, parce que leur parole a été usurpée et que les stéréotypes les plus grossièrement nuisibles ont été colportés à leur endroit, les cultures autochtones ont souvent fait les frais de l’appropriation culturelle. Les auteurs doivent-ils pour autant, comme le souhaiterait l’écrivaine d’origine sto:lo Lee Maracle, s’abstenir d’écrire sur les Autochtones ? Rien n’est moins sûr.
L’argument qu’apportait Robert Lepage à sa défense, au moment de la polémique sur Kanata, peut s’appliquer à l’ensemble des pratiques artistiques. « [L]a pratique théâtrale repose sur un principe bien simple : jouer à être quelqu’un d’autre. Jouer à l’autre ». Dans quelle mesure, donc, « jouer à l’autre » ou « dire l’autre » devient-il malvenu ? Dans les cas où, soutient Groffier, cela nuit réellement à une communauté, à son image, en véhiculant des stéréotypes préjudiciables, par exemple. La liberté d’expression ne souffrirait alors en rien de la prohibition de tels discours.
Il n’empêche que, selon la juriste, une partie de la solution à l’appropriation culturelle, en ce qui a trait aux nations autochtones du moins, est du ressort de la politique et repose sur une véritable volonté de réconciliation de la part de l’État. Cela voudrait dire que l’État mette un terme à sa politique de victimisation, apporte réparation aux préjudices subis, c’est-à-dire une réparation acceptable aux yeux de la partie offensée, pour ensuite, et seulement ensuite, pouvoir prétendre à la réconciliation.
Le commerce des injures
En marge des accusations, justifiées ou non, d’appropriation culturelle et de rectitude qui retiennent l’attention médiatique, les radios-poubelles continuent de faire la pluie et le beau temps à Québec. Comment expliquer que des stations de diffusion aient bâti leur audimat sur la base de l’invective et de la diffamation ? Dans un essai formidable de clarté récompensé par le Prix des libraires 2020, Dominique Payette pose la question avec d’autant plus d’à-propos que, selon elle, les idées martelées par les forts en gueule qui animent à CHOI Radio X, pour ne pas les nommer, ont pour conséquence immédiate de détériorer le climat social de la vieille capitale. Payette écrit d’ailleurs en connaissance de cause. À la parution de son rapport sur les radios d’opinion en 2015, la professeure a dû essuyer les tirs groupés de ses détracteurs sur les ondes. « On vous a à l’œil », renchérissait un de leurs émules par courriel, « [o]n va vous écraser comme une punaise ».
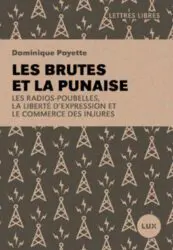 Dans Les brutes et la punaise. Les radios-poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures3, c’est au tour de la punaise de répliquer aux brutes, cette fois avec les armes qui sont les siennes. Sa force tranquille, elle la tient non pas de l’attaque ad hominem, mais d’une argumentation finement étayée par des exemples aussi troublants que probants. Payette montre entre autres que les femmes, les Autochtones, les environnementalistes, les immigrants, les pauvres, bref, les franges les plus vulnérables de la population, passent régulièrement dans le tordeur d’un discours relevant tout à fait de la propagande radiophonique et misant sur les affects et le ressentiment. Voyons, par exemple, de quelle façon le « Doc Mailloux » déverse son fiel sur un pan entier de la population mondiale : « L’Asie Mineure, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, cultures porteuses de profondes tares. C’est pas chic. J’en sais un peu là, pis c’est pas joli. C’est du cannibalisme familial, du cannibalisme, pas au sens propre, mais ça se dévore littéralement. Ça n’a aucun respect. Ah ! Ça sent pas bon dans tellement de familles. Leur culture est malsaine ».
Dans Les brutes et la punaise. Les radios-poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures3, c’est au tour de la punaise de répliquer aux brutes, cette fois avec les armes qui sont les siennes. Sa force tranquille, elle la tient non pas de l’attaque ad hominem, mais d’une argumentation finement étayée par des exemples aussi troublants que probants. Payette montre entre autres que les femmes, les Autochtones, les environnementalistes, les immigrants, les pauvres, bref, les franges les plus vulnérables de la population, passent régulièrement dans le tordeur d’un discours relevant tout à fait de la propagande radiophonique et misant sur les affects et le ressentiment. Voyons, par exemple, de quelle façon le « Doc Mailloux » déverse son fiel sur un pan entier de la population mondiale : « L’Asie Mineure, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, cultures porteuses de profondes tares. C’est pas chic. J’en sais un peu là, pis c’est pas joli. C’est du cannibalisme familial, du cannibalisme, pas au sens propre, mais ça se dévore littéralement. Ça n’a aucun respect. Ah ! Ça sent pas bon dans tellement de familles. Leur culture est malsaine ».
Au chapitre des aberrations, l’animateur Carl Monette n’a rien à envier à son homologue lorsqu’il propose de castrer les assistés sociaux, avant de les déporter dans le Grand Nord. Une telle démonstration de bêtise serait pratiquement risible si elle ne trouvait pas autant d’oreilles fidèles où faire son nid. À ce titre, le symptôme le plus aigu de l’atmosphère de haine ainsi générée est sans contredit l’attentat perpétré par Alexandre Bissonnette en 2018. Bien sûr, corrélation n’est pas causalité et c’est là tout le nœud du problème : les effets délétères des discours haineux sont difficilement démontrables.
De plus, la minorité bruyante qui impose ses courtes vues sur les ondes mise dorénavant sur une stratégie permettant de contourner le jugement du CRTC et des tribunaux, et de jouer dans le flou législatif de la liberté d’expression : dorénavant, les cibles ne sont plus individuelles – souvenons-nous de l’affaire Sophie Chiasson –, mais génériques (élites intellectuelles, marginaux, etc.). Or, en attaquant tout le monde, les animateurs n’attaquent plus personne en particulier et se préservent de la sorte de possibles poursuites.
Ce type de journalisme d’occasion teinté de populisme de droite prend racine dans un modèle d’affaires bien huilé. Créer du contenu d’information rigoureux coûte cher, rappelle Payette. Cela requiert une équipe de journalistes et de recherchistes dont les salaires dépassent de beaucoup les généreux cachets des animateurs de radios d’opinion. Le modèle que propose la trash radio à la québécoise se résume plutôt à cibler les intérêts d’un groupe d’individus au pouvoir d’achat considérable – critères comptables exigent –, de le proclamer partie prenante du « vrai monde », le grand exclu de la société. Ne reste plus alors qu’à privilégier des opinions à la défense de leurs intérêts, de les répéter en boucle, pour obtenir une radio qui déforme au lieu d’informer.
Jusqu’à tout récemment, les commanditaires avaient coutume de jouer des flûtes en regardant se dégrader les conditions du débat public. L’appel à leur boycottage lancé par Payette s’est toutefois fait entendre depuis. En raison de sa position complotiste à l’égard de la COVID-19 et de son obstruction aux recommandations de la santé publique, Radio X s’est fait larguer en septembre dernier par une bonne dizaine d’importants bailleurs de fonds. Sans grande surprise, la station s’est posée en victime en plaidant son droit à la liberté d’expression.
L’extension du domaine de l’émotion
Il y a, à travers ce qui précède, cette constance du sentiment bon marché, de la victimisation, quelque chose comme une extension du domaine de l’émotion à la conversation démocratique. Que répondre, s’interroge pertinemment Groffier, à quelqu’un qui déclare « Vous m’insultez » à la place de « Je suis en désaccord avec vous » ? L’interférence des affects avec les arguments raisonnés brouille en effet les conditions du débat public. Et cette extension, s’inquiète Normand Baillargeon (« Malaise dans la conversation démocratique »), perce aujourd’hui les murailles universitaires en imposant des limites à la liberté d’expression.
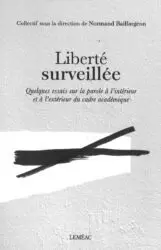 Parmi les neuf contributions de grande qualité que ce dernier rassemble dans Liberté surveillée. Quelques essais sur la parole à l’intérieur et à l’extérieur du cadre académique4, certaines dénoncent par exemple la division que produit la dynamique de la victimisation au sein du mouvement féministe. Diane Guilbault et Michèle Sirois (« La censure : une réaction contre le féminisme qui dérange ») notent en ce sens que le développement de l’approche intersectionnelle – cette « tarte à la crème de la gauche radicale », pour reprendre les termes de Mouterde – mine en effet l’unité féministe en la morcelant selon des enjeux propres à chaque communauté d’intérêts. De nos jours, on retrouve donc, au sein du même mouvement, tant des partisanes d’un féminisme religieux ou de la décriminalisation de la prostitution que des activistes se réclamant de la « transidentité ».
Parmi les neuf contributions de grande qualité que ce dernier rassemble dans Liberté surveillée. Quelques essais sur la parole à l’intérieur et à l’extérieur du cadre académique4, certaines dénoncent par exemple la division que produit la dynamique de la victimisation au sein du mouvement féministe. Diane Guilbault et Michèle Sirois (« La censure : une réaction contre le féminisme qui dérange ») notent en ce sens que le développement de l’approche intersectionnelle – cette « tarte à la crème de la gauche radicale », pour reprendre les termes de Mouterde – mine en effet l’unité féministe en la morcelant selon des enjeux propres à chaque communauté d’intérêts. De nos jours, on retrouve donc, au sein du même mouvement, tant des partisanes d’un féminisme religieux ou de la décriminalisation de la prostitution que des activistes se réclamant de la « transidentité ».
Cette cohabitation pourrait se faire sans heurts si elle n’instaurait pas une guerre de pouvoir quant aux orientations à emprunter : « Tous ces groupes, observent Guilbault et Sirois, se réclament de leur statut de victimes pour investir et orienter le mouvement féministe dans le sens de leurs intérêts. Peu à peu, la priorité accordée à l’égalité entre les sexes s’efface et devient une préoccupation parmi d’autres ». Ces dissensions favorisent également une sorte de course à la victimisation suivant laquelle les « plus victimes » s’arrogeraient seules le droit de parole. C’est ce qu’Annie-Ève Collin (« Le savoir qui s’impose et les activistes qui imposent leur ‘savoir’ ») nomme le privilège épistémique, un argument trompeur en faveur du droit de parole, prioritaire et exclusif, des opprimés au sujet des oppressions.
Cette entrave nouveau genre à la liberté d’expression s’accompagne de stratégies inédites de réduction au silence. Philosophe, Rhéa Jean (« Le droit à la dissidence face au discours actuel sur l’identité de genre ») en est bien au fait, elle dont la conférence a été annulée par l’UQAM en 2016, à la suite d’une plainte établie sur l’unique base de son résumé de communication. Elle ajoute son nom à la liste de plus en plus longue d’intellectuels aux prises avec la désinvitation (deplateforming), cette pratique qui consiste à annuler, sous divers prétextes bardés d’arguments moraux, la venue d’un conférencier. Historiquement propice au débat d’idées et favorable au droit de critiquer une théorie, un dogme, une institution, l’université, en adoptant de telles pratiques, risque de se réduire à un espace consensuel, un safe space à l’abri de la confrontation et des émotions négatives que cela peut susciter.
Pourtant, aussi longtemps que des propos ne portent pas à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes, rappelle de son côté Pierre Trudel (« La liberté d’expression »), la liberté d’expression est censée les protéger. Pour le meilleur et pour le pire, s’il faut en croire Chomsky, qu’aime à citer Baillargeon (« Présentation. Malaise dans la conversation démocratique ») : « Si vous n’êtes pas en faveur de la liberté d’expression pour les idées que vous détestez, vous n’êtes pas du tout en faveur de la liberté d’expression ».
1. Pierre Mouterde, Les impasses de la rectitude politique, Varia, Montréal, 2019, 168 p. ; 21,95 $.
2. Ethel Groffier, Dire l’autre. Appropriation culturelle, voix autochtones et liberté d’expression, Leméac, Montréal, 2020, 144 p. ; 19,95 $.
3. Dominique Payette, Les brutes et la punaise. Les radios-poubelles, la liberté d’expression et le commerce des injures, Lux, Montréal, 2019, 152 p. ; 19,95 $.
4. Normand Baillargeon (sous la dir. de), Liberté surveillée. Quelques essais sur la parole à l’intérieur et à l’extérieur du cadre académique, Montréal, Leméac, 2019, 272 p. ; 22,95 $.
EXTRAITS
Le problème […] est plutôt en effet dans ce primat indu soudainement accordé aux symboles, aux signes, à la langue, en somme aux « mots » plutôt qu’aux « choses », et au-delà au « paraître » plutôt qu’à l’« être » ou à l’« avoir », aux phénomènes apparents plutôt qu’à ce qui pourrait constituer leur substantifique moelle, leur essence.
Pierre Mouterde, Les impasses de la rectitude politique, p. 19.
Il est immoral d’exploiter pour son propre avantage les histoires sacrées et les rites d’une autre communauté, de véhiculer des stéréotypes insultants, de vendre des produits contrefaits. La prohibition de tels comportements ne nuit pas à la liberté d’expression.
Ethel Groffier, Dire l’autre, p. 131.
Dans ces radios, lorsque la vérité est encombrante, on s’en débarrasse. Les faits n’importent guère, à plus forte raison s’ils ne viennent pas corroborer les opinions émises. Le malheur, c’est que le pouvoir des ondes transforme ce verbiage en menaces et en tensions sociales bien réelles.
Dominique Payette, Les brutes et la punaise, p. 33.
La démocratie se doit de préserver non seulement « la liberté de pensée pour ceux qui sont d’accord avec nous », mais aussi « la liberté pour les pensées que nous haïssons ». L’opinion majoritaire n’a guère besoin d’une protection constitutionnelle.
Pierre Trudel, « La liberté d’expression », Liberté surveillée, p. 48.
En outre, l’utilisation de l’analyse intersectionnelle a fait en sorte qu’on s’est mis à opposer les groupes de femmes entre elles. D’un côté, il y a les femmes privilégiées, coupables d’opprimer les femmes victimes de multiples discriminations, dont les discours deviennent suspects, car ils sont étiquetés comme stigmatisants par définition, et qui doivent être dénoncées.
Diane Guilbault et Michèle Sirois, « La censure : une réaction contre le féminisme qui dérange », Liberté surveillée, p. 151.











