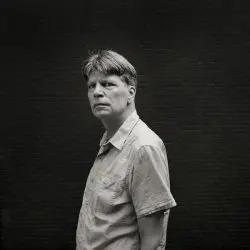Certaines théories de sylviculture conçoivent les arbres comme une vaste étendue communautaire, dont les individus seraient reliés entre eux par des centaines de milliers de kilomètres de connexions fongiques. Ces arbres vivraient en étroite interdépendance, agiraient l’un pour l’autre, partageraient leurs ressources en une même cagnotte métabolique.
Cette thèse réelle est défendue par la professeure Patricia Westerford, alias Patty-la-Plante, l’un des personnages les plus intrigants de L’arbre-monde1, de Richard Powers, lauréat du prestigieux prix Pulitzer de la fiction 2019. Elle traverse également ce roman hautement ambitieux, sous la forme d’une invitation à intégrer les leçons du monde végétal, à rétablir, selon le souhait cher au père du transcendantalisme américain, Ralph Waldo Emerson, les liens occultes unissant l’humain à la nature. Il n’y a pas, semble dire Powers, d’arbre isolé dans une forêt, pas plus que l’humain n’est une monade évoluant en vase clos. Tout est relié par un principe transcendant, appelons-le Nature, aujourd’hui omis ou rejeté dans les marges de la pensée capitaliste : « le fou », disait d’ailleurs William Blake, « ne voit pas le même arbre que le sage ».
Avec cette douzième publication saluée unilatéralement par la critique, Powers signe une vaste fresque écologique où rien n’est laissé au hasard. Le moindre élément résonne en effet dans l’ensemble, ajoute une couche de sens à cette écofiction foisonnante, une branche de plus à ce graphe aux ramifications complexes. La forme étreint magnifiquement le fond, car en plus d’être, parmi tant de choses, un livre consacré aux arbres, L’arbre-monde se présente, littéralement, comme un livre-arbre, une arborescence de récits formant réseau.
LE LIVRE-ARBRE
L’étymologie du mot book, explique un jour Bill Westerford à sa fille Patty, est issue du mot beech, le « hêtre », matériau sur lequel les premiers mots de sanskrit ont été transcrits. L’arbre est donc, d’après le patriarche nomade, à la source de l’écriture. Et celle-ci effectue en quelque sorte un retour aux sources, L’arbre-mondese déployant en quatre chapitres intitulés « Racines », « Tronc », « Cime » et « Graines ».
Les racines, ce sont neuf personnages authentiques, admirablement campés, réunis dans un assemblage choral qui fouille le passé familial de chacun pour laisser place à leur évolution respective. Parmi les plus intéressantes trajectoires se trouvent celles de Doug Pavlicek, matricule 571 de l’expérience de Stanford, vétéran du Vietnam, planteur d’arbres et chat de gouttière au grand cœur; d’Adam Appich, jeune génie bientôt professeur dans une université réputée, écoterroriste et prisonnier; d’Olivia Vandergriff, actuaire déchue, hippie en fleur, miraculée et martyre.
Tous subissent leur révélation, leur appel épiphanique de la nature. Les neuf destins se retrouvent soudés, de différentes manières, à un tronc commun, c’est-à-dire à Solace, en Californie, où une manifestation contre l’abattage d’arbres pluriséculaires bat son plein. Là-bas, des géants de trois mètres de diamètre tombent dans un fracas auquel la majorité reste sourde, survie de l’économie locale oblige.
La cime de Mimas, un séquoia de la grosseur d’un paquebot, devient le refuge d’une communauté de barons perchés résolus à arrêter le carnage. Accrochés à une plate-forme à 70 mètres de hauteur, Olivia et Adam tentent de retarder le sort scellé d’un des plus grands arbres que la terre ait jamais produit. Rien n’y fait. Mimas tombe en vingt minutes, on le débite en une heure à peine.
Pavlicek, Appich, Vandergriff et d’autres joueront leur va-tout. Si les cris de protestation ne résonnent pas assez fort, la dynamite, elle, saura le faire. Sous le slogan « Le contrôle tue. L’union guérit », la nouvelle cellule terroriste s’apprête à passer son message, la belle leçon de la forêt, agir les uns pour les autres, puis rétablir à grands coups d’explosifs le juste équilibre de la nature. Après la tragédie d’un échec plus retentissant encore qu’une déflagration, les chemins se séparent à nouveau.
L’AMÉRIQUE BUISSONNIÈRE
L’arbre-monde n’est pas – ce qui serait déjà énorme – qu’une démonstration d’érudition dendrologique. Le livre-arbre raconte un monde. C’est une vision de la société, d’un pan de l’histoire sociale des États-Unis finement reconstituée. Le récit le plus ancien remonte à Jorgen Hoel, un immigrant norvégien venu travailler sur les chantiers navals de Brooklyn. Contemporain de Thoreau et Whitman, à qui Powers réserve quelques allusions, Hoel part bientôt s’établir sur les terres cadastrées du Midwest, récemment ouvertes à la colonisation. Il y plante un châtaigner qui sert d’arbre-sentinelle aux générations suivantes.
Sih Hsuin, dit Winston Ma, père de Mimi Ma, fuit Shanghaï et la Chine communiste pour atterrir à San Francisco, migrer vers l’Illinois, se marier, procréer, puis planter un mûrier derrière la maison familiale, ce même mûrier à l’ombre duquel il appuie un Smith & Wesson 686 contre sa tempe avant d’en presser la détente et de répandre l’étendue rougeoyante de sa détresse sur l’écorce.
La rhétorique identitaire fait depuis longtemps grand usage des métaphores végétales. Les racines s’ancrent dans la nourrissante terre natale; la généalogie ne peut se passer de son arbre aux branches patri et matrilinéaires; il y a les fiers habitants qui se rassurent et se rassemblent en se disant « de souche »; il y a jusqu’au rhizome qui, dans les années 1990, inspirait à Édouard Glissant une théorie sur la créolisation culturelle du peuple caribéen.
Partout sur ce continent, les origines courent, buissonnent, s’enracinent et se connectent, ou tentent de le faire, au grand tout communautaire. Nick Hoel, Mimi Ma, Olivia Vandergriff, Doug Pavlicek, etc., sont les enfants d’une Amérique venue d’ailleurs. Leurs ancêtres, autant de graines entraînées par le vent, ont semé une petite parcelle d’eux-mêmes et de leur passé dans le tapis social du Nouveau Monde. Vue sous cet angle, la théorie de Pat Westerford sur l’interconnexion des arbres se lit également comme une allégorie du vivre-ensemble, de son idéal qui prend en compte tout le monde vivant. Les hommes et les arbres, rappelle-t-elle d’ailleurs, ont un ancêtre commun et partagent toujours le quart de leurs gènes.
Répondant aux exigences tacites des Américains en matière de bon goût, exigences selon lesquelles un roman digne de ce nom ne saurait compter moins de 450 pages, quitte, il faut l’avouer dans ce cas-ci, à conserver des longueurs, Powers offre sa vision panthéiste d’une Amérique arboretum en piètre état. À la fois prodige de longueur et marchand de beauté, son livre rappelle par moments les envolées lyriques de Terrence Malick dans The Tree of Life. C’est toutefois d’un lyrisme engagé qu’il s’agit, d’un militantisme contemplatif.
Pleine de ses connaissances en foresterie, Patty-la-Plante édicte peut-être le seul principe devant décider de toute coupe : « Ce que vous faites d’un arbre devrait être au moins aussi miraculeux que ce que vous avez abattu ». Vœu pieux ? Probablement, même si le livre de Powers a ce quelque chose d’un petit miracle capable de racheter le sacrifice d’un arbre. L’échange, en tout cas, paraît honnête. L’arbre-monde est finaliste au Prix des libraires 2020.
1. Richard Powers, L’arbre-monde, Cherche midi, Paris, 2018, 531 p. ; 37,95 $.
EXTRAITS
Dans le feu roulant des téléviseurs, la messe aérienne collective laisse place à un autre rassemblement de masse. Tout le long du mur, sur des dizaines de postes différents, des gens sont assis dans une tranchée, enchaînés les uns aux autres, face à un bulldozer, dans une petite ville que le sous-titre identifie comme étant Solace, en Californie. En un raccord, une douzaine de gens forment tant bien que mal un cercle humain autour d’un arbre presque trop massif pour eux. L’arbre ressemble à un trucage.
p. 182
Ils versent des cascades de fioul, acheté par jerricans de vingt litres, dans des Tupperware en plastique équipés d’une minuterie. Ils indiquent sur les cartes de Veilleur la destination de chaque engin pour produire l’incendie le plus durable possible. Ils vont envoyer cet ultime message et c’en sera fini. Alors ils se disperseront, s’évanouiront dans le quotidien invisible. Ils auront obtenu l’attention du pays. Ils en auront appelé à la conscience de millions de gens. Ils auront planté une graine, qui a besoin de feu pour germer.
p. 369