Il ne l’aura pas eue facile, le comte. Fils adultérin d’Henri IV, il serait mort à 25 ans sur le champ de bataille, mais son corps n’a jamais été retrouvé. Alexandre Dumas a voulu le ressusciter, mais c’était compter sans les éditeurs.
C’est le 17 octobre 1865, dans le numéro 27 des Nouvelles, journal fondé quelques semaines plus tôt par Jules Noriac, que paraît le premier chapitre du Comte de Moret, une des dernières grandes œuvres de l’infatigable Alexandre Dumas (1802-1870). Le point final paraîtra le 23 mars 1866. Entre les deux : un long roman se déroulant à l’époque qui fascinait l’auteur des Trois mousquetaires, celle de Louis XIII – et de Richelieu.
Un cardinal dur à dissimuler
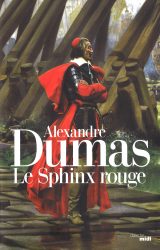 En fait, outre Dumas, qui n’est pas fasciné par les liens mystérieux unissant Louis le Juste et l’Homme rouge ? On considère souvent que le premier régnait pendant que le second gouvernait. Les historiens d’aujourd’hui, pour leur part, cherchent depuis un certain temps à réhabiliter un roi que l’on a trop souvent présenté comme dénué de colonne vertébrale. Il faut dire que, coincé entre Henri IV et Louis XIV, on a avantage à se tenir solide pour faire bonne figure.
En fait, outre Dumas, qui n’est pas fasciné par les liens mystérieux unissant Louis le Juste et l’Homme rouge ? On considère souvent que le premier régnait pendant que le second gouvernait. Les historiens d’aujourd’hui, pour leur part, cherchent depuis un certain temps à réhabiliter un roi que l’on a trop souvent présenté comme dénué de colonne vertébrale. Il faut dire que, coincé entre Henri IV et Louis XIV, on a avantage à se tenir solide pour faire bonne figure.
Personne, sans doute, n’aura le dernier mot sur la dynamique réelle des deux grands personnages, mais Dumas fait certainement partie de ceux qui auront le plus alimenté les fantasmes à cet égard. Il a pour ce faire les deux armes irrésistibles du xixe siècle que sont le style romantique et la licence historique. Vrais ou faux, les portraits respectifs qu’il brosse des deux protagonistes ne peuvent que s’imprégner dans la mémoire du féru d’histoire : « Curieux accouplement que celui de ces deux malades. Par bonheur, le roi pressentait, sans en être sûr cependant, que si Richelieu lui manquait, le royaume était perdu. Mais, par malheur, Richelieu savait que, le roi mort, il n’avait pas vingt-quatre heures à vivre : haï de Gaston [frère du roi], haï d’Anne d’Autriche [femme du roi], haï de la reine-mère, haï de M. de Soissons, qu’il tenait en exil, haï des deux Vendômes, qu’il tenait en prison, haï de toute la noblesse, qu’il empêchait de scandaliser Paris par des duels en place publique, il devait s’arranger pour mourir le même jour au moins que Louis XIII ; à la même heure, s’il était possible ».
C’est ainsi que l’éclat que confère la plume de Dumas au cardinal Richelieu aura fait passer à la trappe le fameux comte de Moret en moins de deux. Car reprenons le récit du récit, soit l’histoire de ce roman paru en feuilleton, nous l’avons dit, en 1865-1866. Il faudra attendre trois quarts de siècle pour que l’œuvre soit éditée sous forme de livre. Nous sommes en 1946. Mais le titre a changé : c’est désormais Le Sphinx rouge, selon une décision des éditions Universelles. Les connaisseurs auront reconnu là le surnom donné au cardinal par Michelet, surnom repris, il est vrai, dans le titre d’un des chapitres de feu Le comte de Moret. Dans la dernière édition en date, celle du Cherche midi (2018), Radu Portocala persiste et signe : le nouveau titre reste1. C’est d’ailleurs le cardinal lui-même qui trône seul au cœur de la page couverture, laquelle est ornée d’un bandeau racoleur qui annonce : « Quelques jours après Les trois mousquetaires… »
Il est vrai que Le comte de Moret s’ouvre quelques jours après le siège de La Rochelle (1628), qui clôt le célèbre roman de cape et d’épée. Mais nulle trace de d’Artagnan et de ses comparses ici : on est bel et bien dans une intrigue toute neuve où Richelieu et Louis XIII se battent ensemble contre l’Espagne, l’Italie, la Savoie, l’Empire, la reine-mère, Monsieur (frère du roi) et Anne d’Autriche, femme du roi qui laisse d’ailleurs celui-ci de marbre. De fait, encore une fois, le fameux tandem y occupe une place de choix, et un des passages les plus savoureux est celui où le roi, après avoir vexé Richelieu pour plaire à sa perfide famille, voit celui-ci donner sa démission et apprend petit à petit avec stupéfaction, une fois son ministre parti, l’ampleur du pouvoir, du réseau, du dévouement de ses collaborateurs et de l’estime diplomatique dont celui-ci s’était paré au service de la France et de Sa Majesté. En un mot, il comprend que le cardinal est son seul ami dans un monde de cupidité et de fourberie, et qu’il ferait bien de le rappeler au plus vite.
Un comte qui cherche son roman
Et le comte de Moret dans tout cela ? Il est vrai qu’il n’occupe pas toujours le premier plan, mais n’oublions pas que nous sommes en présence d’un roman-feuilleton de près de 600 pages où intrigues et acteurs fourmillent. On sait d’ailleurs gré à l’éditeur d’avoir fourni en annexe un « Dictionnaire des personnages » (historiques sauf rares exceptions) d’une quinzaine de pages, car la connaissance approfondie de l’époque dont témoigne Dumas, si instructive et divertissante soit-elle, finit par donner le tournis. (Une carte aurait aussi été bienvenue.)
Historiquement, Antoine de Bourbon-Bueil, né en 1607, fut le fils d’Henri IV et d’une de ses innombrables maîtresses, Jacqueline de Bueil, comtesse de Moret. Dumas le dépeint comme élégant, spirituel et entreprenant comme son père, en fort contraste avec ses deux demi-frères : Louis XIII, triste, mélancolique et velléitaire, et Gaston d’Orléans, mesquin, pusillanime et sans scrupules. L’auteur ne se gêne d’ailleurs pas pour laisser entendre que ni l’un ni l’autre de ces deux derniers ne serait en fait le fils d’Henri IV, la vertu de Marie de Médicis n’étant pas au-dessus de tout soupçon. Mais laissons là ces ragots.
Le comte traverse donc le roman principalement animé par son désir de se montrer à la hauteur de son sang royal… et par l’amour – faut-il s’en surprendre ? – d’une certaine Isabelle de Lautrec, invention romanesque inspirée d’une nommée Françoise Bertaud, qui appartenait à la maison de la reine. Évidemment, une intrigue politico-familiale amène le père de la demoiselle à s’opposer aux doux projets du jeune couple, mais celui-ci ne désespère pas, jusqu’à ce que le comte soit enfin appelé à prouver sa bravoure au feu de l’ennemi. Dumas nous amène ici au cœur d’un épisode de l’histoire de France un peu oublié mais qui eut un retentissement certain en son temps : la bataille du pas de Suse (1629), où les troupes françaises vainquirent celles des Habsbourg. Celle-ci est décrite en détail, après quoi le lecteur a droit à un appendice qui conclut le roman un peu en queue de poisson. D’après Portocala, c’est à la fois une vraie fin – la structure de l’ensemble le démontrerait – et la promesse d’une suite – qui ne viendra jamais.
Était-ce un prequel ?
 En fait, la suite, elle a été écrite… quinze ans plus tôt. Et le court récit La colombe (1850), présenté tout de suite après le roman, n’est certes pas la moins agréable des surprises que réserve au lecteur cette réédition du Comte de Moret/Sphinx rouge.
En fait, la suite, elle a été écrite… quinze ans plus tôt. Et le court récit La colombe (1850), présenté tout de suite après le roman, n’est certes pas la moins agréable des surprises que réserve au lecteur cette réédition du Comte de Moret/Sphinx rouge.
Commençons par rappeler que dans la vraie vie, Antoine de Bourbon serait décédé à la bataille de Castelnaudary (1632), qui opposait l’armée royale à une ligue menée par le duc de Montmorency et l’incorrigible Gaston, sauf qu’on n’a jamais retrouvé son corps. Or, comme l’affirme avec jubilation Alexandre Dumas dans une lettre à Noriac, « un personnage historique qui disparaît sans que les historiens puissent dire où il va, devient nécessairement la propriété du romancier – et le comte de Moret, j’en suis fâché pour les historiens, aura été pour l’avenir où il me plaira de le faire aller ».
Il en résulte un roman épistolaire dans le plus pur esprit romantique, où Isabelle de Lautrec, dévastée par le trépas supposé de celui qu’elle aime, s’est faite nonne et où le comte survivant, convaincu en raison d’un quiproquo de la trahison de sa mie, entre aussi de son côté au monastère. La première lettre est écrite cinq ans après ces tragiques événements, lorsque Moret voit arriver dans sa chambre une colombe épuisée dont il ne connaît l’origine. À tout hasard, après avoir veillé à sa convalescence, il la renvoie à son propriétaire inconnu avec un billet expliquant les quelques jours d’absence du volatile. La colombe lui revient avec un autre billet ; le propriétaire s’avère une propriétaire, et s’ensuit une correspondance improbable entre deux âmes esseulées qui finissent par comprendre qu’elles sont, l’une, l’amant encore vivant de l’autre, et l’autre, l’amante encore fidèle du premier.
Le lecteur contemporain risque de sourire devant cette naïveté ; il n’empêche que l’auteur, de sa plume de maître, saura compenser l’invraisemblance du récit par l’intensité des émotions et le sens du suspense (car ils ne sont pas encore réunis). Et puis, nos œuvres de fiction – lire : cinématographiques – ont-elles tant des leçons à donner au passé en matière de vraisemblance ?
Un destin d’occultation
Né en marge de la lignée royale, le comte de Moret, en se joignant à Gaston et à Montmorency, aura de surcroît choisi le mauvais côté de l’histoire, pour finalement disparaître sans sépulture. Il aura fallu un passionné de la première moitié du xviie siècle comme Dumas pour en faire un sujet littéraire. Mais le destin semble s’acharner à vouloir l’occulter, jusqu’à le pourchasser dans les titres de romans. Certes, il est loin d’avoir la stature du cardinal ; mais justement, le bras droit de Louis XIII avait-il vraiment besoin de cette manœuvre supplémentaire pour survivre dans les mémoires ?
1. Alexandre Dumas, Le Sphinx rouge, Le Cherche midi, Paris, 2018, 712 p. ; 37,95 $. Fait à noter, cette édition est augmentée par rapport à celle de 1946, qui était basée sur un manuscrit authentique mais tronqué.
* François Lavallée est traducteur et auteur.
EXTRAITS
De son côté, la poésie était en enfantement, elle avait dans le siècle précédent donné Marot, Garnier et Ronsard, elle bégayait ses premières tragédies, ses premières pastorales, ses premières comédies avec Hardy, Desmarests, Raissiguier, et allait, grâce à Rotrou, à Corneille, à Molière et à Racine, placer, par sa littérature dramatique, la France à la tête de toutes les nations, et parfaire cette belle langue qui, créée par Rabelais, épurée par Boileau, filtrée par Voltaire, devait devenir, à cause de sa clarté, la langue diplomatique des peuples civilisés. La clarté est la loyauté des langues.
Le comte de Moret/Le Sphinx rouge, I, 6, p. 67
Depuis la mort de Philippe III, l’Espagne cache sa décadence sous de grands mots et de grands airs. Elle a pour roi Philippe IV, frère d’Anne d’Autriche, espèce de monarque fainéant, qui règne sous son premier ministre, le comte-duc Olivares, comme Louis XIII règne sous le cardinal-duc de Richelieu. Seulement, le ministre français est un homme de génie, et le ministre espagnol un casse-cou politique.
Le comte de Moret/Le Sphinx rouge, II, 1, p. 154
– Avez-vous connu le roi Henri IV ? demanda Sully, étonné.
– Je l’ai vu une fois ou deux dans ma jeunesse, dit Richelieu, voilà tout. Mais je l’ai fort étudié. Au contraire de lui, voyez son fils : lent comme un vieillard, morne comme un trépassé, ne marchant presque jamais, se tenant debout, mais immobile, près d’une fenêtre, regardant sans voir, chassant comme un automate, jouant sans désir de gagner, sans ennui de perdre, dormant beaucoup, pleurant peu, n’aimant rien et, ce qui pis est, n’aimant personne.
Le comte de Moret/Le Sphinx rouge, II, 11, p. 244
Notre prétention, en faisant du roman historique, est non seulement d’amuser une classe de nos lecteurs qui sait, mais encore d’instruire une autre qui ne sait pas et c’est pour celle-là particulièrement que nous écrivons.
Le comte de Moret/Le Sphinx rouge, III, 7, p.329









