« Collapsologie » faisait partie des dix vocables soumis au vote de ses lecteurs par le quotidien belge Le Soir pour déterminer « le mot de l’année 2018 ». En France, les écrivains annonçant la décadence de l’Occident (Onfray, Zemmour, Houellebecq) font la file dans l’antichambre des plateaux de télévision et trônent dans les palmarès des librairies. Qu’en est-il du Québec ? Occidental comme les autres, il semble aussi osciller entre pessimisme et désarroi.
Trois essais parus en six mois témoignent de ce trouble. Trois essais apparus de trois univers totalement différents, suivant des démarches littéraires on ne peut plus étrangères les unes aux autres, et où se dessine pourtant un même constat : « Nous vivons quelque chose comme une crise existentielle. Nous n’arrivons pas à concilier notre passé avec ce que nous voyons du Québec en train de se faire. On sent bien que le Québec ne peut plus être ce qu’il a été jusqu’ici, mais nous ne savons plus ce qu’il pourrait être1 ».
La régression tranquille
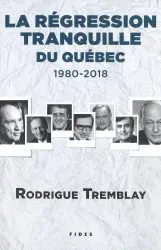 D’abord, Rodrigue Tremblay, dans La régression tranquille du Québec. 1980-20182, nous offre une réflexion structurée sur l’après-référendum… ou plus exactement, les deux après-référendum : d’abord l’après-référendum de 1980, celui de la désillusion, du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne, puis des efforts désespérés et vains de Mulroney pour réparer les pots cassés ; ensuite, l’après-référendum de 1995, celui de la désarticulation d’un discours souverainiste entrant dans une ère où certaines mouvances sauront donner à la notion même de nationalisme des odeurs sulfureuses.
D’abord, Rodrigue Tremblay, dans La régression tranquille du Québec. 1980-20182, nous offre une réflexion structurée sur l’après-référendum… ou plus exactement, les deux après-référendum : d’abord l’après-référendum de 1980, celui de la désillusion, du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne, puis des efforts désespérés et vains de Mulroney pour réparer les pots cassés ; ensuite, l’après-référendum de 1995, celui de la désarticulation d’un discours souverainiste entrant dans une ère où certaines mouvances sauront donner à la notion même de nationalisme des odeurs sulfureuses.
Des trois ouvrages, c’est de loin le plus dense (ce qu’attestent entre autres pas moins de 293 notes substantielles sur 300 pages). Structuré, détaillé, argumenté, il offre une description factuelle, précise et accessible des événements politiques ayant accompagné et suivi le référendum de 1980 jusqu’à la rédaction du livre (2018), émaillée de points de vue originaux sur l’ensemble de ces événements.
Tremblay a été ministre de l’Industrie et du Commerce de 1976 à 1979 avant de retourner à l’enseignement universitaire. Cette double personnalité d’engagé et d’intellectuel transparaît dans son travail. Son parti pris indépendantiste n’y est évidemment pas dissimulé ; mais ses doléances à l’endroit des manigances des fédéralistes sont dûment étayées. Si sa description de la campagne référendaire de 1980 et des dilemmes qui l’ont entourée chez les souverainistes est criante de vérité, cette éloquence redouble dans sa description des turpitudes de Trudeau père en 1980-1982. On sait à quel point celui-ci peut être détesté des souverainistes ; les plus jeunes de nos contemporains comprendront ici pourquoi. Tremblay ne mâche pas ses mots quand il cite les propos trompeurs tenus publiquement par Trudeau avant le référendum de 1980, puis la « Nuit des longs couteaux », au cours de laquelle les neuf premiers ministres du ROC et le gouvernement fédéral ont conclu un accord constitutionnel en cachette, la nuit du 4 novembre 1981, pendant que le premier ministre québécois dormait paisiblement à son hôtel.
Tremblay n’est d’ailleurs pas tendre envers Lévesque : selon lui, une question référendaire à laquelle on ne répond que par oui ou non était vouée à l’échec (on aurait pu offrir deux, voire trois options explicites). De plus, et surtout, il était carrément irresponsable pour le premier ministre québécois de se rendre à des négociations constitutionnelles au lendemain d’un référendum qui lui avait publiquement nié tout mandat, sans plan particulier pour arriver à ses fins… et d’ailleurs sans objectif précis non plus.
De là, le Québec n’essuiera qu’une série de revers humiliants : rejet de l’Accord du Lac Meech (1987) puis de celui de Charlottetown (1992), et rebelote avec le référendum de 1995.
Au fond, fait remarquer Tremblay, la seule proposition constitutionnelle qui ait réussi au Canada, soit le rapatriement de la Constitution en 1982, est aussi la seule qui n’ait pas été soumise à un référendum. Autre reproche à Lévesque, donc : pourquoi n’a-t-il pas eu le réflexe de réclamer un référendum national sur la nouvelle Constitution, chose qui va pourtant de soi dans un État démocratique moderne, où le peuple est souverain ? Il ne l’aurait pas nécessairement obtenu, mais cette revendication aurait à tout le moins aidé le Québec à entacher pour les générations à venir la nouvelle loi fondamentale du pays et à récupérer une partie du poids politique qu’il venait de perdre en voyant son droit de veto lui glisser entre les mains.
Enfin, Tremblay rappelle qu’avec la Charte des droits et libertés introduite dans la nouvelle Constitution, c’est la vision multiculturaliste du Canada de Trudeau qui emporte la suite de l’histoire du Québec, une vision pour lui illégitime qui inaugure un monde que décrivent également nos deux autres auteurs, un monde bizarrement transfiguré où les concepts des belles années du nationalisme québécois se retrouvent disqualifiés par un mystifiant tour de passe-passe : « Le Québec est présentement une nation sur la défensive, vulnérable, subordonnée, fragilisée et même culpabilisée d’exister par une certaine bien-pensance apatride ».
Québec, un requiem ?
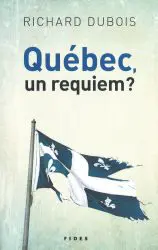 C’est aussi le constat que fait le poète-essayiste Richard Dubois dans Québec, un requiem ?3, mais de façon plus directe : « Exemple : le PQ est un parti ‘ethnique’. L’amalgame, équations et glissades entre concepts déclarés malodorants (nationalisme = xénophobie = repli sur soi), et en mitraille : ‘comme-le-prouvent-le-racisme-et-la-xénophobie-d’un-Mussolini-Hitler-Duplessis’, etc. »
C’est aussi le constat que fait le poète-essayiste Richard Dubois dans Québec, un requiem ?3, mais de façon plus directe : « Exemple : le PQ est un parti ‘ethnique’. L’amalgame, équations et glissades entre concepts déclarés malodorants (nationalisme = xénophobie = repli sur soi), et en mitraille : ‘comme-le-prouvent-le-racisme-et-la-xénophobie-d’un-Mussolini-Hitler-Duplessis’, etc. »
Comme le laisse déjà voir cette citation, à l’approche universitaire de Tremblay, Dubois oppose un style brouillon qui rappelle les pamphlets et manifestes décomplexés, voire expérimentaux, des années 1960 et 1970. Ses thèses ne sont d’ailleurs pas non plus sans parenté avec cette époque des beaux jours révolutionnaires, car il y décrit essentiellement un Québec qui vit un « manque », mais un manque qui a partie liée avec le capitalisme et le néolibéralisme, fers de lance du « confort et [de l’]indifférence ».
Le problème n’est donc pas propre au Québec. Mais le Québécois a sa façon à lui de vivre ce manque : « Québécois : l’homme qui a tout sauf une langue, sauf un pays… »
Et ce manque, c’est aussi un nivellement par le bas intellectuel qui se manifeste entre autres par le nouveau monde orwellien. « La ‘Novlangue’ d’aujourd’hui […] pose les ‘bons’ mots, puis pointe du doigt les ‘vilains’ qui utilisent les ‘mauvais’ […]. Tolérance, adaptation et ouverture à ‘l’Autre’ sont les mots d’ordre. Fin du questionnement, de la réflexion. » Et si les immigrants au Québec ne venaient pas grossir un « nous » mais tout simplement s’intégrer… pour une bonne part à la communauté anglophone ? Et Dubois de sortir des chiffres officiels qui recoupent d’ailleurs d’autres observations documentées de Rodrigue Tremblay et qui passent curieusement sous le radar des grands médias.
Refusant l’étiquette de décliniste, toutefois, Dubois propose courageusement un redressement. Changer le monde, à la face de ceux qui veulent changer le monde. C’est le sujet de la seconde partie du livre, consacrée à l’exposition d’un genre de plan de relance idéologique qui permettrait au pays de retrouver un certain sens de la qualité (une « aristocratie » au sens étymologique : le « gouvernement des meilleurs ») et de l’intégrité intellectuelle, par la patiente édification d’un réseau de gens de bonne volonté qui sauront s’immiscer partout, un peu à la manière d’une société secrète. Le but : « une société moins matérialiste, moins niveleuse, plus signifiante ».
L’entre-deux-mondes
 Du style pyrotechnique de Dubois aux énoncés factuels et sans fioritures de Dominique Lebel, on change encore d’univers. Lebel, qui est pourtant loin de la génération de Rodrigue Tremblay, se montre aussi perplexe que lui sur notre époque dans L’entre-deux-mondes. Journal des années 2016-2018 : « Mais là où nous en sommes, même le sens des mots vacille, et le nationalisme québécois, synonyme pendant plus de cinquante ans d’affirmation, de prise en main et de fierté, est aujourd’hui assimilé au repli sur soi et à la crainte des autres, quand ce n’est pas carrément au racisme et à la haine ».
Du style pyrotechnique de Dubois aux énoncés factuels et sans fioritures de Dominique Lebel, on change encore d’univers. Lebel, qui est pourtant loin de la génération de Rodrigue Tremblay, se montre aussi perplexe que lui sur notre époque dans L’entre-deux-mondes. Journal des années 2016-2018 : « Mais là où nous en sommes, même le sens des mots vacille, et le nationalisme québécois, synonyme pendant plus de cinquante ans d’affirmation, de prise en main et de fierté, est aujourd’hui assimilé au repli sur soi et à la crainte des autres, quand ce n’est pas carrément au racisme et à la haine ».
Dominique Lebel, qui fait profession de communicateur et connaît le monde politique de l’intérieur – ayant notamment été proche conseiller de Pauline Marois –, nous livre ici le contenu de son journal quotidien du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Comme les deux précédents, il ne peut qu’observer que quelque chose se découd, ajoutant qu’on ne sait pas ce qui suivra.
Journal, donc. Trois ans, jour après jour, en plus de 400 pages. Si l’exercice présente l’intérêt de nous montrer la richesse de l’actualité internationale (l’auteur note presque quotidiennement la teneur des manchettes, dans un style télégraphique), le lecteur ne peut que rêver d’une version retravaillée où l’on aurait eu des développements enrichissants et des exposés complets dépassant l’anecdote. On comprend que ce ne soit pas nécessairement le principe du journal (quoique rien ne l’empêcherait), mais en même temps, disons que le livre nous amène à prendre acte des limites du « miroir que l’on promène le long d’une route » de Stendhal. L’homme est un lecteur boulimique (il nous décline d’ailleurs amoureusement chacune de ses lectures), il fréquente un tas de gens brillants, il a de l’expérience, il a la tête pleine d’idées ; on le lit et on a soif de trouver plus que des ébauches de réflexions sous sa plume.
Tristesse, pugnacité, perplexité…
Tristesse et amertume chez Tremblay, insubordination et pugnacité chez Dubois, perplexité et flottement chez Lebel. « Le désir de ‘passer à autre chose’ est peut-être la grande affaire de notre temps », laisse tomber ce dernier. Cet « autre chose », dont le mystère est souligné à grands traits par l’observateur politique, ne semble pas emballer nos auteurs. Peut-être partagent-ils la crainte de Lebel : « À vouloir embrasser trop vite le changement, on se trompe parfois d’avenir ».
1. Dominique Lebel, L’entre-deux-mondes. Journal des années 2016-2018, Boréal, Montréal, 2019, 449 p. ; 29,95 $.
2. Rodrigue Tremblay, La régression tranquille du Québec. 1980-2018, Fides, Montréal, 2018, 343 p. ; 29,95 $.
3. Richard Dubois, Québec, un requiem ?, Fides, Montréal, 2018, 234 p. ; 27,95 $.
* François Lavallée est traducteur agréé et auteur.
EXTRAITS
Pour paraphraser Thomas d’Aquin, un leader a la responsabilité première de faire en sorte de remporter une proposition de changements politiques, car autrement, les choses pour son peuple risquent d’être bien pires après qu’avant.
Rodrigue Tremblay, La régression tranquille du Québec, p. 63.
De même, la Loi constitutionnelle de 1982 […] mentionne le Nouveau-Brunswick 18 fois, mais évoque à peine le Québec, sinon dans une note explicative […], comme si le peuple québécois et la nation québécoise avaient presque soudainement cessé d’exister aux yeux des auteurs du texte et étaient reportés au statut d’une note infrapaginale.
Rodrigue Tremblay, La régression tranquille du Québec, p. 135.
Il sera ici question, s’agissant de l’Homo quebecensis, de satisfaction béate, de confort et d’indifférence. Pire : de digestion heureuse, dans la tourmente même.
Richard Dubois, Québec, un requiem ?, p. 12
Idéalistes ? Naïfs ? Les petits peuples ont en commun soit une mémoire un peu courte, soit des émotions à fleur de peau qui les font s’emballer pour n’importe quelle nouveauté.
Richard Dubois, Québec, un requiem ?, p. 83.
La fierté, la langue, la nation, la culture, le passé, l’idée du passé, tout ça est à désinstaller, comme on le ferait d’une application détestable sur un téléphone mobile.
Dominique Lebel, L’entre-deux-mondes, p. 340.
Bref, comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais nationalisme économique. Mais une chose est certaine : le nationalisme économique n’est pas le repli, l’entre-soi, le poison que certains aimeraient nous faire croire.
Dominique Lebel, L’entre-deux-mondes, p. 256.









