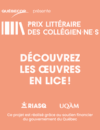« On ne tombe pas tous les jours sur des écrivaines époustouflantes du siècle dernier qui sont complètement oubliées. En voici une : Henriette Valet, auteure de deux romans dans les années 1930 […] ».
Un article de François Ouellet, à paraître le 10 octobre, dans le numéro d’automne de Nuit blanche sous la rubrique Écrivains méconnus du XXe siècle.
Henriette Valet : indignation et révolte
publié le
28 août
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...