Sept années se sont écoulées entre la parution de Sunset Park, le précédent roman de Paul Auster, et 43211, l’œuvre monumentale parue en 2018, dans sa version française. Si la trame narrative de Sunset Park avait pu nous paraître éclatée, en ce qu’elle projetait, à travers une galerie de personnages, une image kaléidoscopique des États-Unis, Paul Auster multiplie cette fois le coefficient de difficulté, pour lui, et de plaisir, pour le lecteur, par quatre. C’est ni plus ni moins que quatre versions différentes de la même vie, avec le même point de départ, les mêmes protagonistes, le même décor, la même chronologie des événements qui nous sont offertes, avec des entrecroisements et des rebondissements multiples. Qui n’a pas un jour fantasmé sur cette impossible équation : que me serait-il arrivé si j’avais pu avoir une deuxième, une troisième, voire une quatrième vie ?
Le roman d’une génération
L’auteur de la Trilogie new-yorkaise avait su apaiser l’impatience de ses lecteurs en publiant dans l’entre-temps Excursions dans la zone intérieure, Chronique d’hiver, sa correspondance avec l’écrivain sud-africain J. M. Coetzee, et un recueil d’essais, de discours et de préfaces ayant pour titre, assurément inspiré de René Magritte, La pipe d’Oppen, mais 4321 se faisait attendre. Paul Auster avait-il tout dit ? Tout exploré ? Lorsque la rumeur s’apaisa pour laisser place à la cathédrale romanesque qu’est 4321, les fidèles de Paul Auster n’ont pu que s’incliner, soufflés et ébahis, devant cette œuvre de plus de mille pages dont aucune ne mériterait d’être retranchée. Tout, ou presque, y est contenu : la fiction, l’essai, les réflexions sur l’écriture et la création, le profond attachement de Paul Auster pour New York, son amour du baseball, du cinéma, et bien sûr de la lecture, de la littérature française.

Le terme cathédrale n’est pas exagéré dans le cas présent, tant l’ampleur du projet, son élaboration et son élévation en imposent. On ressort de cette lecture avec le sentiment d’avoir une connaissance intime du XXesiècle tel qu’il s’est déroulé aux États-Unis, avec un arrêt sur les années 1960, une plongée dans cette période effervescente, tumultueuse et riche. Le lecteur a par moments l’impression d’être rivé devant un écran sur lequel défilent des images des événements marquants de cette décennie. Une plongée accentuée par le fait que le personnage principal qui officie à ce feu d’artifice découvre tout à la fois son identité, ses racines et sa ville, et voit se profiler un avenir sans cesse en mouvement, un avenir composé de promesses et de désillusions. C’est en quelque sorte le roman d’une génération qui s’est toujours perçue jeune et immortelle.
J’ai oublié !
Reprenons depuis le début, depuis l’arrivée du grand-père de Ferguson, le personnage central du roman, pour comprendre que Paul Auster reste avant tout fidèle à sa propre quête, celle qu’il ne cesse de poursuivre depuis Cité de verre. Parti à pied de sa ville natale de Minsk avec cent roubles en poche, Isaac Reznikoff s’embarque sur un bateau, baptisé l’Impératrice de Chine, en partance pour l’Amérique. Le nom déjà du transatlantique fait sourire : Isaac Reznikoff atteindra-t-il sa destination ? Arrivé à New York, déterminé à entreprendre une nouvelle vie, il se fait conseiller par un compatriote russe juif de dire à l’agent de l’immigration qui l’accueillera qu’il s’appelle Rockefeller. « Tout ira bien avec un nom pareil », l’assure son compatriote. Mais au moment de décliner son identité, Isaac a oublié le patronyme si judicieusement suggéré par son compatriote et s’exclame devant l’agent de l’immigration : « Ikh hob fargessen ! » (J’ai oublié !). L’agent note aussitôt : Ichabod Ferguson, tamponne le visa d’entrée et passe au suivant. Ainsi commence la nouvelle vie en Amérique d’Isaac Reznikoff, le grand-père d’Archie Ferguson.
Ce qui frappe d’entrée de jeu dans cette immense fresque romanesque, ce sont les très longues phrases qui, comme le fil d’une histoire que l’auteur déroule sans fin, telle Pénélope tissant sa tapisserie vingt années durant, rythment l’action et ses nombreux rebondissements. Sans doute pour cet aspect, ce phrasé musical, et l’ampleur du projet, certains ont évoqué Proust. La petite phrase de Vinteuil est ici remplacée par les multiples occurrences françaises dans le cours du récit, nous rappelant, si besoin est, l’affinité et la connaissance de Paul Auster pour la littérature française. Dès les premières lignes, le lecteur renoue avec la voix narrative de Paul Auster, attentif aux moindres détails qui donnent au récit son incroyable vraisemblance, son registre et sa tessiture. Que ce soient les publicités d’eau embouteillée ou de plaquettes de beurre, où l’on voit une jeune Indienne agenouillée dans une position de nymphe, publicités qui émoustilleront le protagoniste dans ses années prépubères, rien n’est laissé ici au hasard pour créer l’effet trompe-l’œil qui plonge le lecteur dans cette Amérique effervescente du siècle dernier, l’Amérique de tous les possibles avec l’arrivée massive d’immigrants à Ellis Island en quête d’un monde nouveau, d’un rêve de réussite que vient confirmer l’ascension de Kennedy, la conquête spatiale et l’émergence de la classe moyenne. Mais l’Amérique livre aussi son visage sombre, celui de tous les excès avec la chute de Nixon et les flambées de violence sur les campus universitaires pour dénoncer la guerre du Vietnam qui a alors cours, sans oublier les luttes raciales, les inégalités sociales, la fracture du fragile vernis qui recouvre le rêve poursuivi par tant d’immigrants qui ont tout laissé derrière eux pour, le plus souvent, ne rien trouver d’autre que la dissolution de ce même rêve devenu cauchemar, climatisé ou pas.
Le moindre détail retenu – les recherches documentaires à l’appui donnent ici une assise solide aux souvenirs du narrateur – concourt à donner à l’ensemble l’illusion parfaite d’une œuvre hyperréaliste. L’utilisation de listes diverses, répertoriant les lieux, les événements, les titres des livres cités, des films, les noms d’acteurs, des personnages publics ayant occupé l’avant-scène, peuvent à tout moment être vérifiés pour attester l’exactitude des faits rapportés. Le roman pourrait bien se prêter à une analyse sociopolitique des États-Unis, du début du XXe siècle à la chute de Richard Nixon alors que les États-Unis verront, pour la première fois de leur histoire, un président et un vice-président exercer le pouvoir sans avoir été élus par leurs concitoyens. Le roman couvre en quelque sorte l’âge d’or de la classe moyenne américaine, de son apparition sous Roosevelt à sa lente mais inexorable désagrégation à laquelle faisait référence Sunset Park, à l’étiolement de la démocratie américaine. L’explosion des produits de consommation, à commencer par les appareils ménagers, réfrigérateurs, cuisinières et téléviseurs, dont le père de Ferguson fait commerce avec ses frères, créera cette autre grande illusion dénoncée en ces pages : avoir accès au monde en direct sans quitter son salon. C’est ainsi le triomphe de l’image, autant celles que l’on voit imprimées dans les journaux ou défiler à l’écran, que celles que l’on encadre chez soi pour attester la réussite familiale et professionnelle, dont saura tirer profit la mère de Ferguson, qui aura son propre studio de photographie. En un mot, tout ce qui nous est présenté dans ce roman est aussi vrai que peut l’être une reproduction photographique de la réalité. La surface des choses ne peut ici être prise en défaut. En cela, l’univers peint par Paul Auster n’est pas sans rappeler à certains moments celui de René Magritte.
Quatre personnages identiques
Dans 4321, Paul Auster renoue avec les thèmes qui lui sont chers : la quête d’identité, la mort, la poursuite de la réussite, l’argent, en ce que sa possession permet ou empêche de réaliser rêves et projets, les multiples possibilités qui peuvent, ou non, se présenter dans le cours d’une vie, le désir et le besoin de laisser une trace, d’être l’auteur de sa propre vie, ce qu’évoque le personnage principal en des termes on ne peut plus clairs et explicites qui brouillent encore plus la frontière entre fiction et réalité : « […]il inventerait trois autres versions de lui-même et raconterait leur histoire parallèlement à sa propre histoire (plus ou moins sa propre histoire dans la mesure où il allait devenir lui-même personnage de fiction), il allait écrire un livre sur quatre personnages identiques mais différents portant tous le même nom : Ferguson ».
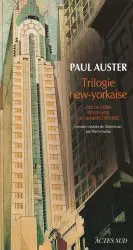
Le personnage de Ferguson, auquel on fait référence tantôt par son prénom, tantôt par son patronyme, auquel également on associe Paul Auster, prend lui-même conscience que le monde est fait d’histoires. Les références autobiographiques sont nombreuses, à commencer par la date de naissance de Ferguson, qui ne diffère que d’un seul mois de calendrier avec celle de Paul Auster. Maints indices sont semés ici et là pour nous rappeler, de façon aussi référentielle que ludique, la personnification de l’auteur dans l’une et l’autre des quatre vies d’Archie Ferguson. Que ce soit pour l’apprentissage du métier d’écrivain, de traducteur littéraire, de poète, de nouvelliste et de romancier, les allusions, feintes ou non, au propre parcours de Paul Auster sont nombreuses.
À elles seules, les références contenues dans ce roman constituent un programme de formation littéraire des plus ambitieux. Si, dans l’une des quatre vies esquissées ici, le jeune Archie refuse de s’inscrire à des ateliers littéraires sous prétexte qu’on ne peut apprendre à écrire en suivant des cours, le programme que Paul Auster lui a concocté est à la hauteur de sa propre réussite d’écrivain. Le cinéma n’est pas non plus en reste, à commencer par les pages consacrées à la filmographie de Laurel et Hardy donnée ici comme le meilleur des exutoires pour échapper à une dépression sévère à la suite de déboires amoureux propres à l’adolescence. Que seraient les histoires de cette envergure sans sexualité pour assurer le rebondissement de l’action, le déploiement de la quête amoureuse et la connaissance intime de sa propre personne ? Le thème de la sexualité est omniprésent, sous des formes plurielles.. Il est vrai que l’on suit le personnage de Ferguson du début de l’adolescence, qui est aussi l’âge de tous les possibles, de toutes les découvertes, cet âge où rien n’est encore fixé, où les croisées de chemin se multiplient au même rythme que les interrogations qui demeurent souvent sans réponse, à l’âge adulte. Entre un grand-père qui meurt d’un infarctus dans les bras de deux prostituées et le personnage de Ferguson qui cherche son identité sexuelle, Paul Auster restitue l’atmosphère qui prévalait dans les années 1960, empreinte de liberté, d’expérimentations diverses et de questionnements existentiels.
La structure
L’entrée en littérature de Paul Auster s’est faite à l’enseigne de la trilogie, mais c’est sous l’angle du quatuor qu’il est revenu en force après une pause de sept ans. Un quatuor réuni en un seul volume, décliné en sept sections qui à leur tour se déploient, chaque fois ou presque, en quatre chapitres. Le lecteur peut s’aventurer dans cette cathédrale en respectant l’ordre d’assemblage du livre imprimé et suivre page à page le déroulement ou, sensible à l’appel des chiffres, composer un autre parcours, un peu à l’image de Marelle de Julio Cortázar ou de Smoking / No smokingd’Alain Resnais. Dans l’un et l’autre cas, le lecteur suivra le même personnage, jamais tout à fait le même, jamais tout à fait autre, et bien que Paul Auster en élimine un ou deux en cours de route selon les aléas de la vie, Ferguson en ressort toujours aussi vivant, toujours aussi indiscernable de ses propres avatars. Que le lecteur le sache mort avant la fin, chaque fois qu’il réapparaît, il veut croire qu’Archie Ferguson est vivant, ce qui est sans doute la plus grande force du roman : nous berner avec notre consentement. Le rêve de tout écrivain n’est-il pas d’explorer, par la fiction, l’ensemble des possibilités qui lui seraient offertes s’il avait le pouvoir de se dédoubler à l’infini ? Ces histoires sont-elles vraies ? s’interroge Ferguson. Est-ce important qu’elles le soient ? À chaque lecteur de trouver sa réponse, et son plaisir.
* Paul Auster ©Lotte Hansen
1. Paul Auster, 4321, trad. de l’américain par Gérard Meudal, Actes Sud/Leméac, Arles/Montréal, 2018, 1024 p. ; 39,95 $.
EXTRAITS
Quelle idée intéressante, se dit Ferguson, de penser que les choses auraient pu se dérouler autrement pour lui, tout en restant le même. Le même garçon dans une autre maison avec un autre arbre. Le même garçon avec des parents différents. Le même garçon avec les mêmes parents qui ne faisaient pas les mêmes choses qu’actuellement.
p. 69
[…]les deux années qui s’écoulèrent entre l’enterrement d’Andrew et l’événement qui fit s’écrouler leur petit monde se passèrent dans le présent flou de l’enfance, les banales histoires d’école, le sport et les jeux, les amitiés, les programmes de télévision, les bandes dessinées, les livres de contes, les maladies, les genoux écorchés et les membres amochés, les bagarres occasionnelles, les dilemmes moraux et les innombrables interrogations sur la nature de la réalité…
p. 84
Ferguson avait découvert qu’une des bizarreries de sa personnalité, c’est qu’il avait l’impression d’être plusieurs personnes à la fois, qu’il n’était pas une seule personne mais la réunion de plusieurs personnalités contradictoires, et chaque fois qu’il se trouvait en présence de quelqu’un de différent, il devenait différent lui-même.
p. 292
Cela facilitait les choses que le père d’Andy soit mort lui aussi, pensait Ferguson, cela faisait d’eux les fils d’hommes qui n’existaient plus et ils passaient leur vie en compagnie de fantômes, du moins les mauvais jours, les pires jours et comme l’éclat aveuglant du monde brillait plus fort les mauvais jours, cela expliquait peut-être pourquoi ils cherchaient l’obscurité des salles de cinéma et se sentaient plus heureux quand ils étaient assis dans le noir.
p. 391
[…]la vérité c’est qu’il n’avait pas le choix, il devait le faire ou mourir, car malgré tous ses efforts et sa déception devant les choses mortes qui sortaient souvent de lui, l’acte d’écrire, plus que tout ce qu’il avait pu faire par ailleurs, lui donnait le sentiment d’être plus vivant, et lorsque les mots se mettaient à chanter à ses oreilles et qu’il s’asseyait à son bureau, attrapait un stylo ou posait ses doigts sur le clavier de sa machine à écrire, il se sentait nu, nu et exposé au vaste monde qui s’engouffrait en lui…
p. 538
Pourquoi donnez-vous à vos personnages des noms aussi étranges ? demanda Nagle. Je ne sais pas, répondit Ferguson. Probablement parce que ces noms indiquent bien au lecteur qu’on est dans une fiction, pas dans le monde réel. J’aime bien les histoires qui admettent qu’elles sont des histoires sans prétendre être la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, juré, craché.
p. 585












