New-Yorkais de naissance, Douglas Kennedy a fait un long détour par l’Irlande et l’Angleterre avant de maintenant partager sa vie entre la petite ville de Wiscasset, au Maine, l’Europe et Montréal. Un fidèle lectorat francophone le suit, à un point tel qu’il reçoit en 2009 le Grand Prix du Figaro Magazine pour l’ensemble de son œuvre1.
Né à Manhattan en 1955, Douglas Kennedy étudie au Bowdoin College, situé dans le Maine, pour traverser ensuite l’océan et fréquenter le Trinity College de Dublin. En Irlande, il travaille comme administrateur de théâtre et dramaturge, avant de devenir journaliste. Cependant, ce sera à Londres que se révéleront ses talents de romancier, là où il habitera de 1994 à 2014. Kennedy mettra habilement à profit son grand sens de l’observation et son remarquable esprit de synthèse. L’écrivain d’envergure mondiale – qu’il est aujourd’hui devenu – puisera son inspiration dans sa propre jeunesse mouvementée.

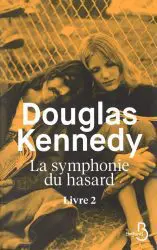 À l’aube de la soixantaine, il revient aux États-Unis et s’établit dans un coin charmant de la Nouvelle-Angleterre, tout en séjournant souvent à Paris, où il conserve un pied-à-terre, à Londres, à Berlin et plus près du Maine, à Montréal. Douglas Kennedy fait ainsi un retour aux sources, car Wiscasset, son lieu de résidence, n’est qu’à une demi-heure de Brunswick, qui abrite son alma mater Bowdoin. Plusieurs de ses personnages évoluent d’ailleurs dans ces jolies petites villes américaines bâties non loin de la mer. La protagoniste de La symphonie du hasard ne raconte-t-elle pas : « En arrivant à Brunswick, j’avais été frappée par la beauté du campus, et le bleu vif du ciel du Maine qui offrait un contraste spectaculaire avec les feuilles mortes tapissant le sol » ? Sans doute ce qui avait séduit le jeune Kennedy lors de son passage, dans les années 1970.
À l’aube de la soixantaine, il revient aux États-Unis et s’établit dans un coin charmant de la Nouvelle-Angleterre, tout en séjournant souvent à Paris, où il conserve un pied-à-terre, à Londres, à Berlin et plus près du Maine, à Montréal. Douglas Kennedy fait ainsi un retour aux sources, car Wiscasset, son lieu de résidence, n’est qu’à une demi-heure de Brunswick, qui abrite son alma mater Bowdoin. Plusieurs de ses personnages évoluent d’ailleurs dans ces jolies petites villes américaines bâties non loin de la mer. La protagoniste de La symphonie du hasard ne raconte-t-elle pas : « En arrivant à Brunswick, j’avais été frappée par la beauté du campus, et le bleu vif du ciel du Maine qui offrait un contraste spectaculaire avec les feuilles mortes tapissant le sol » ? Sans doute ce qui avait séduit le jeune Kennedy lors de son passage, dans les années 1970.
Premiers romans, premiers succès
En 1994, alors que Kennedy aborde la quarantaine, il publie coup sur coup trois romans, des thrillers psychologiques, qui tous obtiennent un succès immédiat. Le nom de l’auteur est rapidement connu et sa renommée, bien établie. Ce sera Cul-de-sac, réédité sous le titre de Piège nuptial et porté à l’écran, aussitôt suivi de L’homme qui voulait vivre sa vie, grand succès international traduit en seize langues, aussi adapté au cinéma. Troisième roman, troisième succès, Les désarrois de Ned Allen est un nouveau best-seller et un autre succès critique traduit en quatorze langues.
Chacun des protagonistes de ces trois romans connaît une rupture dans son existence dorée et devra faire preuve d’invention et de créativité pour rebâtir sa vie. Mais il n’est pas sûr qu’ils y arrivent. Par leur intermédiaire, Douglas Kennedy décrit et attaque sans détour l’American way of life,qui semble n’être guidé que par l’argent et la frénésie de dépenser. L’appétit d’une société en mal de consommation ne se dément toujours pas, mais s’intensifie chaque jour davantage, surtout en ces temps troublés où souffle un fort vent de populisme et d’hystérie mensongère chez nos voisins du sud.
L’auteur américain n’écrit pas des romans à clé, mais comme plusieurs écrivains, il construit plutôt son œuvre à partir de ce qu’il connaît, de ce qu’il a vécu. Dans la préface des Héros ordinaires2, il explique : « J’ai commencé ma vie sous la tutelle souvent pesante du couple typiquement mal accordé de l’Amérique des années 1950 : mon père était un homme d’affaires dont le rêve était de vivre en Alaska, ma mère une personne hypercultivée qui supportait difficilement sa condition de femme au foyer, j’ai été d’emblée aux premières loges pour observer les proportions dramatiques que peuvent prendre la frustration et la discorde conjugale ».
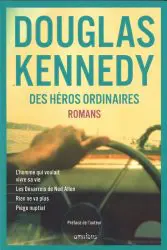 En 2001, Douglas Kennedy rompt avec les thrillers psychologiques et marque un changement radical de forme littéraire avec La poursuite du bonheur. Il entame alors un cycle d’histoires d’amours tragiques, dont les protagonistes sont des couples malheureux ou mal assortis. La poursuite du bonheur sera traduit en douze langues et se retrouvera finaliste au Prix des lectrices de Elle.
En 2001, Douglas Kennedy rompt avec les thrillers psychologiques et marque un changement radical de forme littéraire avec La poursuite du bonheur. Il entame alors un cycle d’histoires d’amours tragiques, dont les protagonistes sont des couples malheureux ou mal assortis. La poursuite du bonheur sera traduit en douze langues et se retrouvera finaliste au Prix des lectrices de Elle.
Ensuite, avec la régularité d’un métronome et pour le plus grand plaisir de ses fidèles lecteurs, l’Américain publiera une douzaine de livres en autant d’années3. Il demeure un des auteurs américains favoris des francophones, vendant plus de huit millions de copies traduites en français, sur les quatorze millions d’exemplaires écoulés de ses différents ouvrages.
La saga de La symphonie du hasard
La soixantaine venue, alors qu’il s’installe aux États-Unis, Douglas Kennedy se lance dans la rédaction d’une saga en plusieurs tomes, La symphonie du hasard, qu’il considère comme son œuvre la plus personnelle. La protagoniste Alice Burns et l’auteur ont en effet plusieurs points en commun : avoir étudié aux mêmes endroits,le Bowdoin College et le Trinity College de Dublin, avoir eu une mère au foyer exaspérée et exaspérante, ainsi qu’un père infidèle et absent, d’origine irlandaise « qui travaillait pour la CIA, avait participé au coup d’État de Pinochet et avait des maîtresses », expliquera l’auteur en 2017 lors d’une entrevue4.
La fresque retrace la vie et les secrets d’une famille, dysfonctionnelle sans doute, mais aussi fascinante, dont le parcours zigzague à travers les événements majeurs qui ont transformé le monde dans les années 1970-1980. Grande histoire et petites histoires se confondent avec intelligence et harmonie. L’indépendante et talentueuse Aliceconnaît donc des mésaventures qui ressemblent à s’y méprendre à celles de son auteur.
Le premier tome de La symphonie du hasard se déroule aux États-Unis, et l’auteur aborde sans filtre les problèmes des années 1970 : racisme, sexisme, homophobie et antisémitisme, qui étaient alors la norme dans la plupart des pays industrialisés, dits civilisés. Années fertiles en événements de toutes sortes. Alice et les siens assistent aux bouleversements causés par la guerre du Vietnam, le Watergate, le coup d’État au Chili, la montée du pouvoir des jeunes, le peace and love, comme le flower power, le féminisme, le rock’n’roll et les paradis artificiels. Peu à peu, plusieurs mouvements d’évolution, de révolution et de contre-révolution voient le jour et provoquent des confusions et des convulsions qu’essaient de comprendre la jeune femme et ses amis. « C’est l’essence même de l’Amérique moderne : se planter en beauté, puis raconter à qui veut l’entendre qu’on s’est réconcilié avec Dieu. »
Le deuxième tome s’ouvre sur l’arrivée d’Alice Burns au célèbre Trinity College de Dublin, où elle fait son apprentissage autant de la vie universitaire que de la vie européenne d’alors, de la bohème et de la terrible réalité des drames qui se jouent à ce moment-là en Irlande, au nord comme au sud. « L’impression de désolation me prenait à la gorge : des maisons pratiquement en ruine, des trottoirs défoncés, les eaux usées et les égouts se déversant à même la rue, et partout la propagande tricolore : Dehors les Anglais, Une seule Irlande. »
Une suite au troisième tome ?
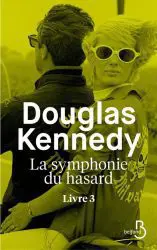 Tout comme Douglas Kennedy, Alice Burns retournera vivre aux États-Unis, et le troisième tome de La symphonie du hasard s’y déroule dans les années 1980. Les enfants ont grandi, les parents, vieilli. Les mariages se font et se défont, le divorce n’est plus le tabou qu’il a déjà été.
Tout comme Douglas Kennedy, Alice Burns retournera vivre aux États-Unis, et le troisième tome de La symphonie du hasard s’y déroule dans les années 1980. Les enfants ont grandi, les parents, vieilli. Les mariages se font et se défont, le divorce n’est plus le tabou qu’il a déjà été.
Toute la famille travaille maintenant, y compris l’ex-mère au foyer, enfin séparée. Qui fréquente Wall Street et ses dérives, qui le monde de l’édition ; l’argent coule à flots, le bien-être matériel s’installe, du moins pour un certain temps. Sans être omniprésent, le drame n’est jamais loin. Il est vrai que les Burns ne semblent pas très doués pour le bonheur.
Ce sont les années de Jimmy Carter, de Ronald Reagan, et le capitalisme règne en maître dans cette société d’hyperconsommation. « Quitte à élire un acteur, a soupiré Howie pendant le discours de Reagan, on n’aurait pas pu choisir Redford ? Ou Newman ? – Ils sont trop instruits et trop libéraux, a répondu Duncan. »
Dans ce troisième opus, l’écrivain creuse davantage la personnalité de Peter et d’Adam, les frères d’Alice, et ce qui en ressort n’est pas toujours édifiant, peu s’en faut. Ce sont des années marquantes, l’époque du sida et de ses terribles ravages. Petit clin d’œil, Douglas Kennedy livre même un court passage sur Donald Trump. « Il avait attiré l’attention des médias, en particulier dans la presse à scandale, grâce à sa politique commerciale implacable, son ostentation, son amour inconditionnel pour le pouvoir, ses combines immobilières parfois louches. »
La fresque sociale et politique de La symphonie du hasard qui, au dire même de l’auteur, ne devait compter que trois tomes, porte clairement l’inscription « à suivre » à la fin du troisième volume. Douglas Kennedy ouvre-t-il une nouvelle et quatrième porte ? Qui sait. À suivre en effet.
* Douglas Kennedy ©LIBAN Leextra Belfond
1. Créé en novembre 2009, àl’occasion des 25 ans du Figaro Magazine, le Grand Prix du Figaro Magazine était destiné à récompenser l’auteur étranger qui avait le plus marqué le paysage littéraire français des 25 dernières années.
2. Publié chez Omnibus, le recueil contientquatre romans : L’homme qui voulait vivre sa vie (1998), Les désarrois de Ned Allen (1999), Rien ne va plus (2002) et Piège nuptial (1997, 2008).
3. Une relation dangereuse (2003) ; Au pays de Dieu (2004) ; Les charmes discrets de la vie conjugale (2005) ; La femme du Ve (2007), adapté au cinéma en 2011 ; Quitter le monde (2009) ; Au-delà des pyramides (2010) ; Cet instant-là (2011) ; Combien ? (2012) ; Cinq jours (2013) ; Murmurer à l’oreille des femmes (2014) ; Mirage (2015) ; Toutes ces grandes questions sans réponse (2016).
4. http://www.parismatch.com/Culture/Livres/Les-secrets-de-famille-de-Douglas-Kennedy-1391501.
EXTRAITS
Derrière mes paupières closes, une scène a défilé. J’ai la soixantaine. Professeur retraité menant une petite existence tranquille dans une coquette maison d’une petite ville de la côte du Maine. C’est l’hiver. Il neige. Je suis assis devant la cheminée du salon, une revue ouverte sur les genoux, sirotant le premier whisky de la soirée.
Piège nuptial dans Des héros ordinaires, p. 1231.
Il avait coiffé en queue-de-cheval ses cheveux d’un blond sale, sa barbe de quatre jours faisait plus que jamais débraillée mode, et son célèbre sourire narquois avait la taille requise pour un écran 70 mm. Mais c’est surtout sa tenue qui m’a scié, parce qu’elle faisait tellement… « New York ». Chemise en lin noir boutonnée jusqu’au cou, ample pantalon noir avec bretelles en cuir de la même couleur, bottines noires à lacets, Ray-Ban : la tenue classique du frimeur de Wooster Street, mais qui, à Greenwich, en territoire de banlieusards riches voués à Ralph Lauren, avait évidemment été étudiée pour attirer les regards.
L’homme qui voulait vivre sa vie dans Des héros ordinaires, p. 91.
Quand Lucy est rentrée ce soir-là, la coexistence pacifique régnait de nouveau à la maison et nous n’avons plus jamais fait allusion à cet affrontement destructeur. Mais il y a des mots qui ne peuvent pas se reprendre. Tacite et cependant perceptible, un net refroidissement avait envahi notre relation. Nous avions beau prétendre que le navire conjugal continuait sur sa lancée, il avait commencé à perdre son centre de gravité, l’équilibre de son lest. Et quand la quille n’est plus stable, le naufrage devient imminent.
Rien ne va plus dans Des héros ordinaires, p. 768.
Nous. Les Burns. Deux parents nés dans l’abondance des années folles, avant la dégringolade vers les épreuves et l’abattement national. Trois enfants nés plus tard, dans la paix et la prospérité du milieu du siècle. Un quintette d’Américains issus des sommets de la classe moyenne ; cinq brillants exemples – chacun à sa manière – du gâchis que tant d’entre nous font de leur vie. […] « La famille, c’est tout ce qu’on a – voilà pourquoi elle nous fait tant de mal ».
La symphonie du hasard, Livre 1, p. 34.
Il n’y a pas de meilleur moyen de découvrir Paris qu’en s’y promenant seul, sans personne pour nous aiguiller ici ou là, ni nous imposer ses préférences. Je me suis délibérément perdue dans des ruelles. J’ai traversé de grands boulevards, fascinée par les vitrines des magasins. J’ai passé dix minutes éblouissantes dans une fromagerie, à songer que, si je vivais dans ce pays, je me nourrirais exclusivement de pain, de fromage et de vin rouge, sans oublier une quantité malsaine de cigarettes pour éviter d’enfler comme une outre.
La symphonie du hasard, Livre 2, p. 209.
J’ai repensé à tout ce qui s’était déroulé avec ma mère. Son nouveau style ringard et les abrutis qu’elle invitait dans son lit étaient de tristes indices de sa solitude, de sa peur, maintenant qu’elle avait pris la décision de changer de vie. Elle ne pouvait plus se cacher à l’ombre d’un mariage raté. J’ignorais si nous parviendrions à rebâtir une relation dénuée de toute colère et de toute culpabilité.
La symphonie du hasard, Livre 3, p. 81.










