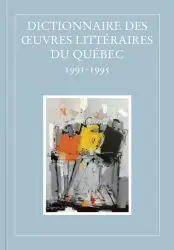Depuis la parution de son premier volume dirigé par Maurice Lemire en 1971, le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec1 s’est imposé comme un point de départ, voire un passage obligé, pour toute recherche en littérature québécoise digne de ce nom. Cette série de publications propose en effet un inventaire ambitieux et rigoureux au possible de la production littéraire de chacune des périodes couvertes par les neuf tomes.

Tout récemment, c’est Aurélien Boivin, appuyé par une équipe de chercheurs de l’Université Laval (Jonathan Livernois et Mylène Bédard), ainsi que de l’Université du Québec à Trois-Rivières (Jacques Paquin et Hervé Guay), entre autres, qui menait à terme la neuvième cuvée de ce projet de grande envergure, couvrant cette fois un large pan de la production littéraire comprise entre 1991 et 1995. Pour donner une idée de l’ampleur du travail requis par la préparation de cette nouvelle mouture, il suffit de mentionner ses 900 articles consacrés à près de 1 300 ouvrages ; que la bibliographie compte environ 6 500 entrées, ou que la collaboration de près de 250 contributeurs a été requise dans le but de faire de cette initiative un outil de référence incontournable pour quiconque s’intéresse aux œuvres littéraires du Québec.
À ce propos, que faut-il exactement comprendre par « œuvres littéraires du Québec » ? Suivant en cela leurs prédécesseurs, les co-idéateurs de l’entreprise ont retenu quatre paramètres de sélection afin d’inclure ou d’exclure les œuvres de leur imposant corpus. Pour mériter une attention particulière, ces dernières devaient ainsi répondre à au moins deux critères susceptibles de les inscrire dans l’univers référentiel du Québec : être écrites par des auteurs ayant choisi de vivre au Québec ; viser le Québec pour lieu de réception ; avoir été éditées par une maison québécoise ; ou relever de l’imaginaire québécois.
Malgré la souplesse de ces lignes directrices, plusieurs absences notables se font sentir, en raison d’une sorte de biais implicite compris dans la conception même du Québec ou du « Québécois ». La réception des précédents volumes du DOLQ l’a souligné : le Québec dont il est ici question écrit surtout en français. Point de visibilité ou presque n’est donc accordée aux auteurs anglophones, dont la présence aurait pu enrichir les pages d’un ouvrage aspirant à l’exhaustivité, tout en encourageant le dialogue entre les littératures des « deux solitudes ». Ce parti pris tacite explique en même temps la place concédée à certains écrivains franco-ontariens ou acadiens ne répondant pas aux critères de sélection établis.
Le versant « littéraire » des œuvres auxquelles on accorde une entrée porte lui aussi à discussion. D’abord, aucune définition n’est avancée quant à ce qui constituerait la littérarité d’une œuvre. On comprend pourquoi – les auteurs de l’avant-propos le rappellent – quand on sait à quel point cette question a été glosée, débattue, tournée et retournée sans jamais faire consensus. Or, c’est tout de même sur la base d’un manque de qualités littéraires que l’on s’appuie pour discriminer la présence, par exemple, du pamphlet politique. Cela n’empêche pas Jonathan Livernois, dans sa synthèse réalisée en début de volume, de se pencher sur Les habits neufs de la droite culturelle de Jacques Pelletier, La souveraineté rampante de Jean Larose et Qui a peur de Mordecai Richler? de Nadia Khouri, lesquels pamphlets bénéficient en plus d’une couverture dans la partie réservée aux commentaires. Les balises sont bien sûr nécessaires si l’on veut faire avancer pareil projet, mais il va de soi que ces mêmes balises laissent nécessairement de côté tout ce qui les déborde. Les raccourcis, eux aussi, sont bien souvent inévitables.
Pour le reste, le neuvième DOLQ suit une recette éprouvée et fort efficace. Une introduction suivie d’une chronologie tabulaire précède les commentaires sur les œuvres, plus ou moins fouillés selon l’abondance de la réception et la bonne fortune critique. Ils sont rédigés selon une formule assez régulière, voulant qu’après une présentation de l’œuvre, accompagnée le plus souvent d’un résumé, suit une appréciation personnelle du rédacteur que ce dernier confronte à d’autres jugements critiques recensés. Le lecteur moins intéressé par les considérations ponctuelles que par une vue d’ensemble sur la littérature des années 1991-1995 pourra, quant à lui, se tourner vers l’introduction du dictionnaire, rédigée de concert par les cinq principaux collaborateurs du tome, où le récit, le théâtre, la poésie et l’essai occupent un espace de choix.
Le récit
La partie la plus substantielle de l’introduction porte sur le récit. Aurélien Boivin signe ce coup d’envoi en établissant un panorama des tendances qui se sont dessinées durant la période ciblée, tant dans le roman que dans la nouvelle. Il effectue un retour sur quelques pionniers (Jacques Poulin, Marie-Claire Blais, Jacques Godbout) qui ont su au fil des ans bonifier une œuvre durable, avant de se concentrer sur une poignée d’auteurs de la relève, dont Patrick Senécal, Gaétan Soucy et Sergio Kokis.
Le professeur émérite à l’Université Laval propose par la suite une typologie des principaux genres romanesques – romans historique, de quête et de recherche d’identité, social, du Nord et de l’américanité, policier, etc. –, puis passe en revue les thèmes dominants de l’époque tels que la famille, les amours malheureuses, l’homosexualité ou le métier d’écrivain. Le tour d’horizon est généreux, quoique le découpage choisi favorise la redondance, notamment parce que les genres abordés suggèrent eux-mêmes des thèmes qui seront parfois traités deux fois plutôt qu’une.
La syntaxe à l’occasion boitillante, les nombreuses coquilles et imprécisions de cette section trahissent l’empressement dans lequel a probablement dû se terminer l’ouvrage. Les cas de figure abondent : Les aventures de Benjamin Tardif, rédigées par l’intarissable François Barcelo, ne forment pas une trilogie (p. xix), mais bien une tétralogie couronnée par Route barrée en Montérégie ; le Proche-Orient n’est pas un pays (p. xlviii), pas plus qu’Angéline de Montbrun, de Laure Conan, n’est le premier roman canadien-français (p. xliii). Des « fantasques » mis pour « fantasmes » (p. xxi), une société « Mkivik » au lieu de Makivik (p. xxi), un « vaparetto » (p. xxxiv) et le « voudou » (p. xxxiv) côtoient des formulations curieuses comme « lors dans les années 80 » (p. xxix), « péripétie d’événements » (p. xxxv), « à grandes pompes » (p. l) ou encore, à propos d’un roman de Suzanne Julien : « Il se déguise en détective pour prouver que la jeune fille, trouvée sans vie sur un rail de chemin de fer, n’est pas accidentelle » (p. xxxii).À cette jeune fille accidentelle, il faut encore ajouter maintes fautes de frappe – « un » saga (p. xxx), en « grand » partie (p. xxxiv), « le » traits (p. xxxvi) – qu’une relecture attentive aurait permis d’éviter. Sans véritablement porter à conséquence, ces petites lacunes minent tout de même « l’approche scientifique » que défend l’équipe de rédaction dès les premières pages.
Le théâtre
Entre 1991 et 1995, la dramaturgie québécoise voyage de plus en plus à l’extérieur des frontières de la province, nous dit Hervé Guay, dans un résumé concis et porteur de belles propositions sur la situation théâtrale. L’une d’elles suggère que, de façon générale, les auteurs d’ici reviennent, après un engouement marqué pour le corps et l’image, à un théâtre de la parole et du récit. Cette distinction utile permet de prendre la mesure du changement opéré par Larry Tremblay, Carole Fréchette, Wajdi Mouawad et Daniel Danis, en regard des auteurs de la décennie précédente.
Les quatre écrivains se taillent d’ailleurs une place parmi les dramaturges de premier plan en misant sur des thématiques qui entremêlent violence – sociale, familiale, conjugale – et passé, tout en montrant un goût pour le politique traité sur le mode du désenchantement. Après une mise en sourdine durant les années 1980, les enjeux politiques reviennent à l’avant-scène de plusieurs productions, servis par une perspective intime, parfois autobiographique. Aussi la « question » autochtone s’immisce dans les pièces de Jean-François Caron, Yves Sioui Durand et Gilbert Dupuis, qui sondent de leur côté des questions de dépossession, de souveraineté ou de métissage. Ce renouveau contribue à dynamiser les pratiques théâtrales, puisque les auteurs consacrés – Michel Tremblay, Michel Marc Bouchard ou Jovette Marchessault – produisent peu d’œuvres significatives durant ce temps.
La poésie
S’il faut en croire Jacques Paquin, plusieurs poètes au cours de la même période pratiquent une poésie du lieu, attachée aux espaces urbains, régionaux ou domestiques. Claude Beausoleil et Robert Melançon transcrivent ainsi en mots les vibrations sensorielles de Montréal, alors que les poètes du territoire, Jean Désy, Camille Laverdière et consorts, rendent hommage aux vastes étendues nordiques et à leurs habitants. À ce lyrisme tellurique, les poètes des lieux intimes substituent une vision personnelle des espaces intérieurs, marquée au coin des réminiscences cathartiques de l’enfance.
L’interartialité est au menu de plusieurs recueils. L’écriture poétique entre de plus en plus en dialogue avec d’autres arts, que ce soit le cinéma, la peinture, la musique ou la photographie. On n’a qu’à penser au recueil de Jean-Paul Daoust L’Amérique. Poème en cinémascope, de Normand de Bellefeuille, Notte oscura, ou d’Émile Martel, Pour orchestre et poète seul, pour se convaincre de l’influence déterminante des autres formes artistiques sur le travail de création poétique.
Outre la poésie migrante ou féminine, celle des marges est bien représentée. Elle a pour têtes d’affiche des noms emblématiques de la contestation sociale. Acteur de la contre-culture, Denis Vanier (Hôtel Putama), à l’instar de Fernand Durepos (Mémoires d’un tueur de temps), poursuit son exploration provocatrice des bas-fonds humains, peuplés de prostituées et de toxicos, loin du réel aseptisé de la société technocratique. Yves Boisvert (La balance du vent), armé d’autodérision et d’ironie, ainsi que Gilbert Langevin (Le cercle ouvert), « marginal de la marge », d’après les mots de Paquin, affichent dans leurs écrits un mépris semblable envers les institutions politiques et culturelles.
Selon ce dernier, et les exemples cités corroborent cette idée, les années 1991-1995 représentent surtout une période de continuité qu’assure une génération d’écrivains nés durant la décennie 1960. Aussi le paysage éditorial en matière de poésie change-t-il peu, malgré l’apparition de revues telles qu’Exit, refonte de feue Gaz moutarde, un organe de diffusion destiné aux jeunes auteurs boudés par l’institution littéraire.
L’essai
En ce qui concerne l’essai, Jonathan Livernois et Mylène Bédard font également valoir que les grandes figures d’essayistes restent sensiblement les mêmes que par le passé. François Ricard, Fernand Dumont, Pierre Vadeboncœur et Jean Larose, pour ne nommer qu’eux, tiennent toujours le haut du pavé en matière de production essayistique, tandis que, du côté féminin, l’interrelation entre écriture de soi, théorie et création continue de préoccuper des auteures comme France Théoret et Suzanne de Lotbinière-Harwood. Le renouvellement des figures intellectuelles s’effectue plutôt dans le domaine de la recherche universitaire, où Marie-Andrée Beaudet, Lucie Bourassa et Pierre Popovic se font une réputation enviable grâce à leurs travaux respectifs sur la littérature.
Trois lignes de force thématiques se dessinent parmi ces publications. Le sujet national, propice à la polémique, fait de nouveau couler des flots d’encre en favorisant les prises de bec qui éclaboussent certains personnages publics de la scène intellectuelle. Plusieurs biographies de qualité paraissent, sur des figures politiques ou littéraires, dont Saint-Denys Garneau et Nelligan, de la part d’historiens porteurs d’une mouvance de retour au genre et portée par elle. Enfin, les travaux réalisés par Jean Morency, Jean-François Chassay ou Robert Major traduisent un engouement croissant pour l’américanité de la culture québécoise, engouement auquel succomberont plus tard Pierre Nepveu (1998) et Gérard Bouchard (2000).
Bien sûr, parce qu’elles servent d’introduction, toutes ces synthèses font la part belle aux auteurs les plus connus de la scène littéraire. Pour creuser l’inconnu ou le méconnu, il reste les quelque 900 recensions dont les responsables du Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec peuvent s’enorgueillir. En cela, le DOLQ constitue une espèce de bible de chevet qui s’adresse à tous les amateurs de littérature, du simple curieux à l’adepte de critiques, en passant par l’expert qui fait du monde des lettres son pain quotidien.
1. Voir le plus récent tome : Aurélien Boivin, avec la collaboration de Mylène Bédard, Hervé Guay, Jonathan Livernois et Jacques Paquin, Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, T. IX, 1991-1995, Fides, Montréal, 2018, 1042 p. ; 99,95 $.