Péguy a été successivement réclamé avec enthousiasme comme maître à penser par les lecteurs des Cahiers de la quinzaine jusqu’à sa mort en 1914 puis, il y a quelques décennies, comme objet de détestation haineuse par un Tzvetan Todorov ou par un Bernard-Henri Lévy qui va jusqu’à en faire l’inspirateur d’un nazisme à la française. À la publication de ce collectif, venant après diverses études dont Le mécontemporain d’Alain Finkielkraut, excellente et bienveillante mise au point, on a pu parler d’un « retour à Péguy ». Ce qui implique qu’une partie des lecteurs et historiens s’était détournée de lui ou en proposait des lectures biaisées.
Classer un inclassable
Pour comprendre les raisons de cet oubli – si oubli il y eut, voire discrédit et ostracisme –, il faut remonter à la Deuxième Guerre et aux années Pétain.
Celui-ci, pour redonner vie à la France vaincue et occupée, avait avec son gouvernement lancé un mouvement de « révolution nationale » visant en particulier la jeunesse. « Travail, famille, patrie » fut substitué à la formule républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». Il fallait des modèles et des précédents, et une figure de proue. On tailla donc sur mesure un Péguy catholique, chantre du beau pays de France, de Jeanne d’Arc et de la tradition héroïque. C’était occulter le défenseur passionné de Dreyfus et des Juifs, le socialiste, l’admirateur de Bergson et Jaurès, le farouche républicain. Cela équivalait à amputer Péguy de ce qui en lui et son œuvre constituait la négation même du pétainisme ! À cette lecture tronquée succéda d’ailleurs, comme le montre Michel Winock, une lecture « de la Résistance » à l’occupant également biaisée. En fait, nul parti, nulle idéologie ne peuvent annexer Péguy l’inclassable.
Ce Dictionnaire1 copieux, par la voix d’une soixantaine de bons connaisseurs sous la direction de Salomon Malka, fait le tour à peu près complet de l’œuvre et détaille les raisons de le relire et de s’inspirer de lui dans notre société en proie aux démons de la compétitivité, du tout-à-l’économie, de la basse politique, de l’uniformisation et de la robotisation non seulement de la vie quotidienne mais des esprits.
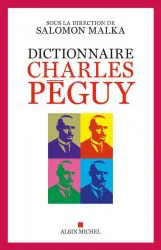 Rouvrir Péguy ne va pas cependant sans difficulté. S’il séduit et entraîne par sa force de conviction comme il le fit en son temps, il irrite aussi, quand il ne décourage pas la lecture, même des œuvres les plus célébrées comme Notre jeunesse. Ce fameux style répétitif jusqu’à l’obsession pousse à dire : « Ce déluge verbal est-il bien nécessaire pour la démonstration? » mais, passé le premier agacement, on constate comme un paradoxe que ce piétinement têtu fait progresser la pensée. C’est cependant – opinion purement personnelle – dans la poésie que cette écriture trouve son emploi le plus convaincant – Péguy a une facilité étonnante à versifier en vers libres ou en alexandrins. Elle fait naître dans La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc ou La tapisserie de Notre-Dame, dans les lentes vagues d’Ève, un mouvement lyrique et oratoire, quasi incantatoire, d’une indéniable et puissante beauté. Antoine Compagnon montre que comme tout grand écrivain, tels Proust, Claudel ou – fâcheux voisinage – Céline, Péguy a su renouveler la langue et la modeler à sa manière.
Rouvrir Péguy ne va pas cependant sans difficulté. S’il séduit et entraîne par sa force de conviction comme il le fit en son temps, il irrite aussi, quand il ne décourage pas la lecture, même des œuvres les plus célébrées comme Notre jeunesse. Ce fameux style répétitif jusqu’à l’obsession pousse à dire : « Ce déluge verbal est-il bien nécessaire pour la démonstration? » mais, passé le premier agacement, on constate comme un paradoxe que ce piétinement têtu fait progresser la pensée. C’est cependant – opinion purement personnelle – dans la poésie que cette écriture trouve son emploi le plus convaincant – Péguy a une facilité étonnante à versifier en vers libres ou en alexandrins. Elle fait naître dans La tapisserie de sainte Geneviève et de Jeanne d’Arc ou La tapisserie de Notre-Dame, dans les lentes vagues d’Ève, un mouvement lyrique et oratoire, quasi incantatoire, d’une indéniable et puissante beauté. Antoine Compagnon montre que comme tout grand écrivain, tels Proust, Claudel ou – fâcheux voisinage – Céline, Péguy a su renouveler la langue et la modeler à sa manière.
Il n’a cessé de brasser ou de ressasser quelques thèmes clés. Emporté par la passion, il l’est aussi par la colère quand il dénonce la complaisance, la veulerie, les reniements des politiciens. Essentiellement la « dégradation de la mystique en politique » qui, selon sa formule célèbre, a succédé à l’affaire Dreyfus, qui déchaîna les passions. Ce fut la grande cause de sa vie et, plus, « l’élément fondateur de [s]a génération ». Il fut un des rares écrivains français de son époque à ne pas être antisémite. Il a vu en Bernard Lazare son ami, et plus qu’un modèle, un saint laïc. Car Péguy fait volontiers dans l’outrance, que ce soit dans l’admiration ou dans l’attaque, la dénonciation, parfois l’ironie insultante quand il s’en prend au « parti intellectuel », aux esprits secs de la Sorbonne, alors que l’intellectuel devrait être « porteur d’une idée » politique tacticienne et opportuniste.
À tout propos il dénonce « le monde moderne » qu’il définit comme celui où « tout le monde ment » et lance une croisade contre lui. En regard il exalte la fidélité à soi-même – qui peut se muer en rigidité et en radicalisme –, le refus du compromis, du conformisme, de l’embourgeoisement qui va de pair avec « une âme habituée », c’est-à-dire morte. Dangers auxquels l’Église a cédé quand elle s’est engagée dans une politique cléricale et qu’elle a oublié la charité. Il exalte l’héroïsme et la sainteté à travers les figures qui les incarnent et prône « l’insertion du spirituel dans le charnel, de l’éternel dans le temporel ».
Il y eut cependant de sa part des retournements qui nous gênent, à propos d’Ernest Renan, Daniel Halévy ou Jean Jaurès coupable à ses yeux d’avoir dégradé la mystique socialiste en politique tacticienne et opportuniste. Ses volte-face déconcertent. Après s’être déclaré maintes fois incroyant, il se « convertit » au catholicisme, mais il restera non pratiquant et en dehors de l’Église. Après s’être affiché à l’extrême droite maurrassienne, il devient ardent socialiste et républicain de gauche. Le Dictionnaire nous aide à comprendre cet itinéraire qui a cependant une logique et une continuité et nous incite à ne pas mettre trop vite Péguy devant ses contradictions.
« Nous étions gonflés de vertus militaires », écrit-il encore, rigueur, exigence, droiture. À cet égard on peut s’étonner que ce Dictionnaire si complet ne comporte pas d’entrée sur l’armée et la guerre, alors que celle-ci fut proche d’éclater en 1905, que Péguy approuva l’extension du service militaire avant qu’elle éclate effectivement en 1914, et dont, on le sait, il fut une des premières victimes.
Le monde moderne, dit-il en refusant de pactiser, ne croit plus à rien, à aucune valeur, il fait des hommes une matière malléable. Ces propos prennent à nos oreilles une résonance particulière et il suffirait d’apporter peu de nuances pour y retrouver le tableau de notre époque… Œuvre jugée « accueillante » (Charles Coutel) car, en opposition à notre monde dans sa logique de l’avoir, de la compétition féroce, du profit et du pouvoir, elle pense les rapports en termes de fraternité. On entrevoit donc ce qui peut nous conduire à « revenir à Péguy ». Chacun soucieux de l’évolution de notre société et de notre civilisation tout entière peut faire en le feuilletant un bénéfice de ce dictionnaire. Le chrétien peut trouver en Péguy une source de méditation, lui qui parle si éloquemment de l’Incarnation, qui exalte l’espérance et la charité (Le porche du mystère de la deuxième vertu), qui se définit lui-même comme « un homme mystique ». Ce terme ne se limite pas à l’expérience religieuse mais désigne l’homme qui a une foi, une exigence d’absolu, une passion d’absolu.
Le lecteur du Dictionnaire ne peut se tromper. Sans constituer une hagiographie, pas de voix discordantes mais des nuances bienvenues. Un exposé fouillé qui éclaire, élargit les perspectives, rectifie les idées toutes faites, en une célébration unanime qui nous dit en quoi Péguy peut devenir, ou redevenir, un repère, un inspirateur et un contestataire dans notre monde en quête de direction.
* Charles Péguy par Eugène Pirou.
1. Sous la dir. de Salomon Malka, Dictionnaire Charles Péguy, Albin Michel, Paris, 2018, 429 p. ; 34,95 $. Charles Péguy par Eugène Pirou.
EXTRAITS
Une réflexion très profonde sur l’appartenance nationale. Il a parlé du prix d’une patrie charnelle […]. J’ai trouvé un autre prolongement de Péguy dans la pensée de Simone Weil et notamment dans L’enracinement […]. J’ai vu comme une filiation qui allait de Péguy à Simone Weil, à André Suarès, à Marc Bloch. Et aujourd’hui, étant donné ce que je vois de la fragilité française, je m’inscris dans cette filiation.
Alain Finkielkraut, p. 268.
Présent dès les premiers écrits en prose, le thème de l’hospitalité occupe une place grandissante dans l’œuvre poétique de Péguy. […] la poésie l’aide à résister à l’inhospitalité du monde moderne. C’est pourquoi l’œuvre de Charles Péguy est si accueillante.
Charles Coutel, p. 157.
Mieux que le vieillard, l’homme de quarante ans sait ce que c’est que vieillir, comprend la vérité du vieillissement : il peut donc invoquer sa mémoire, porter sur le passé un regard de mémorialiste et non d’historien. L’opposition entre la mémoire et l’histoire est aussi importante dans la pensée de Péguy que l’opposition entre la mystique et la politique.
Denis Labouret, p. 89.











