Jean Pallu est le pseudonyme de Pierre Passeneau ; il est né le 22 septembre 1898 à Izieux et mort le 4 mai 1975 à Lyon. Sa carrière littéraire est brève et intense : il publie sept récits entre 1931 et 1936, et obtient le Prix du roman populiste en 1932 pour Port d’escale, son second roman. Il collabore à différentes revues, notamment Europe et La Grande revue.
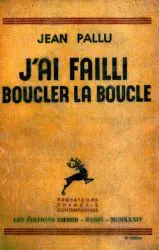 L’absence d’informations biographiques précises crée des malentendus de réception : Henry Poulaille lit L’usine (1931) comme le récit écrit par un prolétaire quand certains rappellent que « son emploi dans la métallurgie […] l’a tenu non aux ateliers, mais dans les bureaux et les services techniques1 ». Marcel Martinet le désigne, avec ironie, sous le nom de « Pierre Passeneau, l’industriel à Lyon2 ». Sa correspondance avec Marcel Martinet, lecteur aux éditions Rieder, l’éditeur de Pallu, le présente plus exactement comme un transfuge de classe. Pallu/Passeneau retrace une partie de son parcours dans la lettre du 22 septembre 1930 écrite à Martinet : « Je suis né à Saint-Chamond, pays des grèves, j’y ai vécu jusqu’à 23 ans – j’ai suivi par curiosité, autrefois, les réunions électorales des mineurs de Saint-Étienne, les conférences contradictoires de l’Abbé Desgranges – j’ai fait partie de cercles d’études, de syndicats – j’ai plusieurs années de vie d’atelier […] ». Mais, très vite, il va occuper divers emplois avant de devenir représentant pour Michelin en Amérique du Sud (il envoie L’usine chez Rieder alors qu’il travaille sur ce continent). À son retour, il occupera encore divers métiers (qui vont de directeur d’une agence Berliet à représentant pour les machines à écrire Remington). Dans la dernière lettre qu’il envoie à Marcel Martinet en 1944, on apprend qu’il travaille pour l’agence de publicité Neo, à Lyon, où il a notamment la charge de revues, pour lesquelles il s’occupe « de la fabrication des clichés, [des] bons à tirer, [des] transmissions des épreuves, [de] la mise en page, [de] la conception des maquettes » (lettre du 21 janvier 1944). Cette lettre se clôt sur son espoir de « retourner au journalisme ».
L’absence d’informations biographiques précises crée des malentendus de réception : Henry Poulaille lit L’usine (1931) comme le récit écrit par un prolétaire quand certains rappellent que « son emploi dans la métallurgie […] l’a tenu non aux ateliers, mais dans les bureaux et les services techniques1 ». Marcel Martinet le désigne, avec ironie, sous le nom de « Pierre Passeneau, l’industriel à Lyon2 ». Sa correspondance avec Marcel Martinet, lecteur aux éditions Rieder, l’éditeur de Pallu, le présente plus exactement comme un transfuge de classe. Pallu/Passeneau retrace une partie de son parcours dans la lettre du 22 septembre 1930 écrite à Martinet : « Je suis né à Saint-Chamond, pays des grèves, j’y ai vécu jusqu’à 23 ans – j’ai suivi par curiosité, autrefois, les réunions électorales des mineurs de Saint-Étienne, les conférences contradictoires de l’Abbé Desgranges – j’ai fait partie de cercles d’études, de syndicats – j’ai plusieurs années de vie d’atelier […] ». Mais, très vite, il va occuper divers emplois avant de devenir représentant pour Michelin en Amérique du Sud (il envoie L’usine chez Rieder alors qu’il travaille sur ce continent). À son retour, il occupera encore divers métiers (qui vont de directeur d’une agence Berliet à représentant pour les machines à écrire Remington). Dans la dernière lettre qu’il envoie à Marcel Martinet en 1944, on apprend qu’il travaille pour l’agence de publicité Neo, à Lyon, où il a notamment la charge de revues, pour lesquelles il s’occupe « de la fabrication des clichés, [des] bons à tirer, [des] transmissions des épreuves, [de] la mise en page, [de] la conception des maquettes » (lettre du 21 janvier 1944). Cette lettre se clôt sur son espoir de « retourner au journalisme ».
En 1928, il envoie son premier roman à l’écrivain Jean-Richard Bloch, qui dirige la collection des « Prosateurs français contemporains » chez Rieder. Il s’intitule Le danseur de corde et mêle une « histoire d’amour et d’épiderme » (la peur de l’impuissance) à ce que Bloch nomme un roman de la rationalisation. Mais Pallu reconnaît qu’il n’a jamais eu l’idée de « faire un roman de la rationalisation industrielle mais bien d’exposer un cas sexuel particulier » (lettre à J.-R. Bloch du 22 septembre 1928). Il perçoit pourtant dans cette rationalisation « un très grand et très beau sujet » auquel il veut « s’attaquer ». On trouve ainsi les traces de la première mention de L’usine : « […] j’ai envie de la saisir par petites touches, [dans] une série de contes que j’intitulerai – pour le moment – ‘Contes de l’usine’. Hélas aucun d’eux n’est écrit encore et je n’ai pas le temps ce mois-ci tout au moins suffisant pour les écrire. Mais ils sont ébauchés en pensées et je les écrirai un jour ». On peut donc dater de cet échange l’idée pour Pallu d’écrire sur les milieux qu’il connaît. L’écriture de L’usine le fait ainsi entrer dans le champ littéraire comme auteur populiste. Dès ce moment-là, il adhère à cette écriture populiste (même s’il se moque de la bienveillance d’André Thérive, chef de file du mouvement populiste, pour un peuple qu’il ne connaît que de loin) qu’il prend soin de différencier d’une écriture engagée ou prolétarienne. Cette « identité littéraire » lui apporte une indéniable reconnaissance.
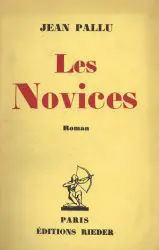 Toutefois, quelques années plus tard, la réception de son sixième et dernier livre, Les novices, le plonge dans une crise de désespoir qui le paralyse et l’amène à brûler ce qu’il écrit : « Du point de vue littéraire rien de nouveau non plus. À vrai dire depuis Les novices, je n’ai rien écrit de sérieux, des petits bouts, des essais, de la pacotille. D’abord j’ai été très touché par les attaques que Les novices m’ont values de la part de certains critiques qui ont voulu voir de la politique alors qu’il n’y avait que de la peinture objective. C’est idiot de ma part d’y attacher de l’importance mais je suis ainsi fait », écrit-il à Martinet le 28 décembre 1937.
Toutefois, quelques années plus tard, la réception de son sixième et dernier livre, Les novices, le plonge dans une crise de désespoir qui le paralyse et l’amène à brûler ce qu’il écrit : « Du point de vue littéraire rien de nouveau non plus. À vrai dire depuis Les novices, je n’ai rien écrit de sérieux, des petits bouts, des essais, de la pacotille. D’abord j’ai été très touché par les attaques que Les novices m’ont values de la part de certains critiques qui ont voulu voir de la politique alors qu’il n’y avait que de la peinture objective. C’est idiot de ma part d’y attacher de l’importance mais je suis ainsi fait », écrit-il à Martinet le 28 décembre 1937.
Cette crise est aussi l’occasion de comprendre un peu mieux l’enjeu de la représentation littéraire chez Pallu à la fin des années 1930. En effet, cette mauvaise réception le conduit, écrit-il, à « abandonner le populisme car à l’heure actuelle il me semble impossible de faire du populisme sans faire de la politique et de la politique en littérature je n’en veux pas » (ibid.). Pallu refuse alors ce qu’il considère comme une idéalisation du peuple : « Vous me dîtes que ce qui vous a déplu dans Les novices c’est une certaine férocité froide, pénible et ingénue pour parler des ‘prolos’. Mais mon cher Martinet, les ‘prolos’ me dégoûtent autant que les bourgeois et n’oubliez pas que j’ai écrit dans L’usine que je n’aimais pas l’ouvrier en dehors de son travail. Je le maintiens d’autant mieux que pendant les grèves (qui durent encore à Lyon dans l’essence) j’ai été trop bien placé pour me faire une opinion. J’ai été écœuré au même point, d’une part par l’égoïsme et l’incompréhension des patrons, d’autre part par la bêtise et la lâcheté des ouvriers. Vous me parlez des grandes choses que je pourrais écrire » (lettre à Marcel Martinet, 25 juin 1936). Cette affirmation qui conduit Pallu à renoncer à l’écriture, ou du moins à la publication, explique nombre des caractéristiques de ses romans, où l’on peut lire un certain usage du populisme, et où se découvre une histoire du roman des classes moyennes.
Un agrégat d’individus
Contrairement à ce que laisse entendre le titre de son premier ouvrage, L’usine, l’ensemble des livres de Pallu ne décrit pas la condition ouvrière mais celle des employés. L’univers de ces récits est donc moins celui de l’atelier que des bureaux, où se mêlent secrétaires, employés, magasiniers, représentants de commerce ou encore chefs de projet. La spécificité de Pallu (et on le lui a reproché) est de décrire moins une classe qu’un groupe, moins un corps politique qu’un agrégat d’individus réunis dans un même lieu de travail. Le groupe ne peut faire corps dans ces récits parce qu’il est constitué d’individus accrochés à des signes distinctifs qui les rangent dans une classe moyenne et les différencient de la classe ouvrière. L’écriture de Pallu déjoue cet imaginaire de la classe moyenne en insistant sur la vanité de cette croyance illusoire. De petites touches adjectivales ou quelques remarques du narrateur abolissent la prétention de celui qui croit avoir échappé à la médiocrité et à l’aliénation. Les livres de Pallu opèrent ainsi une mise à nu de la misère de l’homme moyen, c’est-à-dire de son irrémédiable solitude. Le personnage type de Pallu n’appartient ni au prolétariat ni à la classe des possédants (Jouer le jeu). Ses récits représentent donc le malheur du transfuge de classe, condamné à consommer des produits spécialement calibrés pour satisfaire son plaisir de l’imitation de la richesse et de l’exotisme. Ses livres mentionnent ainsi les objets du monde moderne commercial destinés à remplir cette satisfaction illusoire de la classe moyenne, enfermée dans ses clichés prêts à consommer.
Rêver l’aventure
Au sein de ce groupe, un personnage se distingue : le voyageur de commerce. Qu’il soit un personnage secondaire ou central, il est la plupart du temps présent dans les romans de Pallu. Figure importante de ses récits, il est un moyen de réfléchir à l’aventure et de s’interroger sur la possibilité d’écrire un roman romanesque. En effet, de nombreux personnages sont hantés par le désir de voyager, de courir le monde, de tenter l’aventure mais tous ont renoncé et se sont contentés de rêver, « comme tout le monde, de bagages en beau cuir, couverts d’étiquettes, parfumés du goudron des ports et des cales de navires » (Port d’escale). Et, certains, quand ils ont voyagé, reviennent affaiblis et déçus (La Créole du Central garage). L’aventure est donc un motif central des écrits de Pallu (il a même écrit un texte intitulé « Aventures-scénario pour film muet » en 1933). Or, ses récits mettent en scène la perte de l’Aventure telle que Joseph Conrad la raconte (Au cœur des ténèbres est longuement cité par un personnage de Port d’escale) : elle se réduit chez Pallu aux pérégrinations du voyageur de commerce. Quant à ceux qui restent, ils se contentent d’imaginer la grande aventure et se satisfont de petits voyages, des rêveries exotiques provoquées par certains corps de femmes. Sans doute l’aspect le plus intéressant réside-t-il dans l’attention que Pallu porte aux succédanés de l’aventure présents dans le monde moderne : imageries et clichés, rêveries et petits voyages… Autant d’éléments qui soulignent qu’il n’y a plus d’Aventure. Le récit enregistre la disparition d’un certain romanesque, d’un possible romanesque dont Conrad et ses livres seraient les derniers représentants (peut-être Pallu s’est-il lui-même figuré comme cet écrivain voyageur ?). Les romans de Pallu créent ainsi une dynamique narrative où existe une tension entre le désir de l’Aventure (parfois sa réalisation), son excitation, même si elle n’est qu’imaginaire, et sa chute, sa déflation et sa déception. La logique narrative possède ici cette qualité de restituer la pauvreté et la médiocrité de l’aventure moderne. Le héros romanesque n’est donc plus qu’un voyageur de commerce, qui dort le soir à l’hôtel après avoir fait son « tour ». Cette réflexion sur l’aventure oblige le roman à repenser la fonction et le sens du romanesque : le romanesque du roman ne dépend plus de la succession d’événements racontés, mais de la rêverie que l’aventure produit dans l’esprit des employés. Le réel est ainsi représenté débarrassé de toute poétisation – il n’existe aucun « réalisme poétique » chez Pallu – et, en même temps, de tout misérabilisme. S’il existe une indéniable mélancolie qui accompagne la lucidité de la plupart des personnages sur leur situation et leur impossible départ, tous continuent à vivre, à « jouer le jeu », malgré tout. Et sans aucun doute cette tonalité-là participe de la modernité et de l’originalité de ces récits.
La dépossession du temps
L’aventure, vécue, rêvée, consommée ou avortée est indéniablement un moyen pour les personnages de remplir les vacances, ou plus exactement la vacance, ce temps libre qui peut faire peur. En effet, le temps est un motif essentiel de l’univers romanesque de Pallu. Le temps est ici commandé par l’entreprise et le travail. Les récits témoignent des différents rythmes auxquels les employés sont soumis ; que ce soit dans l’entreprise plutôt familiale et paternaliste, ou à l’usine au mode de production tayloriste, les 24 heures d’une vie sont soumises à cette organisation temporelle imposée. Les personnages construisent ainsi leur propre rapport au temps en fonction de cette rationalisation temporelle : certains s’y soumettent, l’acceptent et vivent de façon étriquée dans ces limites qui condamnent le plaisir au samedi soir. Cette rationalisation réduit les hommes au statut d’objets qui trouvent leur place et leur fonction dans un espace lui-même délimité et contraint, à l’image des casiers décrits dans L’usine. Ce mouvement du monde moderne enlève à l’homme la possibilité de donner un sens à son existence, et les livres de Pallu laissent ainsi transparaître une mélancolie lucide parfois proche de la résignation : nombreux sont les personnages à se « ranger » et à accepter leur état. Il existe néanmoins des personnages pour résister à cette dépossession du temps. Certains individus réussissent à faire l’expérience de l’intensité temporelle : une étreinte, un voyage, une soirée peuvent laisser percevoir un état où l’être fait corps avec son désir et sa volonté, où ils se possèdent. Mais il ne s’agit que de moments fugaces.
Le récit des solitudes
Les livres de Pallu décrivent la solitude particulière de l’individu qui appartient à la classe moyenne, où il ne peut trouver une action militante qui donnerait du sens à son existence. Ses « héros » ne savent s’engager que dans un projet individuel parce qu’ils pensent pouvoir se sauver en se retrouvant, en accédant à une plénitude qui leur donnerait le sentiment de vivre. Mais ces « aventures » sont toutes condamnées à l’échec, et il semble ne rester qu’une solution, les raconter. La voix narrative, derrière une apparente simplicité, est en effet très intéressante. Souvent, le narrateur entretient un lien avec la voix de l’auteur construite par le pseudonyme. Que ce soit dans L’usine, par la présence d’une voix qui semble émaner de l’usine elle-même dans toute sa diversité ou, plus précisément, au moyen des voix de représentants de commerce dans de nombreux autres récits, le récit prend la place de l’action et de l’aventure : il ne reste donc, pour se sauver – c’est encore une stratégie individuelle – qu’à raconter puisqu’on ne peut vivre pleinement. Les voix narratives dessinent alors une figure auctoriale particulière, Pallu, qui symptomatise la tristesse du voyageur pour qui le récit est la seule façon de compenser la fin de l’aventure, de l’expérience intense, du romanesque. Le récit serait donc ce qui reste pour échapper à cette solitude et à cet ennui. Le silence de l’auteur après 1936 s’expliquerait-il alors par une écriture elle-même saisie par l’ennui ?
Lire Pallu aujourd’hui : le roman et la classe moyenne
Les romans de Pallu constituent une intéressante lecture pour qui veut comprendre les modifications et l’évolution de la représentation du « peuple ». Ils s’attachent en effet à déjouer les topoïde cette peinture en donnant toute son importance à une population qui travaille et ne possède pas de patrimoine, mais qui ne se considère pas comme membre d’une classe prolétarienne.
Les groupes dépeints échappent à une misère prise en charge par le roman prolétarien ; ils sont plutôt composés d’individus dont l’ambition est d’améliorer leur quotidien, sans que cela implique un acte révolutionnaire. Le peuple de Pallu oscille donc entre l’espoir d’une amélioration du quotidien et différentes formes de dépossession de soi, que l’auteur ne juge pas. Peut-être accomplit-il, sans le vouloir, l’ambition véritable du roman populiste3, qui est de restituer cette vie populaire.
La manière dont il s’attarde sur ce peuple préfigure ainsi les enjeux du roman moderne, où les êtres sont présentés comme des individus et non comme les membres d’une classe qui construirait leur identité et leur devenir. Il veut peindre ce monde d’« employés » qui constitue, au sens large, ce que l’on nomme une « classe moyenne », basse ou haute. Cette ambition romanesque de Pallu explique, par exemple, la dédicace des Novices à Sinclair Lewis dont Babbitt, peinture de l’archétype de la classe moyenne américaine, avait connu un grand succès en France dans les années 1930.
L’intérêt des romans de Pallu est ainsi de faire voir une « classe » abusivement nommée ainsi. Ses personnages font certes partie d’un groupe, mais ils sont d’abord des individus. Ils n’ont rien à défendre ; chacun essaie de se sauver, d’échapper à l’ennui ou à une existence perçue comme médiocre et insuffisante. En ce sens, l’écriture de Pallu restitue cette quotidienneté populaire qui dépossède l’individu de lui-même.
 Pallu se révèle ainsi attentif à ce qui permet tout de même à un groupe de se constituer comme tel. En effet, ses personnages appartiennent à un même univers de consommation qui façonne leur désir et leur comportement : les individus se construisent en fonction des images et des imaginaires que la société de consommation leur propose. Ses livres évoquent ce qui tisse leur quotidien : le cinéma (cette fascination pour la modernité transparaît dans ses lettres où il évoque très souvent le cinéma, et son rêve de réussir dans la nouvelle forme du « récit cinématographique »), les voyages organisés par les agences, les best-sellers, certains objets… Les individus se pensent ainsi comme groupe en fonction de ces imaginaires médiatiques, de ces signes, qui se disséminent dans un mode de vie encore traditionnel. Mais, pour reprendre un titre d’Eugène Dabit, ils restent de « faux bourgeois ».
Pallu se révèle ainsi attentif à ce qui permet tout de même à un groupe de se constituer comme tel. En effet, ses personnages appartiennent à un même univers de consommation qui façonne leur désir et leur comportement : les individus se construisent en fonction des images et des imaginaires que la société de consommation leur propose. Ses livres évoquent ce qui tisse leur quotidien : le cinéma (cette fascination pour la modernité transparaît dans ses lettres où il évoque très souvent le cinéma, et son rêve de réussir dans la nouvelle forme du « récit cinématographique »), les voyages organisés par les agences, les best-sellers, certains objets… Les individus se pensent ainsi comme groupe en fonction de ces imaginaires médiatiques, de ces signes, qui se disséminent dans un mode de vie encore traditionnel. Mais, pour reprendre un titre d’Eugène Dabit, ils restent de « faux bourgeois ».
Le roman peut alors en arriver à jouer avec les codes de certains récits médiatiques, comme dans Les novices, où le fait divers spectaculaire de la presse redouble la banalité de l’histoire principale ; ou encore, comme dans la fin de Port d’escale, où les photos semblent subtilement désigner le livre lui-même.
Enfin, les livres de Jean Pallu sont intéressants par le jeu identitaire qu’ils instaurent, mais pour les éclaircir, il faudrait améliorer notre connaissance de sa biographie. Le jeune personnage qui meurt dans Les novices ne s’appelle-t-il pas Petrus ? Comment ne pas lire nombre de notations comme des résurgences de sa propre expérience de voyageur de commerce ? Il existe un jeu autofictionnel à décrypter, pour lequel il nous manque encore des éléments.Décidément, il reste encore à explorer ce continent Pallu.
Jean Pallu a publié : aux éditions Rieder dans la collection « Prosateurs français contemporains » : L’usine, 1931 (réédition La Thébaïde, 2018) ; Port d’escale, 1931 ; Marées, 1933 ; J’ai failli boucler la boucle, 1934 ; La Créole du Central garage, suivie de Jouer le jeu, 1935 ; Les novices, 1936.
1. L’œil de Paris pénètre partout, 2 janvier 1932.
2. Jean-Richard Bloch et Marcel Martinet, Correspondance (1911-1935), op.cit., p. 331, lettre 371, du 25 août 1929.
3. Voir Léon Lemonnier, Manifeste du roman populiste et autres textes, édition critique de François Ouellet, La Thébaïde, 2017.
EXTRAITS
Devant moi, sur sa table de contremaître où je m’accoude, l’aiguille de mon chronomètre tourne avec une saccade à chaque seconde. Quelques mètres plus loin, un ouvrier perceur a deviné que je « prends son temps » pour établir « son prix » et il freine avec une habileté de vieux routier. Il ne peut pas ralentir l’avance et la vitesse de ses forêts, car sa machine est automatique, mais il multiplie ses gestes, se baisse 2 fois pour une pour prendre une pièce à ses pieds, se courbe lentement quand il l’a percée pour la poser avec des précautions infinies dans la bassine, derrière lui, manipule ses douilles Presto avec des doigts frôleurs, craintifs, comme si elles étaient en ivoire.Pauvre diable. Triste lutte de tous les instants entre les « productifs » comme lui et les « improductifs » comme moi.
L’usine, La Thébaïde, 2018 (1931), p. 68-69.
Puis il y avait un lac, une mare d’un kilomètre de large, dans le cratère d’un ancien volcan. Un photographe idéaliste en avait tiré des vues facétieuses avec des effets de clair de lune, des premiers plans de sapins déchiquetés, des rochers à fleur d’eau, une petite barque… Elle avait acheté la collection complète. Elle l’apporta un matin et la montra à Reynault. Puis, brusquement, pendant qu’il l’étalait devant lui, elle la lui reprit. —Que voulez-vous ? dit-elle avec un triste sourire, pour moi, c’est un peu de la mer.
Port d’escale, Rieder, 1931, p. 243.
Faire travailler ma sœur, celle qui m’a élevé après la mort de ma mère, celle qui fut ma confidente et ma conseillère jusqu’à son mariage ? C’est impossible. Je ne peux expliquer à Lieutaud combien cette idée me semble monstrueuse. En outre à quoi bon le froisser en lui disant que, nous, nous ne sommes pas comme lui des ouvriers et que notre niveau social, sans être très élevé, nous oblige à tenir un certain rang… que nous avons un certain nombre d’obligations qu’il nous faut remplir, que nos amis, etc… À quoi bon pour deux ou trois dimanches que nous passons ensemble chaque année créer des discussions pénibles ?
J’ai failli boucler la boucle, Rieder, 1934, p. 16.










