À l’occasion du centième anniversaire de la publication de La Scouine d’Albert Laberge, Gabriel Marcoux-Chabot offre une nouvelle écriture de ce roman1 aux éditions La Peuplade.
Le roman naturaliste de Laberge est célèbre. Le grand public le connaît sans doute mal, mais les étudiants le lisent, souvent pour des raisons pratiques, il est vrai : il fait moins de 150 pages. Mais ce sont des pages fignolées, bien compactes, d’une économie narrative resserrée autour de scènes qui évoquent une suite de nouvelles. Ici la vision sombre des paysans, leur cupidité et leur esprit fruste tranchent généreusement avec l’idéal agriculturiste de l’époque ; Mgr Camille Roy, recteur de l’Université Laval et influent critique littéraire, et Mgr Bruchési, archevêque de Montréal, eurent tôt fait de ranger le livre au rayon de la « pornographie », livre qu’on oublia jusqu’à sa réédition au début des années 1970.
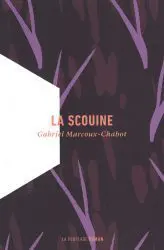 Si La Scouine est un roman remarquable, la version qu’en offre Marcoux-Chabot ne l’est pas moins. Les plus malins observeront, aux dépens de l’entreprise de réécriture, que Marcoux-Chabot reconduit de nombreux chapitres du roman presque mot pour mot. Ce serait le juger imprudemment. Si, comme je l’ai fait, on a relu le roman de Laberge au préalable, on est frappé, dès le premier chapitre, par le travail d’épuration de Marcoux-Chabot. Il a finement élagué ici et là, habilement circonscrit l’essentiel, substitué le présent à l’utilisation par Laberge des temps du passé, opérant un étonnant travail de stylisation et de concision par rapport à un roman qui déjà passait pour une sorte de modèle d’écriture dénuée de toute surcharge stylistique. D’emblée, en somme, le roman gagne en clarté, en précision. Tous les chapitres n’ont pas cette haute tenue du chapitre initial, mais très peu sont inférieurs à ceux de Laberge.
Si La Scouine est un roman remarquable, la version qu’en offre Marcoux-Chabot ne l’est pas moins. Les plus malins observeront, aux dépens de l’entreprise de réécriture, que Marcoux-Chabot reconduit de nombreux chapitres du roman presque mot pour mot. Ce serait le juger imprudemment. Si, comme je l’ai fait, on a relu le roman de Laberge au préalable, on est frappé, dès le premier chapitre, par le travail d’épuration de Marcoux-Chabot. Il a finement élagué ici et là, habilement circonscrit l’essentiel, substitué le présent à l’utilisation par Laberge des temps du passé, opérant un étonnant travail de stylisation et de concision par rapport à un roman qui déjà passait pour une sorte de modèle d’écriture dénuée de toute surcharge stylistique. D’emblée, en somme, le roman gagne en clarté, en précision. Tous les chapitres n’ont pas cette haute tenue du chapitre initial, mais très peu sont inférieurs à ceux de Laberge.
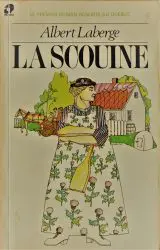
Mais ce n’est là qu’un aspect du travail d’écriture de Marcoux-Chabot. Il donne aux personnages une certaine épaisseur psychologique qui fait défaut chez Laberge. Cette profondeur, on la voit par exemple dans le regard que porte la mère sur la Scouine (ch. 3), lorsque le romancier s’attarde sur la laideur de la Scouine (détail absent chez Laberge et qui devient pourtant évident chez Marcoux-Chabot) ou lorsqu’il reconfigure le personnage de Charlot, lequel acquiert, en raison du désir qui le ronge, une importance qu’il n’a pas tout à fait chez Laberge. Cet érotisme, aspect le plus novateur de l’œuvre, fait l’objet de plusieurs « nouveaux » chapitres, le désir de Charlot trouvant enfin à s’épancher dans l’avant-dernier chapitre du roman. Ce chapitre est toutefois moins réussi : on comprend que l’auteur a voulu stylistiquement marquer l’extase de Charlot, mais le lyrisme qui le caractérise dépare le ton autrement réaliste du roman. Par ailleurs, le mal-être de ce personnage, dont l’accident qu’il subit chez Laberge se transforme en velléité suicidaire chez Marcoux-Chabot, est peut-être un brin exagéré. Le romancier a inventé quelques autres très beaux chapitres (l’onanisme de Bagon, par exemple), introduit des variantes ici et là (l’achat des vaches à la veuve d’Ernest Gendron, par exemple), inséré quelques moralités désabusées (ch. 9 et 12, notamment), etc. Un travail d’orfèvre bien mené.
On sait que Gabriel Marcoux-Chabot prépare actuellement une thèse sur l’érotisme dans l’œuvre de Laberge. Ceci expliquant cela, l’entreprise de réécriture gagne en intérêt et en pertinence. J’ose cependant espérer que l’auteur n’a pas malgré lui ouvert là une boîte de pandore dans laquelle des écrivains en mal d’inspiration pourraient puiser l’envie de réécrire Le Survenant ou Les grandes marées. Il y a quelques années, le cinéaste Denys Arcand avait proposé un petit récit d’après Trente arpents de Ringuet2, mais c’était là complètement autre chose. Et si l’exercice an récit d’après uquel s’est prêté Marcoux-Chabot suscite l’intérêt, c’est bien parce qu’il est inusité. Souhaitons qu’il le reste.
Parce que Paulima pissait au lit, elle répandait son odeur à l’école : alors ses camarades la surnommèrent la Scouine, « mot sans signification aucune, interjection vague qui nous ramène aux origines premières du langage », écrit Albert Laberge.
1. Gabriel Marcoux-Chabot, La Scouine, La Peuplade, Chicoutimi, 2018, 120 p. ; 20,95 $.
2. Denys Arcand, Euchariste Moisan, Leméac, Montréal, 2013.











