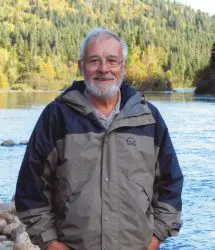Retraité depuis peu, l’écrivain et éditeur1 Jean-Yves Soucy part en 2010 établir ses pénates près du petit village nord-côtier de Baie-Trinité. Dans une roulotte de seize pieds avec vue plongeante sur une frange de sable qui étreint le Saint-Laurent, il coulera des jours tranquilles en compagnie de sa femme et des quelques visiteurs de passage durant son séjour. Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos2, ouvrage en forme de bilan publié à titre posthume,revient sur ces quatre mois de sérénité passés à méditer, à courir les bois et les fosses à saumon.
Les promenades d’un rêveur solitaire
Aussitôt arrivé, Soucy délaisse le confort tout relatif de son logis pour folâtrer libre et léger à la découverte des alentours. Le territoire hirsute de la Côte-Nord offre un terrain de jeux idéal au naturaliste en herbe, qui recourt volontiers à Carl von Linné, Pehr Kalm ou Jean-François Gaultier au moment de faire état de ses découvertes. Déchiffrer la nature, décrypter cette énigme que l’on nomme le monde : on devine à lire l’auteur acclamé d’Un dieu chasseur (1976) l’inextinguible soif de comprendre qui l’anime. Non pas pour « faire » savant auprès des uns ou des autres, mais dans cette noble perspective de bonifier son expérience sur terre, d’atteindre à un certain degré de compréhension, si partielle et imparfaite soit-elle, des lois régissant son environnement.
« Il ne suffit pas de contempler un paysage pour le ‘lire’ », confie-t-il à ce propos, « il faut savoir ce qu’on regarde. Un paysage ne parle pas, sinon à l’âme et aux sens, ce qui revient au même. En se fiant uniquement à ses yeux, on ne voit que l’apparence, somme toute banale, du monde ». Armé de la modestie souriante de celui qui a compris que la connaissance humaine reste dérisoire face à la complexité de l’univers sensible, Soucy s’abandonne à des exercices de contemplation dont les plus beaux morceaux offrent justement d’authentiques leçons de lecture paysagère. Jonglant habilement avec des notions de géologie, de mycologie et de physique, il invite à la curiosité et livre une série de descriptions saisissantes de réalisme.
Il arrive aussi que ces paysages le tirent vers la rive opposée du Saint-Laurent, celle de sa Gaspésie natale qui lui revient en mémoire au détour d’une sente tortue. Les bois se transforment soudain en ceux de Causapscal, où il a butiné pendant sa prime enfance. Ou en ceux d’Amqui, arpentés en compagnie de son frère. Soucy se souvient. Il marche et se rappelle ce frère, Bertin, décédé depuis, à l’aube de la soixantaine, un âge vénérable compte tenu de l’obésité morbide avec laquelle il a dû composer une bonne partie de sa vie. Celui que ses proches surnommaient Ovide Plouffe se remémore encore le parfum de ses institutrices, la découverte des joies de la culture classique, de l’opéra, du théâtre et mille choses encore : cheminant droit devant, c’est pourtant vers l’arrière qu’il porte son regard.
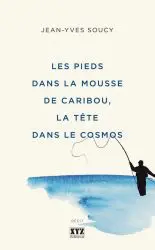 Presque toujours l’homme marche en solitaire, laissant sa partenaire à son écriture. Il se promène avec pour seul compagnon le silence que déchire parfois le cri de cette rivière couchée dans un lit en forme d’auge aux contours arrondis, comme une princesse secouée de soubresauts durant un sommeil agité. Il en est des rivières comme des femmes, écrit-il en ce sens ; elles ont chacune leurs petits secrets, leurs atours particuliers. Et dans le cœur de chaque homme en coulerait une, paraît-il ; dans celui de Soucy coule désormais Trinité, enclave aquatique dévalant sur plus de 74 kilomètres, ici tranquille, torrentueuse plus loin, ajustant constamment ses humeurs, tantôt accentuées par les déclivités du terrain, tantôt contenues par les digues. Bien vite, la Trinité prend donc vie, ainsi que tout l’écosystème qu’elle berce entre la vallée du Saint-Laurent et le Bouclier canadien. Puis, s’étant familiarisé avec sa nouvelle muse, c’est ensuite à Salmo salarque Soucy entend faire la cour.
Presque toujours l’homme marche en solitaire, laissant sa partenaire à son écriture. Il se promène avec pour seul compagnon le silence que déchire parfois le cri de cette rivière couchée dans un lit en forme d’auge aux contours arrondis, comme une princesse secouée de soubresauts durant un sommeil agité. Il en est des rivières comme des femmes, écrit-il en ce sens ; elles ont chacune leurs petits secrets, leurs atours particuliers. Et dans le cœur de chaque homme en coulerait une, paraît-il ; dans celui de Soucy coule désormais Trinité, enclave aquatique dévalant sur plus de 74 kilomètres, ici tranquille, torrentueuse plus loin, ajustant constamment ses humeurs, tantôt accentuées par les déclivités du terrain, tantôt contenues par les digues. Bien vite, la Trinité prend donc vie, ainsi que tout l’écosystème qu’elle berce entre la vallée du Saint-Laurent et le Bouclier canadien. Puis, s’étant familiarisé avec sa nouvelle muse, c’est ensuite à Salmo salarque Soucy entend faire la cour.
Salmo salar : histoires de pêche
Benjamin Franklin avait coutume de dire que, quand Il faisait le total des jours qu’il nous restait à vivre, Dieu ne comptait pas les journées passées à la pêche. Dans son infinie bonté envers cette créature à part qu’est le pêcheur, Dieu n’a pourtant jamais pris la peine de garantir succès à ses efforts. Aussi la manne est-elle rare pour le néophyte : Soucy le sait, qui prend le temps d’apprivoiser la dame Trinité, en étudie chaque détour, crevasse et rapide. À l’origine, ses vacances devaient d’ailleurs être prétexte à amasser des images, à s’imprégner de sensations, d’émotions destinées à écrire L’été du saumon, un livre englobant des sujets épars, dont la forme imprécise a voulu qu’il soit finalement qualifié de récit.
N’empêche, une bonne partie de ce récit est employée à démystifier cette aura mythique qui entoure Salmo salar. Muni de bottes-pantalon, de cannes à moucher et de toute la panoplie du pêcheur à la mouche, l’auteur s’initie progressivement à ce véritable huitième art qu’est la pêche au saumon : « J’étudie chaque geste du pêcheur, sa moindre réaction aux agissements du poisson. Comme saumonier, je manque cruellement d’expérience ; mes connaissances ne sont que livresques, car je suis un pêcheur de truites, de dorés et d’achigans à l’occasion, et mes mouches à saumon sont toutes vierges ».
Après la théorie, il passe à la pratique. Il goûte à la poésie – le mot vient de lui – de ces gestes rituels qui proposent, au même titre que la marche, une forme de méditation active. La pêche est surtout un état d’esprit, un « lavement cérébral », une disposition particulière qui consiste à épouser le rythme de la nature et de ses éléments tandis que la conscience vagabonde, faisant table rase des autres préoccupations. Ne restent plus que ces gestes répétitifs qui fendent l’air avec régularité, ainsi que les ondes d’une mouche venue troubler la quiète surface de l’eau.
Aidé par quelques membres de la confrérie des saumoniers croisés au hasard du chemin, le nouveau retraité profite des conseils, secrets et confidences de chacun. Car la pêche au saumon, plus qu’aucune autre forme de pêche, est passion et partage. Or, si les échanges illuminent le quotidien du moucheur, la pêche à la mouche reste une activité intime et profondément solitaire. Même lorsqu’elle est pratiquée en duo, comme avec ce Marcel Tremblay à la bonhomie contagieuse, la règle, bien que non dite, est claire et simple : « chacun de son côté, en solitaire absorbé dans son rapport aux poissons, à la nature, en somme ».
Salmo salarn’est donc pas seulement mythique pour sa combativité, son intelligence et la finesse de sa chair que le moucheur aguerri, au prix d’un sublime entêtement, pourra potentiellement savourer. Il l’est surtout parce qu’il rappelle à l’homme, mieux encore que les autres espèces de salmonidés, sa bienheureuse impuissance ; ses ruses montrent qu’il subsiste des choses qui échappent par bonheur au contrôle humain. Telle est la plus belle leçon de Salmo, une leçon qui semble toutefois relever de l’acquis pour Soucy : l’humilité.
La vie, la famille, la mort : histoires sans fin
Le saumon, c’est chose connue, a cette particularité de remonter durant la fraie vers le lieu de ses origines. De même, le voyage entamé par Soucy l’entraîne vers une sorte de remontée, non pas géographique dans ce cas, mais temporelle. L’heure est bel et bien aux rétrospectives. Dédié aux petits-enfants de l’écrivain, Les pieds dans la mousse représente à plusieurs égards un acte de passation consistant àparler de sujets qui lui tiennent à cœur. Le livre porte ainsi l’ambition avouée de léguer une vision du monde bien singulière, habitée par une rare sensibilité et une sagesse qui ne s’obtient qu’au prix d’une certaine disponibilité intellectuelle.
Portant un regard attendrissant sur son entourage, Soucy fait en même temps le point sur sa vie familiale. Ces passages où il se met à nu sont d’une profonde tendresse et d’une beauté brute. A-t-il convenablement rempli sa mission de père ? L’homme se garde bien de répondre, mais le plaisir et la fierté qu’il manifeste à avoir assumé la paternité, à avoir servi de guide à ses deux filles, parlent d’eux-mêmes. Père heureux, il est en plus grand-père comblé. À en croire les attentions dont il entoure ses petits-enfants, en compagnie de qui il taquine la truite mouchetée pendant de trop courtes semaines, ceux-ci ont de quoi l’être également.
Ces sorties de pêche représentent des moments de grâce privilégiés volés à la routine. Assis au fond de sa chaloupe, Soucy contemple la marmaille et songe au film de Pierre Perrault, Pour la suite du monde. Lui reviennent alors en tête les paroles de Robert Lamoureux chantées par Marcel Mouloudji : « Tu n’es qu’un maillon de la chaîne / Tu n’esqu’un moment de la vie / Un moment de joie, de misère / Etpuis on t’enterre, et puis c’est fini ». La jeunesse agitée lui rappelle que la sienne est déjà loin, qu’il est le maillon d’une chaîne sans fin qui n’a plus besoin de son concours pour soutenir la postérité. L’auteur en effet ne se leurre pas. Le point de départ est plus loin que ne l’est l’arrivée, quoique cette perspective ne le décourage guère.
Plusieurs lignes d’une lucidité fulgurante traitent de sa vision de la mort, passage tout à fait naturel et souhaitable, selon lui. Et tout porte à croire que ce point final lui donne à apprécier des choses qui, autrement, resteraient d’une assommante banalité. C’est peut-être, d’ailleurs, parce qu’il a tôt su accepter cette première vérité existentielle qu’il a pu développer cette capacité d’émerveillement imprégnée dans chacune de ses pages. Les étoiles, une sarracénie pourpre, le vent dans les branches d’épinette, autant de raisons qui font que la vie doit être vécue. Ça, et la pêche au saumon, bien sûr : « s’il faut mourir », avance Soucy, « au moins que ce soit vers la fin de la saison de pêche ». Son souhait aura été entendu. L’homme s’est éteint le 7 octobre dernier, quelques semaines à peine après la fermeture de la pêche à la mouche.
1. Il a été directeur littéraire de la fiction pour le Groupe Ville-Marie Littérature (VLB, l’Hexagone et Typo) jusqu’en 2005, puis éditeur-directeur du groupe jusqu’en 2010.
2. Jean-Yves Soucy, Les pieds dans la mousse de caribou, la tête dans le cosmos, XYZ, Montréal, 2018, 244 p. ; 24,95 $.
EXTRAITS
J’ai presque complété le tour de ma vie et je redeviens le garçon de cinq ans qui s’émerveille devant le monde, l’adolescent qui découvre avec ravissement la complexité des êtres humains. En fait, je n’ai jamais cessé de le faire, j’en reprends simplement conscience.
p. 10-11
J’observe les six pêcheurs qui fouettent de leur soie la fosse qui leur a été attribuée. Des saumons sautent ici et là, surtout près du barrage, dans les vingt-cinq mètres où la pêche est interdite. Grimpé sur une grosse roche qu’une passerelle en bois relie à la rive, un pêcheur lance un « Wow ! » excité. Il vient de ferrer un saumon ; mains agrippées à la poignée de liège, il semble absent au monde.
p. 81
Ces enfants sont l’avenir, je suis déjà en grande partie du passé, constatation qui ne me déprime nullement. Il faut que les arbres matures tombent un jour afin de libérer l’espace pour les jeunes pousses, c’est dans l’ordre des choses. Et puis, il y a quelque chose de rassurant à savoir qu’un jour tout prendra fin.
p. 130
On dit souvent d’un mort qu’il a quitté le monde. Mais à moins de passer l’arme à gauche de façon subite, c’est le monde qui nous quitte progressivement, peinture qui s’écaille peu à peu, photo numérique dont les pixels perdent leurs informations au fil des ans. Cette réalité, à laquelle nous n’avons accès qu’à travers nos sens, que chacun construit avec les données qu’ils lui fournissent, s’appauvrit à mesure que la vue, l’ouïe et l’odorat s’émoussent. C’est aussi ça, vivre…
p. 192