D’abord femme de théâtre, Yasmina Reza aborde ensuite la société et le temps avec les armes du roman et même la confidence politique. Elle n’entretient pas d’illusion sur l’être humain, ne lui reconnaissant qu’un vernis de savoir-vivre et le jugeant toujours sujet au ressac des pulsions primitives. Par contre, elle pactise avec l’humain lorsqu’il s’épuise, fièrement ou non, à combattre le temps, mais l’humain qui se félicite d’être heureux n’a pas de quoi pavoiser s’il a abdiqué. Heureusement, la vie résiste, surtout, répète l’auteure, grâce aux gestes les plus ordinaires.
Allons d’abord aux genres littéraires (roman et théâtre), puis au détour Sarkozy, pour en arriver aux thèmes et aux procédés. Un excellent analyste nous éclairera au moment de conclure.
Que dire des heureux ?
Le regard de Yasmina Reza ne se laisse pas berner. Dans Hammerklavier, récit plus que roman, elle constate qu’à huit ans sa fille Alta « n’est déjà plus la même râleuse (elle ne râle plus pour se brosser les dents ni pour aller au jardin »). Commence déjà le combat avec le temps.ù
Qui se dit heureux peut n’être qu’éteint ; qui boude le bonheur peut rater le coche. Dans Une désolation, le père septuagénaire enguirlande son fils. Assaut cruel. En fait, le père chérit son fils, mais souffre de le voir ajusté aux ornières. « […] j’accepte de m’éteindre à petit feu ordinaire et j’accepte le mort ordinaire qui me remplacera », mais il ajoute : « Dois-je, sous prétexte de gênes, absoudre un être dont la vision du monde me donne la nausée ? » À la mère qui défend leur rejeton, le père réplique : « […] je veux le mot pur, le mot terrifiant, je veux le mot : heureux ». Il le veut pour le mieux dénoncer, car être heureux, c’est, pense-t-il, imiter l’autruche.
Dans le roman publié en 2009 sous le titre recouvré d’Hommes qui ne savent pas être aimés, Reza se sert sa propre médecine : elle tempère le livre précédent. Adam Haberberg, menacé de cécité, laisse l’inquiétude saper une occasion de bonheur. Il soupçonne le pire chez la femme qui lui apprend avec tact qu’elle l’a aimé autrefois. Erreur. « Croyez-vous docteur, dit Adam, que le monde puisse rester net lorsque vous allez vers l’avenir sans aucune perspective de joie car vous n’êtes plus assez entier pour la saisir ? »
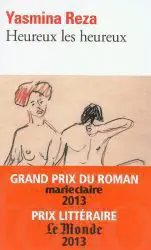 Dans Heureux les heureux, titre de Borges, l’auteure décrit un groupe poreux. Rien n’y désole, rien n’y comble. Quand le petit Antoine refuse un nouveau stylo, Ernest se réjouit : « Voilà le secret, il l’a compris cet enfant, réduire au minimum l’exigence de bonheur ». Quand, profitant d’une absence de sa femme, Luc Condamine accorde enfin à sa maîtresse la faveur de la recevoir chez lui, celle-ci perçoit sa limite : « Je me suis demandé à qui appartenaient les livres, la guitare, l’horrible pied d’éléphant. J’ai dit, tu ne quitteras jamais tout ça ». Si Philip, au seuil d’une vie d’homosexualité, apprend à formuler ses attentes, il renonce à une question : « […] est-ce que tu consoles ? On ne peut pas la poser. On ne peut pas non plus dire, console-moi ». À croire que le titre Heureux les heureux a dérivé, de Borges à Reza, vers le doute. Peut-être définit-il une solution mitoyenne entre la domestication et le désintérêt.
Dans Heureux les heureux, titre de Borges, l’auteure décrit un groupe poreux. Rien n’y désole, rien n’y comble. Quand le petit Antoine refuse un nouveau stylo, Ernest se réjouit : « Voilà le secret, il l’a compris cet enfant, réduire au minimum l’exigence de bonheur ». Quand, profitant d’une absence de sa femme, Luc Condamine accorde enfin à sa maîtresse la faveur de la recevoir chez lui, celle-ci perçoit sa limite : « Je me suis demandé à qui appartenaient les livres, la guitare, l’horrible pied d’éléphant. J’ai dit, tu ne quitteras jamais tout ça ». Si Philip, au seuil d’une vie d’homosexualité, apprend à formuler ses attentes, il renonce à une question : « […] est-ce que tu consoles ? On ne peut pas la poser. On ne peut pas non plus dire, console-moi ». À croire que le titre Heureux les heureux a dérivé, de Borges à Reza, vers le doute. Peut-être définit-il une solution mitoyenne entre la domestication et le désintérêt.
Babylone se nourrit de disproportions. Reza creuse des hiatus entre le meurtre et son prétexte, entre le souci de Lydie pour les poulets d’abattage et son rejet du chat Eduardo, entre la neutralisation de l’enquête et la minutie de la reconstitution, etc. D’un côté, la montée vers le drame ; de l’autre, la vanité des efforts. « On fait tous ça un jour, homme ou femme, on se pavane au bras de quelqu’un comme si on était seul au monde à avoir décroché le gros lot. Il faudrait s’en tenir à ces fulgurances. »
Un théâtre hybride
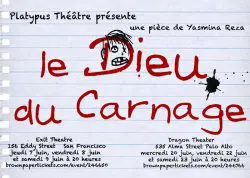 Comédienne elle-même, Yasmina Reza se devait d’écrire ses propres pièces et de les plier à sa loi. Le dieu du carnage arrache le mince derme qui cache la tenace barbarie humaine. Deux couples, fiers de leur raffinement, se rencontrent pour régler dans le savoir-vivre l’empoignade qui a opposé leurs fils. Mamours, mains tendues, concessions éthérées, confidences généreuses, rien n’attente à l’inégalable délicatesse. Malgré tout, imperceptiblement, le fiel perce le vernis et l’apaisement tourne court : injures, procès d’intention, blâmes s’ensuivent et la porte ponctue de son claquement la réapparition des visages haineux.
Comédienne elle-même, Yasmina Reza se devait d’écrire ses propres pièces et de les plier à sa loi. Le dieu du carnage arrache le mince derme qui cache la tenace barbarie humaine. Deux couples, fiers de leur raffinement, se rencontrent pour régler dans le savoir-vivre l’empoignade qui a opposé leurs fils. Mamours, mains tendues, concessions éthérées, confidences généreuses, rien n’attente à l’inégalable délicatesse. Malgré tout, imperceptiblement, le fiel perce le vernis et l’apaisement tourne court : injures, procès d’intention, blâmes s’ensuivent et la porte ponctue de son claquement la réapparition des visages haineux.
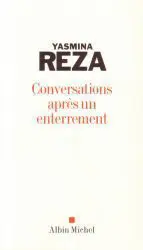 D’une autre tessiture, Conversations après un enterrement manifeste encore chez Reza le dédain des conventions et le risque couru à figer les gens dans leur facies établi. Elle tablera plutôt sur le réveil du cœur humain. Qu’émerge la parole honnête, propre, juste, et le cours des choses la respectera. Pourquoi Alex, carnassier malfaisant, devrait-il persister dans sa hargne ? Pourquoi le père que l’on vient d’enterrer n’aurait-il pas, au temps jadis et à l’insu de (presque) tous, entretenu telle relation discrète ? Faudrait-il, parce que la terre vient de se refermer sur le défunt, nier l’amour qui n’a pas su se faire entendre autrefois ? Reza pousse chacun et chacune hors des ornières.
D’une autre tessiture, Conversations après un enterrement manifeste encore chez Reza le dédain des conventions et le risque couru à figer les gens dans leur facies établi. Elle tablera plutôt sur le réveil du cœur humain. Qu’émerge la parole honnête, propre, juste, et le cours des choses la respectera. Pourquoi Alex, carnassier malfaisant, devrait-il persister dans sa hargne ? Pourquoi le père que l’on vient d’enterrer n’aurait-il pas, au temps jadis et à l’insu de (presque) tous, entretenu telle relation discrète ? Faudrait-il, parce que la terre vient de se refermer sur le défunt, nier l’amour qui n’a pas su se faire entendre autrefois ? Reza pousse chacun et chacune hors des ornières.
Le détour Sarkozy
Yasmina Reza a surpris en accompagnant Nicolas Sarkozy durant sa montée vers la présidence de la France. Elle fut alors, séparée de la meute médiatique qui épie le dauphin politique, le témoin privilégié des échanges entre le candidat et le cénacle où s’expriment à huis clos ses conseillers, son scripteur de discours, ses maquilleurs… Le résultat porte un titre au relief d’énigme (L’aube le soir ou la nuit), car la page d’où provient ce titre se lit ainsi : « Il n’y a pas de lieux dans la tragédie. Et il n’y a pas d’heure non plus. C’est l’aube, le soir ou la nuit ». De quelle tragédie s’agit-il ? De toutes ?
À coup sûr, il y eut, entre Reza et Sarkozy, une entente assortie d’on ne sait quelles clauses. Reza le reconnaît à la fin du parcours : « Je le remercie et ajoute, tu te souviens de notre accord ? Il dit oui. Tu te souviens que je t’accompagne jusqu’à la fin du mois de juin (2007) ? Il dit, tu restes autant que tu veux ». Hélas ! le lecteur ne saura rien de l’accord. À lui de chercher (vainement) la justification d’un livre demeuré en jachère ou de conclure que Reza s’en est tenue à ses intuitions personnelles. Le caractère échevelé de l’ensemble accrédite la seconde hypothèse : à toutes fins utiles, il n’est qu’un calepin farci de sursauts nerveux. Pourtant, c’est le côté intime de ces notes qui confère à l’échange la portée sociale qui risquait de lui faire défaut. Si, en effet, Reza voulait mesurer la part de cabotinage qui brouille et avilit le discours politique et le faire grâce au héros d’une campagne présidentielle, l’expérience a du sens. Reza avait d’ailleurs cerné son objectif dès le départ : « Ce qui m’intéresse, c’est de contempler un homme qui veut concurrencer la fuite du temps ». La contemplation de Sarkozy a-t-elle permis à Reza de juger si un humain peut concurrencer la fuite du temps ? Aucun des deux aspects de la question ne reçoit de réponse tranchée. D’une part, si les références au temps abondent dans ce carnet, c’est cependant des romans et du théâtre qu’on tire le meilleur éclairage du thème. D’autre part, les commentaires qu’échappe Reza au sujet de Sarkozy le montrent peu porté aux jongleries philosophiques. Qu’on en juge par la requête de Reza après la victoire électorale de Sarkozy : « Avant qu’il disparaisse j’avais dit, je voudrais te demander une chose. Oui ? Je voudrais que tu m’accordes ce que tu n’as jamais voulu faire. Quoi ? Une conversation réelle ». En arriver là après un an de contemplation…
Thèmes et secrets
Dans le cas de Reza, parler de thèmes et surtout de thèmes récurrents ne doit pas laisser croire à une orthodoxie figée. Chez elle, un thème est plutôt ce qu’elle ne cesse de sasser dans ses cribles.
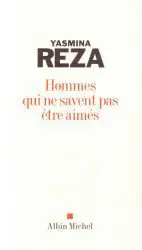
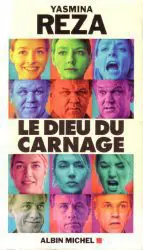 La vie, dans ce qu’elle a d’ordinaire, est le levier choisi par Reza pour garder les tensions à distance du drame. Quand monte le voltage entre Nathan et Alex au sujet d’Élisa, ex-maîtresse d’Alex et amoureuse de Nathan (Conversations après un enterrement), c’est la préparation tribale d’un pot-au-feu (avec tomates !) qui canalise et évacue le trop-plein. Lorsque les couples du Dieu du carnage planent dans leur hypocrite bienséance, c’est le téléphone qui ramène l’un des mâles à ses mensonges et crève la tromperie. Quand le lecteur se demande quel drame attend Adam Haberberg (Hommes qui ne savent pas être aimés), ce sont les compétences concrètes et sereines de Marie-Thérèse qui assainissent le dialogue : les gestes de la femme témoignent de sa transparence. Il n’y aura ni viol, ni meurtre. À la fois thème et frein, le geste quotidien, ordinaire, banal permet à Reza de bloquer la tension à son point d’ébullition et de la rendre gérable.
La vie, dans ce qu’elle a d’ordinaire, est le levier choisi par Reza pour garder les tensions à distance du drame. Quand monte le voltage entre Nathan et Alex au sujet d’Élisa, ex-maîtresse d’Alex et amoureuse de Nathan (Conversations après un enterrement), c’est la préparation tribale d’un pot-au-feu (avec tomates !) qui canalise et évacue le trop-plein. Lorsque les couples du Dieu du carnage planent dans leur hypocrite bienséance, c’est le téléphone qui ramène l’un des mâles à ses mensonges et crève la tromperie. Quand le lecteur se demande quel drame attend Adam Haberberg (Hommes qui ne savent pas être aimés), ce sont les compétences concrètes et sereines de Marie-Thérèse qui assainissent le dialogue : les gestes de la femme témoignent de sa transparence. Il n’y aura ni viol, ni meurtre. À la fois thème et frein, le geste quotidien, ordinaire, banal permet à Reza de bloquer la tension à son point d’ébullition et de la rendre gérable.
Roman, temps et climat social ont partie liée dans la production de Reza. D’expérience, l’auteure sait que le théâtre excelle à raconter le présent : L’avare ou Le bourgeois gentilhomme ignorent hier et demain parce qu’ils peignent des traits éternels. Par contre, Reza sait que le roman raconte surtout ce qui est inscrit dans l’Histoire et qui appartient au passé. Comment Reza n’aurait-elle pas glissé du théâtre au roman à mesure que s’affirmait en elle la conviction que sa société appartient à l’après, à la modernité et même à la postmodernité ? Le dieu du carnage recourait au théâtre pour ridiculiser les bien-pensants d’aujourd’hui ; mieux valait le roman pour forcer les hommes qui ne savent pas être aimés à réviser leurs aiguillages d’hier.
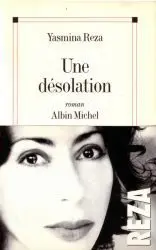 Ce n’est pourtant là qu’une des facettes du temps qui préoccupe Reza. Comme Sartre (La nausée) ou Camus (Le mythe de Sisyphe), Reza sait que le passage du temps règne en tyran sur le destin humain. Nul n’y échappe. Le défi sera pour l’homme de toujours demeurer en devenir, de rouler sa pierre malgré le déni du temps. « Si je n’étais pas en perpétuel devenir, dit le père d’Une désolation, il me faudrait alors lutter contre la mélancolie des achèvements. » Camus parlerait de révolte ; Reza sympathise avec lui, sans aller jusqu’à admettre qu’« il faut imaginer Sisyphe heureux ».
Ce n’est pourtant là qu’une des facettes du temps qui préoccupe Reza. Comme Sartre (La nausée) ou Camus (Le mythe de Sisyphe), Reza sait que le passage du temps règne en tyran sur le destin humain. Nul n’y échappe. Le défi sera pour l’homme de toujours demeurer en devenir, de rouler sa pierre malgré le déni du temps. « Si je n’étais pas en perpétuel devenir, dit le père d’Une désolation, il me faudrait alors lutter contre la mélancolie des achèvements. » Camus parlerait de révolte ; Reza sympathise avec lui, sans aller jusqu’à admettre qu’« il faut imaginer Sisyphe heureux ».
Pénétrante analyse
Plusieurs des questions qui m’ont dérouté pendant ces lectures trouvent réponse dans la superbe étude de Denis Guénoun, Avez-vous lu Reza ? (Albin Michel, 2005) ; sans lui, j’aurais raté l’essentiel. Grâce à lui, on apprend que le temps occupe une place centrale dans l’univers de Reza, pourquoi elle passe du théâtre au roman, à quelles fins elle bouscule les genres littéraires, comment elle traverse la modernité… Comme preuve de la magnifique justesse du regard de Guénoun, admirons ceci : dans son analyse publiée en 2005, il décode d’avance les livres écrits par Reza au cours de la décennie à venir !
Titres de Yasmina Reza évoqués dans l’article : Hammerklavier, Albin Michel, Paris, 1997, 135 p. ; Une désolation, Albin Michel, Paris, 1999, 160 p. ; Le dieu du carnage, Albin Michel, Paris, 2007, 128 p. ; L’aube le soir ou la nuit, Flammarion/Albin Michel, Paris, 2007, 192 p. ; Conversations après un enterrement, Albin Michel, Paris, 2009, 156 p. ; Hommes qui ne savent pas être aimés, Albin Michel, Paris, 2009, 208 p. ; Heureux les heureux, Flammarion, Paris, 2013, 190 p. et Folio, 2014, 192 p. ; Babylone, Flammarion, Paris, 2016, 224 p.
EXTRAITS
Oh ?! C’est vous ? Mais vous étiez très belle !… Oui, ma petite, c’était moi, et j’étais dans un temps que vous n’avez jamais vu et qui n’existe plus, très belle. Voilà le temps. La méchanceté du temps.
Hammerklavier, p. 24.
Il [Sarkozy] fait l’éloge de Zapatero et de son homologue Rubalcaba. Il parle aussi en termes chaleureux de Blair et Prodi. Je dis, c’est marrant que tu sois copain avec tous ces types de gauche. Il s’écrie, parce qu’ils ne sont pas de gauche ! Il n’y a qu’en France où les gens se vivent à gauche !
L’aube le soir ou la nuit, p. 99.
Car cette sensation de dislocation je l’éprouve dans mon existence même, comme si les éléments qui la composaient n’étaient plus liés entre eux, ni à un moi unique, comme si un de mes fragments pouvait à tout moment et n’importe où, partir à la dérive vers les lointaines périphéries où je suis perdu.
Hommes qui ne savent pas être aimés, p. 71.
Ici se fait jour, pour la première fois de façon patente, le dialogue complexe et conflictuel entre théâtre et roman, trait marquant de l’écriture qui suivra, et que Reza partage, sous une forme personnelle, avec à peu près tous les dramaturges d’aujourd’hui, et un grand nombre de romanciers.
Avez-vous lu Reza ? p. 89.
On chercherait en vain chez toi des traces d’impatience, d’intranquillité, tu dors j’imagine, tu dors bien, tu ne fais pas partie de ces errants du petit jour, mes amis, on chercherait en vain chez toi traces d’inutiles tourments, d’agitations incohérentes, en un mot d’inquiétude.
Une désolation, p. 13.











