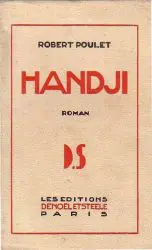Une image centrale traverse la vie et l’œuvre romanesque de Robert Poulet, un sentiment qu’il dit avoir éprouvé très jeune et de manière tout à fait concrète : la vie est un songe, tout n’est qu’illusion. Ce sentiment apparaît dans sa trilogie romanesque Les chemins de l’invisible : Handji, Les ténèbres et Prélude à l’apocalypse.
Robert Poulet naît le 4 septembre 1893 à Liège. L’histoire a surtout retenu qu’il fut un collaborateur sous l’Occupation, arrêté en 1944, jugé et condamné à mort. Il échappe de peu à son exécution avant de voir sa peine commuée en une détention de vingt ans. Au tiers de la peine, en mars 1951, Poulet est libéré et condamné à l’exil. Dans Ce n’est pas une vie, il relate en long et en large ses années de prison, les prémisses et les suites du procès. Poulet a toujours affirmé avoir travaillé uniquement pour le bien de la Belgique.
Le père, Georges Poulet, est un battant1 : après la faillite du grand-père, Georges abandonne les études et travaille dur pour rétablir la fortune familiale, puis, jeune retraité de 53 ans, il hante la maison familiale, imposant à ses enfants sa discipline et, à ses fils, les études supérieures auxquelles il avait dû lui-même renoncer. Robert Poulet entre ainsi au collège jésuite de Saint-Servais pour ensuite, à contrecœur, poursuivre des études de génie, un domaine pour lequel il n’éprouve absolument aucun intérêt.
À dix-sept ans, Poulet fait deux ridicules tentatives de suicide qu’il relate succinctement et sur lesquelles il ironise soixante ans plus tard dans Ce n’est pas une vie. Il se porte volontaire et participe activement à la Première Guerre mondiale, où il sera blessé puis décoré pour divers actes de bravoure. Après la guerre, il exerce différents métiers. Il achète une terre, fait faillite, puis tâte du cinéma, surtout comme scénariste. En 1916, Noémie Dhabit devient sa première femme. Elle meurt peu après. C’était une femme d’une classe sociale inférieure à la sienne, avec qui il semble s’être engagé sur un coup de tête et de manière à provoquer sa famille.
Politiquement, le jeune Poulet sympathise à gauche, puis vire vers la droite, voire l’extrême droite, dont il écrit : « On dit à gauche que refuser la politique équivaut à en faire de mauvaise, c’est-à-dire à se déclarer ‘de droite’. Alors, notons que je suis d’extrême droite, proche du point où les extrêmes se touchent. Et n’en parlons plus ».
Sa carrière au cinéma est de courte durée. Poulet se tourne vers l’écriture, encouragé par son jeune frère Georges (1902-1991), qui deviendra lui-même un éminent critique littéraire. Il se marie une seconde fois, en 1935, avec Germaine Bouillard, connue en 1932. Germaine a quinze ans de moins que lui. Ils auront une fille, Françoise, qui se suicide dans les années 1960.
Après une carrière journalistique importante, ponctuée de prises de position absolues, enthousiastes, Poulet avoue n’avoir pas compris grand-chose à la politique, à l’économie, au droit, sujets sur lesquels il avait pourtant été intarissable et enflammé.
Il meurt le 6 octobre 1989 à Marly-le-Roi, où il habitait depuis 1951. Germaine se suicide trois semaines plus tard.
Handji, chef-d’œuvre baroque
C’est en février 1931 que Denoël publie ce livre qui mijote depuis environ 1925. Si l’on devait ne retenir qu’un titre de toute l’œuvre, c’est celui-là, très certainement un des plus extraordinaires romans que j’aie lus. Assurément un des plus complexes aussi, formellement déroutant à bien des égards. Nous sommes à la guerre. Deux soldats font connaissance. Walter Orlando est médecin, issu de la bourgeoisie ; David Miszaliyn travaillait dans une parfumerie. Miszaliyn occupe un abri à proximité duquel il doit faire de rares et ennuyantes inspections. On le sent moralement fragile. Il est bientôt rejoint par Orlando, dont la fiancée est morte peu de temps avant, sans que cela l’émeuve outre mesure. Tous deux patientent loin du front, dans un secteur où il ne se passe strictement rien. Ils prennent ensemble leurs repas, bavardent et regrettent de n’avoir pas suffisamment de souvenirs solides, ni d’histoires d’amour ni d’aventures. « Sais-tu ce qu’il nous aurait fallu, dit Walter un soir, en arrangeant les lampes ? C’est le souvenir d’une femme. » C’est la fin de la première partie du roman, qui en compte trois. Un climat onirique-fantastique s’installe grâce à une narration qui efface la majorité des repères temporels. Walter va peu à peu réussir à faire entrer David dans un jeu où ils vont mutuellement se convaincre de la présence d’une jeune femme : « Pour occuper leur vie, ils supposaient qu’une compagne leur était donnée ». Petit à petit, ils se prennent littéralement à ce jeu et de manière on ne peut plus sérieuse, jusqu’à ce que, par la force d’évocation (aussi bien des deux soldats que du roman lui-même), cette jeune femme, Handji, vive réellement, c’est-à-dire aussi réellement que pour nous, lecteurs, Walter et David existent. À partir du milieu du roman, Handji s’anime et ses gestes, ses humeurs, une partie de ses pensées ne sont plus seulement rapportés par l’un ou l’autre personnage, mais contés par le narrateur. Handji devient le centre vital de leur existence. Les jours passent et le jeu se poursuit, les deux officiers (et le récit) se comportant comme s’il y avait vraiment une femme avec eux, une femme à qui ils ont concédé une partie importante de leur abri, question qu’elle y soit à l’aise, protégée des regards des éventuels visiteurs. Une ligne de conduite fait en sorte que les autres soldats n’en viennent pas à imaginer que David et Walter cachent réellement une femme avec eux. Ce tour de force narratif agace et enchante à la fois, parce qu’il bouleverse les habitudes de lecture, même celles d’un lecteur aguerri. À mi-chemin du livre, Handji subit donc une transformation qualitative qui la projette au rang de personnage au même titre que les autres, à cette différence fondamentale près qu’elle reste le produit de l’invention de David et de Walter, avant de s’émanciper. Un certain nombre de phrases absolument brillantes ponctuent habilement l’autonomisation de Handji, en inscrivant sa totale émancipation narrative. La suite nous fait vivre une permission de Walter, la sévère grippe qui affecte puis finit par emporter David et une partie des soldats, l’offensive ennemie et le bombardement final au cours duquel les soldats russes voient littéralement Handji sortir de l’abri pour la première et seule fois.
 C’est à travers une remarquable progression narrative, un choix judicieux de toutes petites phrases clés, intelligemment semées dans le récit, que nous assistons à la création de cette jeune Géorgienne. On est plus près de la prose poétique que d’un récit naturaliste, encore que le texte abonde en détails très terre à terre sur la vie dans les tranchées. Ce parti pris narratif place cette histoire un peu hors du temps et nous rappelle que la littérature elle-même se situe dans une temporalité simultanément incarnée et désincarnée.
C’est à travers une remarquable progression narrative, un choix judicieux de toutes petites phrases clés, intelligemment semées dans le récit, que nous assistons à la création de cette jeune Géorgienne. On est plus près de la prose poétique que d’un récit naturaliste, encore que le texte abonde en détails très terre à terre sur la vie dans les tranchées. Ce parti pris narratif place cette histoire un peu hors du temps et nous rappelle que la littérature elle-même se situe dans une temporalité simultanément incarnée et désincarnée.
Deux tables ferment le roman, l’une thématique, l’autre épisodique. Elles découpent chacune à sa manière le récit. Dans une excellente postface à la réédition, Benoît Denis les juge quelque peu artificielles, même s’il en reconnaît le rôle voulu par Poulet : « […] la ‘table thématique’ renvoie à une logique poétique et/ou symboliste encore active, tandis que la ‘table épisodique’ se soumet à la logique romanesque ou narrative », écrit Benoît Denis. Si Poulet s’écarte esthétiquement de l’écriture réaliste, il en respecte jusqu’à un certain point la cohérence et les codes narratifs.
Quelques clés nous donnent accès à ce récit exigeant ; chacune est légitime et l’ensemble crée un roman presque inépuisable.
La plus immédiate, à mon sens, c’est celle du récit comme métaphore du travail de l’écrivain, créateur de mondes et d’êtres qui lui survivront et qui ne lui appartiennent qu’à moitié. La mort nous a arraché Robert Poulet, mais ses personnages existent pour vrai chaque fois que je m’installe pour le lire.
Une autre clé consiste en l’absurdité de la guerre qui conduit soit à la destruction, soit à la folie. Une troisième joue sur la mince ligne entre la folie et la création, entre raison et délire. Benoît Denis suggère encore la sexualité entre les deux hommes, le jeu du désir par création interposée, d’un désir qui n’ose se dire et s’incarner autrement.
Esthétiquement, on pense à Nadja de Breton comme on peut penser à La route des Flandres de Claude Simon. Poulet travaille son fantastique dans un récit autrement naturaliste, une sorte de réalisme magique qui le distingue du surréalisme auquel il prétend échapper sans bien sûr le renverser tout à fait.
J’en suis convaincu, le caractère déroutant de ce roman irritera ou découragera beaucoup de lecteurs. Je l’écris sans mépris ni condescendance : bien peu de lecteurs sont en mesure de lire Handji, de goûter un texte d’une telle densité poétique ou lyrique, avec ses détours narratifs, ses enchaînements et ses enchantements retors. Oui, c’est un brin précieux. Il faut à cette prose un lecteur rodé et une lecture soutenue, attentive, réceptive et ouverte tout à la fois. Il lui faut de la disponibilité intelligente, une disposition de plus en plus rare de nos jours.
Les ténèbres ou la vie hors de soi
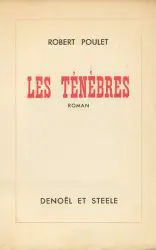 Ce récit de 1934 nous déroute également, roman délirant ou bien histoire d’un délire assumé, pour ainsi dire, dans la mesure où le personnage principal n’ignore pas ce qui lui arrive. Marcel Pantionis a 34 ans, il vit paisiblement avec ses deux sœurs, célibataires, comme lui, dans un appartement au-dessus de leur boutique, en parfait représentant du personnage anonyme, sans ambition et sans attentes. Un jour, une fulgurante illumination saisit Marcel au beau milieu d’une ruelle : le sens de son existence et tout ce que la vie lui réserve lui sont immédiatement révélés. Inquiet, craignant le symptôme d’une quelconque maladie, il rentre se mettre au lit. Ses sœurs le soignent ; quelques rares personnes lui rendent visite : un ami médecin, un prêtre et Mirette, la jeune fille d’une voisine. Marcel va tranquillement mourir et, parallèlement, se dédoubler pour se mettre à vivre d’une vie nouvelle et autrement plus animée. Dans cette autre vie que le récit nous donne alors à lire, Marcel se trouve bientôt impliqué dans un événement dont la nature lui échappe : est-ce le début d’une révolution sociale, d’une guerre, d’une longue marche vers une Terre promise ? Marcel ne le comprend pas bien.
Ce récit de 1934 nous déroute également, roman délirant ou bien histoire d’un délire assumé, pour ainsi dire, dans la mesure où le personnage principal n’ignore pas ce qui lui arrive. Marcel Pantionis a 34 ans, il vit paisiblement avec ses deux sœurs, célibataires, comme lui, dans un appartement au-dessus de leur boutique, en parfait représentant du personnage anonyme, sans ambition et sans attentes. Un jour, une fulgurante illumination saisit Marcel au beau milieu d’une ruelle : le sens de son existence et tout ce que la vie lui réserve lui sont immédiatement révélés. Inquiet, craignant le symptôme d’une quelconque maladie, il rentre se mettre au lit. Ses sœurs le soignent ; quelques rares personnes lui rendent visite : un ami médecin, un prêtre et Mirette, la jeune fille d’une voisine. Marcel va tranquillement mourir et, parallèlement, se dédoubler pour se mettre à vivre d’une vie nouvelle et autrement plus animée. Dans cette autre vie que le récit nous donne alors à lire, Marcel se trouve bientôt impliqué dans un événement dont la nature lui échappe : est-ce le début d’une révolution sociale, d’une guerre, d’une longue marche vers une Terre promise ? Marcel ne le comprend pas bien.
Grosso modo, le roman se divise en deux parties : Marcel chez lui, au lit, dans sa chambre, puis dehors, dans la ville. Même si ce moribond, dans les « faits », ne va jamais quitter son lit. Comme dans Handji, le tout se déroule dans un climat onirique, voisin du surréalisme. Un peu comme le Marcel de Proust (dont on notera qu’il partage les initiales, M. P.), Pantionis rassemble autour de lui et en lui toute sa vie en quelques éléments qu’il juge importants, mais dont l’exacte signification lui échappe, comme elle nous échappe, à nous, lecteurs. Je donne au hasard : un crachoir, la poitrine de sa sœur Isabelle, une mélodie de Saint-Saëns, son propre foie et son gros intestin, dont il surveille l’état, etc.
La quête du personnage, c’est celle du sens de sa vie. On pourrait encore mettre en parallèle ce roman et Handji en observant que dans ce dernier, le personnage s’incarne graduellement, alors que dans Les ténèbres, Pantionis se désincarne, quitte progressivement son enveloppe charnelle. Tous deux n’en continuent pas moins de « vivre » dans l’univers du récit.
Le lecteur audacieux en fera l’expérience déconcertante : l’œuvre romanesque de Poulet interroge les liens fragiles que chacun tisse entre son quotidien le plus immédiat et une dimension de l’existence où logent le rêve, la littérature et la possibilité d’une transcendance.
1. Un battant, quelqu’un qui ne se laisse jamais abattre. On ne le confondra pas avec l’autre Georges, le jeune frère de Robert.
Principaux titres de Robert Poulet :
Handji, roman, Denoël et Steele, 1931, Plon, 1955 (version revue par l’auteur), Espace Nord, postface de Benoît Denis, 2014 ; Le trottoir, roman, Denoël et Steele, 1931 ; Le meilleur et le pire, roman, Denoël et Steele, 1932 ; La révolution est à droite, pamphlet, Denoël et Steele, 1934 ; Les ténèbres, roman, Denoël et Steele, 1934, Plon, 1958 (version revue par l’auteur) ; L’ange et les dieux, roman, La Toison d’or, 1942 ; Prélude à l’apocalypse, roman, Denoël, 1944, L’Âge d’homme, 1981 (version revue par l’auteur) ; Journal d’un condamné à mort, Essai sur la mystique, la volupté et le péril de la mort, La jeune Parque, 1948 ; Entretiens familiers avec Louis-Ferdinand Céline, suivi d’un chapitre inédit de Casse-Pipe, Plon, 1958, 1971 ; Contre l’amour, essai, Denoël, 1961 ; Contre la jeunesse, essai, Denoël, 1963 ; Contre la plèbe, essai, Denoël, 1967 ; Contre l’auto, essai, Berger-Levrault, 1967 ; Histoire de l’Être, roman, Denoël, 1973 ; Ce n’est pas une vie, mémoires, Denoël, 1976 ; J’accuse la bourgeoisie, essai, Copernic, 1978 ; La conjecture, Mémoires apocryphes, La Table ronde, 1981.
EXTRAITS
Le miroir lui rejetait une image qui s’ajoutait à elle, la recouvrait d’un supplément de réalité : de reflet en reflet, elle croyait se gonfler, comme fait la pensée d’une femme attentive, mais par l’extérieur ; sa vie se répandait dans des couches nouvelles, son sang accomplissait de plus grandes distances. Il se fit en elle un désordre, comme une chapelle d’où s’échappe un jeune garçon malade ; sa gorge se mit en mouvement : « Je vais parler » […]. Enfin !… Elle soupira d’aise, de se sentir vivante, d’exprimer une volonté.
Handji, Espace Nord, p. 204.
Je m’imaginais qu’on pouvait encore, en plein XXe siècle, conjurer les malheurs dans lesquels notre espèce a décidé de se précipiter. Faire de la politique, c’est s’insinuer, avec des vues et des plans, dans une avalanche. Au mieux, on y peut gagner cinq centimètres dans le bon sens tandis qu’avec la masse on avance de cent mètres dans le mauvais. Toutes les entreprises qui, aujourd’hui, se donneront pour fin de « guider la marche » d’une société humaine, quelle qu’elle soit, finiront dans l’abîme. Le plus profond, c’est le gouffre du bonheur collectif, accompagné d’une dégradation de la conscience.
Ce n’est pas une vie, Denoël, p. 51.
À chacun sa préoccupation dominante. La mienne, c’est de pouvoir, sans rougir, me regarder dans la glace. Je n’y ai pas toujours réussi.
Ce n’est pas une vie, Denoël, p. 66.
En un mot : je ne crois plus en l’homme. Selon moi il a gâché son affaire, avant de se noyer dans cette essence toute différente qui s’appelle : les hommes. Je ne fais pas partie de cette espèce.
Ce n’est pas une vie, Denoël, p. 134-135.
En tout cas, ma vie me plaît, quoique semée de fautes et de bévues dont le souvenir, quand il s’éveille en moi, me fait gémir comme un caniche dont on écrase la patte.
Ce n’est pas une vie, Denoël, p. 252.