L’humanité traîne dans son sillage des crimes qui ne sauraient être effacés. S’ils peuvent au mieux cicatriser avec le temps, ils demeurent impardonnables. L’esclavage en est un. Les temps présents ne sont pas exempts de ces crimes, faut-il le préciser.
Entre race et sexe
Entre l’arbre et l’écorce, les intellectuelles afro-américaines expérimentent un vrai et, on l’imagine, douloureux écartèlement entre les biais sexistes des universités ou des organisations politiques noires et les biais racistes des mêmes universités et des organisations féministes blanches. Si on ne peut comprendre cette réalité dans notre chair, faute de l’avoir vécue, nous l’admettons d’emblée, tant il est vrai que les grands systèmes d’oppression partagent des stratégies communes et engendrent des traumas similaires. En bref, un choix déchirant s’offre à nos voisines noires du Sud : prendre parti contre soi, entre sa race ou son sexe. Une parfaite quadrature du cercle.
La sociologue et professeure émérite Patricia Hill Collins, dans La pensée féministe noire1 – paru en anglais en 1990 et revu en 2009 – se propose de dépister, de déplier, puis d’éclairer les expériences et les idées des femmes noires là où elles se trouvent aux États-Unis, pour ensuite les interpréter. Sur le fil du rasoir, dans un monde en constant changement, l’essayiste poursuit l’objectif d’outiller ses sœurs noires, et ainsi de leur permettre de résister à la double tutelle, blanche et mâle. Davantage encore, de les encourager à le faire. Hill Collins soutient que la pensée féministe noire n’est pas un savoir naïf mais « s’est vu attribuer un tel statut par ceux qui contrôlent les procédures de validation du savoir ». Dans cette perspective, elle défend avec vigueur l’hétérogénéité des intellectuelles noires composées aussi bien d’universitaires que de femmes issues d’un milieu populaire.
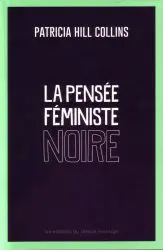 Explorant deux oppressions politiques, l’une raciale l’autre sexuelle, Hill Collins démontre combien un conflit de loyauté, vécu parfois de façon aiguë, retarde, voire paralyse l’avancée des femmes noires. Quand ils devinrent libres, les hommes noirs ont pris la pleine mesure du traitement des femmes sous l’esclavage et ont investi une grande part de leur énergie à les protéger des abus tant économiques que sexuels. Dès lors, il serait apparu un des nœuds gordiens des rapports amoureux entre hommes et femmes noirs. Les hommes protègent les femmes, en un mouvement qui définit leur masculinité, laquelle exige sa contrepartie, l’acceptation de cette protection. De la protection au contrôle, il n’y avait qu’un pas à franchir. Au croisement de ces deux oppressions et de leurs effets exponentiels, s’ajoute d’évidence le poids de la classe sociale et de l’orientation sexuelle.
Explorant deux oppressions politiques, l’une raciale l’autre sexuelle, Hill Collins démontre combien un conflit de loyauté, vécu parfois de façon aiguë, retarde, voire paralyse l’avancée des femmes noires. Quand ils devinrent libres, les hommes noirs ont pris la pleine mesure du traitement des femmes sous l’esclavage et ont investi une grande part de leur énergie à les protéger des abus tant économiques que sexuels. Dès lors, il serait apparu un des nœuds gordiens des rapports amoureux entre hommes et femmes noirs. Les hommes protègent les femmes, en un mouvement qui définit leur masculinité, laquelle exige sa contrepartie, l’acceptation de cette protection. De la protection au contrôle, il n’y avait qu’un pas à franchir. Au croisement de ces deux oppressions et de leurs effets exponentiels, s’ajoute d’évidence le poids de la classe sociale et de l’orientation sexuelle.
La couleur la moins américaine
Plus la peau est noire, plus les risques d’exploitation et de discrimination sont élevés aux États-Unis. En 2014, les femmes ont gagné 79 % du salaire des hommes. Même en tenant compte du type de travail, du diplôme et de l’âge, l’écart demeure substantiel. La pyramide du travail se construit ainsi : au sommet les hommes blancs, puis en descendant les hommes noirs avant les femmes blanches et en queue de peloton les femmes noires.
Dans la démonstration de Hill Collins, cette pyramide sexo-raciale trouve son pendant dans la structure de l’offre et de la demande amoureuse, laquelle accorde une plus-value marchande à la féminité blanche. « Nous sommes le groupe de femmes le plus éloigné des notions de beauté et de féminité qui règnent partout sur la planète… » (citant Gloria Wade-Gayles) Aveu douloureux, et joli paradoxe dont ne fait nulle mention l’essayiste, mais qui s’impose si nous réfléchissons aux multiples emprunts blancs à la beauté noire tels le bronzage de la peau, le blanchiment des dents, le gonflement des lèvres ou le crêpage des cheveux. Il devient impératif, argue-t-elle, de renverser l’idéal de la beauté blanche chez celles qui possèdent des traits afro-américains, ce que s’emploie d’ailleurs à dessiner à l’aide de sa riche palette artistique Toni Morrison dans son plus récent roman, Délivrances.
Après avoir bien circonscrit le socle sur lequel reposent les thématiques, les grilles d’analyse, l’approche épistémologique de la pensée féministe noire, l’auteure examine les thèmes du travail et de la famille, de la maternité et du militantisme, de la quête amoureuse et de la sexualité en appuyant son propos ample et documenté autant sur la recherche universitaire que sur la culture populaire, la littérature, la musique ou divers témoignages. Par exemple, elle dissèque avec brio la gravité du crime de lèse-solidarité raciale et sa punition ; elle met en exergue le litige survenu au cours du processus de nomination du Noir Clarence Thomas au poste de juge à la Cour suprême, alors que l’avocate noire Anita Hill accuse ce dernier de harcèlement sexuel. Son témoignage n’empêchera pas Thomas d’accéder à la Cour suprême en 1991, non plus que les dénonciations accablantes envers Donald Trump ne lui ont barré le chemin de la Maison-Blanche en 2017.
Il est regrettable que la lecture de l’ouvrage soit plombée par cette manie de traduire littéralement les mots et les concepts étatsuniens (l’agentivité, la blanchité, les femmes racisées, l’approche altérisée, le point de vue situé, etc.) plutôt que de les convertir en des termes conformes à l’esprit de la langue française, cela sans compter les mots laissés inchangés (outsider/within et autres empowerment), et que nous devons comprendre comme l’abusif nivellement par l’anglais.
Cent milliards d’humains, une seule espèce
Cent milliards d’êtres humains sont venus à ce jour sur notre Terre (cf. le paléontologue Yves Coppens), et selon le consensus scientifique actuel, il n’existe que l’espèce humaine. Aucune race. Le délit de faciès serait donc une architecture sociale fondée sur la différence pour mieux asservir, de même que l’est le délit du bon appareil génital. La mère de la célèbre Alice Walker (La couleur pourpre, Prix Pulitzer 1983), devant le désir idéaliste de sa fille d’unir dans une même histoire celles des personnes noires et des personnes blanches, lui objectait : « [Les Blancs] se sont assis sur la vérité depuis tellement longtemps qu’ils en ont extirpé la vie ». Ce regard sagace se retourne comme un gant si on le pose sur la vérité masculine.
En fait, qu’elle soit noire ou blanche, la mécanique complexe, souvent sournoise, des rapports de domination entre hommes et femmes se révèle être d’une souche héréditaire apparentée. Quelle que soit la nature des problèmes cruciaux que les Afro-Américaines affrontent – les violences sexuées, la pauvreté endémique, la misogynie sous toutes ses formes, la surdité des hommes quand elles s’expriment, les nécessaires compromis –, leur chemin est semblable à celui des Nord-Américaines blanches. À une distinction près que ce chemin est plus accidenté et par là plus complexe à appréhender, qu’il y est plus difficile de s’y mouvoir et de repérer des avenues de liberté. On cherche en vain dans le champ de cet essai très fouillé une question, une seule parmi celles analysées qui appartienne sui generis aux femmes noires. De trop vouloir trier, classer ou sérier, la division, l’éclatement même sont à craindre. Qu’en bout de piste, plus personne ne s’entende sur les actions à mener pour combattre ces systèmes oppressifs, à la vive satisfaction de leurs défenseurs il va sans dire.
Les cieux étatsuniens se sont illuminés avec le XXIe siècle, malgré le récent ennuagement spectaculaire. Huit années de présidence noire à la tête du pays, présidence renforcée par l’énergie et le souffle d’un couple exemplaire, ont rendu force et fierté à la nation noire des États-Unis. Et, si petites soient-elles face à l’immensité du servage des Noirs, de-ci de-là se faufilent des réparations historiques, tel le Musée national de l’histoire et de la culture afro-américaine nouvellement inauguré à Washington, haut lieu de légitimation où se lit l’étonnement sur les visages des hommes et des femmes de la « race maudite » qui le visitent. En tant que Blanche minoritaire (nous n’étions guère plus de dix pour cent lors de ma visite), j’ai refusé l’inutile culpabilité, et j’ai ainsi pu éprouver de la joie à voir, à presque toucher cette fierté mêlée de douleur.
Qu’en conclure ? La pensée féministe noire renforce l’idée que les femmes noires doivent coûte que coûte définir leur existence, acquérir leur propre savoir, maîtriser leur destin, loin des arrêtés des Blanches, et nous y fait adhérer à tous égards. On déplore toutefois que ne soient pas identifiés les sujets de convergence entre femmes noires et blanches, et que ne soient pas définis des lieux communs de sororité, ce sisterhood si puissant des années 1970 et 1980. En 1893, l’écrivaine et activiste Anna Julia Haywood Cooper, citée par Hill Collins, ne s’y trompait pas : « La femme de couleur pense que la cause des femmes est une et universelle ». Nancy White, une femme noire âgée, issue d’un milieu populaire, lui fait aujourd’hui écho : « Ma mère avait l’habitude de dire que la femme noire est la mule de l’homme blanc et que la femme blanche est son chien ». Les temps changent, et des voix en appellent à revenir à ce sens commun. Ainsi Fatou Diome, femme de lettres franco-sénégalaise, ne sourcille pas en affirmant que nous sommes tous venus d’ailleurs et infère de cette déclaration que nous devons nous libérer du passé, mais non de l’Histoire. Sa voix s’entend-elle chez nos voisines du Sud : « À un moment, il faut pacifier les mémoires, et arrêter de toujours se référer à l’esclavage et à la colonisation » ?
1. Patricia Hill Collins, La pensée féministe noire, trad. de l’anglais par Diane Lamoureux, Remue-ménage, Montréal, 2016, 479 p. ; 37,95 $
EXTRAITS
En considérant que la pensée féministe noire s’insère actuellement dans un contexte intellectuel et politique plus vaste qui remet en cause jusqu’à son droit à l’existence, j’ai choisi de ne pas insister sur ses contradictions, ses frictions internes et ses incohérences.
p. 21
L’adhésion à un éthos masculin, qui a trop souvent fait rimer le progrès racial avec l’acquisition d’une masculinité plus ou moins bien définie, a fait en sorte qu’une bonne partie de la pensée noire étatsunienne est marquée d’un biais sexiste évident.
p. 43
[…] tous les systèmes d’oppression mobilisent le pouvoir de l’érotisme.
p.216
À la base du déni de la brutalité sexiste […], il y a notre refus profond et douloureux d’accepter le fait que nous ne descendons pas seulement des esclaves, mais également des propriétaires d’esclaves.
Propos d’Alice Walker, relatés à la p. 257
Par son existence même, la pensée féministe noire indique qu’il y a toujours un choix et un pouvoir d’agir, peu importe à quel point la situation peut sembler sombre.
p. 437











