Les œuvres de Haruki Murakami sont traduites dans une cinquantaine de langues et se sont vendues à des millions d’exemplaires. Lui-même traducteur d’une panoplie de grands écrivains américains, de John Irving à Ursula K. Le Guin, Murakami est l’un des romanciers japonais les plus lus sur la planète. Mais où puise-t-il l’inspiration pour une œuvre aussi abondante et créative ?
Lui-même reconnaîtrait Raymond Carver, Kurt Vonnegut, voire Richard Brautigan et Raymond Chandler parmi ses influences. Mais on sent qu’il a lu beaucoup, de classiques notamment, et on évoque parfois Fitzgerald, Kafka, puis carrément Flaubert, Dostoïevski. Et à bien chercher, on trouverait de tout : dans Les amants du Spoutnik, le narrateur lit Conrad, un autre personnage se passionne pour Kérouac ; dans 1Q84, on s’interroge sur le rôle de l’objet avec Tchékhov, puis sur le temps avec Proust. On rapproche parfois Murakami du postmodernisme ; les libraires le classent au rayon « littérature », et certains amateurs n’hésiteraient pas à le ranger plutôt du côté « fantastique ». Pas facile.
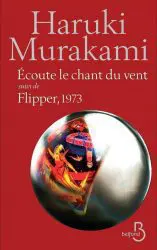 Or, après 37 ans, Murakami autorise enfin la réédition de ses deux premiers romans, Écoute le chant du vent et Flipper, 1973, inédits et rassemblés en français sous une même jaquette chez Belfond1. Ces textes nous mettent sur une nouvelle piste : et si Murakami le littéraire s’était en fait grandement inspiré du maître de l’horreur, Howard Phillips Lovecraft ?
Or, après 37 ans, Murakami autorise enfin la réédition de ses deux premiers romans, Écoute le chant du vent et Flipper, 1973, inédits et rassemblés en français sous une même jaquette chez Belfond1. Ces textes nous mettent sur une nouvelle piste : et si Murakami le littéraire s’était en fait grandement inspiré du maître de l’horreur, Howard Phillips Lovecraft ?
En lisant Derek Hartfield
Dans Écoute le chant du vent, le narrateur admire l’écrivain Derek Hartfield. On le cite abondamment et le titre même du roman évoque une nouvelle de Hartfield (même s’il aurait été inspiré par la dernière phrase d’un texte de Truman Capote). À l’époque, il n’y avait pas de Web où l’on pouvait tout vérifier : nombreux furent les lecteurs japonais qui, ignorant que Derek Hartfield était un écrivain fictif, en demandèrent les œuvres à leur libraire. C’est dire ! Or, et c’est là le point de départ de notre enquête, la vie de Hartfield fait sans conteste penser à celle de Lovecraft, ou plus précisément, à un mélange du créateur du mythe de Cthulhu et de Robert E. Howard, l’un des pères de la fantasy moderne, créateur de Conan le Barbare.
Le suicide d’Hartfield évoque celui de Robert E. Howard, certes, mais il y a autre chose, et Lovecraft n’est jamais loin. La relation avec leur mère. Leur naissance dans une petite ville américaine. Leurs thèmes de prédilection. Le fait qu’ils soient tous deux de prolifiques icônes de la pulp fiction. L’énergie, l’ambiance qui se dégagent globalement du portrait qu’on en peint…
Or, tout comme il y a partout dans l’œuvre de Murakami une porosité entre les mondes – entre l’onirisme et le réel –, elle est parfois floue la ligne qui sépare l’auteur du protagoniste-narrateur. Et ce dernier semble dire que le jour où son oncle lui a offert un livre de Hartfield, truffé d’histoires de monstres et d’extraterrestres, sa vie a basculé ; c’est à partir de ce moment qu’elle est devenue littéraire.
Les phases et les thèmes lovecraftiens
Dans la correspondance de H. P. Lovecraft, on trouve cette touchante remarque : « J’ai eu ma période Poe, ma période Lord Dunsany, mais, hélas, à quand ma période Lovecraft ? »
Certains critiques distinguent en tout cas trois grandes phases dans son œuvre : les « histoires macabres » (≈1905-1920), le « cycle onirique » (≈1920-1927) et le « Mythe » (≈1927-1935).
L’onirisme, disions-nous, de même qu’un jeu de miroirs entre différents niveaux de conscience, font ritournelle dans l’œuvre de Murakami.
En outre, les deux auteurs ont en commun plusieurs thèmes de prédilection : la santé mentale, la civilisation menacée, les risques de l’ère scientifique, voire une certaine critique de la société capitaliste. La solitude, aussi.
Murakami avoue s’être souvent senti seul dans sa jeunesse ; il se liait alors d’amitié avec des chats. Ces réconfortantes petites bêtes sont omniprésentes dans son œuvre (pensons au point de départ de la quête du narrateur dans Chroniques de l’oiseau à ressort et de celle de Nakata dans Kafka sur le rivage). Or, Derek Hartfield aussi les aimait tendrement, tout comme Lovecraft (« On raconte que dans Ulthar, de l’autre côté de la rivière Skaï, aucun homme n’a droit de tuer un chat… », ainsi s’ouvre The Cats of Ulthar). Il semblerait même que le grand artisan de Providence (Rhode Island) se soit disputé avec le père de Conan à ce sujet : Robert préférait les chiens !
Solitudes partagées : d’autres pistes
On pourrait parler des puits, troublants et récurrents dans l’œuvre de Murakami.
On pourrait recenser ses évocations des fictions populaires américaines de la première moitié du XXe siècle, comme le magazine Weird Tales des années 1930. D’ailleurs, selon un article du Miami Herald paru en 2014, Murakami aurait toujours été un lecteur assidu de science-fiction et aurait « tout lu H. P. Lovecraft et Robert E. Howard ».
On pourrait analyser une assertion comme quoi, dans les romans du Rat, « il n’y a jamais de scène de sexe et aucun de ses personnages ne meurt ». Le Rat est le personnage ayant donné son nom au cycle entamé par Écoute le chant du vent, que suivent Flipper, 1973 et La course au mouton sauvage. Il écrit des romans et ce qu’on en dit ne s’applique pas à ceux de Murakami, où la mort et la sexualité sont bien présentes ; peut-être, à vraiment vouloir, peut-on y voir un hommage discret à Lovecraft. Il paraît que la sexualité était un sujet qui mettait ce dernier mal à l’aise. En outre, les gens meurent moins qu’on ose le croire dans ses histoires. Nombreuses sont les nouvelles où Lovecraft, plutôt que d’assassiner franchement ses personnages avec un coup d’épée à la Conan, les fait basculer : ils perdent la tête à la vue d’horreurs inintelligibles et c’est après le point final que les choses se passent.
On pourrait remarquer que les protagonistes de l’un comme de l’autre ne sont pas des gros bras (contrairement au célèbre héros de Robert E. Howard), mais souvent des intellos qui se passionnent pour les mythes. Chez Lovecraft, ce sont régulièrement des chercheurs, des érudits. Chez Murakami, on ne compte plus les personnages qui ont l’air simples ou prétendent l’être (une humilité bien japonaise, oserions-nous dire ?), mais qui font tout à coup référence à la culture humaine, aux archétypes, et nous laissent comprendre qu’ils lisent considérablement.
On pourrait encore évoquer le talent qu’ont en commun Lovecraft et Murakami pour gratter jusqu’aux tréfonds de notre conscience et réveiller des peurs ancestrales, pour dévoiler des passages insoupçonnés entre les univers et mettre en scène de terribles « forces étranges » qui couvent derrière le carrelage du quotidien.
Mais plutôt que de chercher des évocations de présence extraterrestre dans les textes de l’auteur japonais, il nous semble que ce qui relie davantage ses œuvres à celles de Lovecraft, c’est la solitude et « l’ennui fondamental » qui animent leurs héros. Les uns sont plus passifs que les autres, mais nombre d’entre eux baignent dans une sorte de torpeur que la vie (ou ce que nous pourrions appeler un « autre monde ») viendra secouer avec plus ou moins de succès. Même les plus agités des protagonistes de Lovecraft nous donnent parfois l’impression qu’ils portent sur leur existence un regard insatisfait.
Cosmos et quotidienneté : des différences
Si les similitudes entre les deux œuvres abondent, il y a aussi des différences considérables.
De format : préférence pour les nouvelles courtes chez Lovecraft, abondance de romans longs chez Murakami. D’échelle aussi : on passe du cosmos au quotidien (encore qu’on peut penser à l’analogie doigt qui pointe/Lune).
Prises dans leur ensemble, leurs œuvres sont toutes deux cohérentes, mais c’est plus thématique dans un cas et plus éclaté dans l’autre. Ils ont des styles, des rythmes bien différents. Les références sont souvent plus variées et résolument plus modernes chez Murakami. Et ce dernier se montre bien meilleur dialoguiste.
L’affaire, avec les classiques : en guise de conclusion
« Si je n’avais pas rencontré l’écrivain Derek Hartfield », avoue le narrateur d’Écoute le chant du vent, « je n’aurais sans doute pas eu l’idée d’écrire de romans. Et j’aurais sûrement emprunté un tout autre chemin ».
Pourquoi Murakami ne parle-t-il pas ouvertement de Lovecraft ? Peut-être qu’aux côtés des Salinger et Fitzgerald qu’il a traduits, l’auteur de Dagon ne fait pas bonne figure. Chandler, Vonnegut ont produit des littératures dites « de genre », mais ont depuis été hissés au panthéon des icônes littéraires ; Lovecraft fait encore largement l’objet d’un culte plus ou moins obscur.
Enfin. C’est la belle affaire, avec les classiques. Pensez « pirate », il vous vient aussitôt en tête un gaillard, une béquille et un perroquet : vous voyez Long John Silver, et ce, même si vous n’avez jamais lu L’Île au trésor de Stevenson. Prononcez « Mississippi », il se peut que vous imaginiez un enfant sur un radeau de fortune, avec un vieux banjo, un brin d’herbe dans la bouche, et peut-être même un ami esclave noir en fuite – sans penser remercier Mark Twain. Ce n’est pas qu’une affaire de « clichés » : c’est la force invisible de ces images qui ont ému les générations. Les classiques infusent dans notre conscience, à notre insu, et façonnent notre perception du réel – cette seule proposition aurait pu être placée dans la bouche d’un personnage de Murakami, et a certainement stimulé Lovecraft en son temps.
Que le premier ait lu le second ne fait pas de doute. Qu’il s’en soit inspiré consciemment ou non, directement ou non, qu’importe ? Établir des parallèles, n’est-ce pas un des grands plaisirs de la lecture, d’autant plus avec des auteurs prolifiques qui multiplient les faux-semblants ?
1. Haruki Murakami, Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973, trad. du japonais par Hélène Morita, Belfond, Paris, 2016, 300 p. ; 26,95 $.
EXTRAITS
Pour moi aussi, c’était une saison de solitude. De retour chez moi, chaque fois que je me déshabillais, j’avais l’impression que tous mes os allaient jaillir à travers ma peau. C’était comme si, à l’intérieur de moi, une force inconnue, énigmatique, me poussait dans une mauvaise direction pour m’entraîner dans un autre monde.
Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973, p. 210.
Il y a des jours où certaines choses s’emparent de nous. Des petits riens, des choses sans importance. Un bouton de rose, un chapeau égaré, un pull qu’on aimait, enfant, un vieux disque de Gene Pitney… On pourrait dresser une liste impressionnante de toutes ces choses modestes qui n’ont plus nulle part où aller. Elles errent en nous durant deux ou trois jours puis retournent d’où elles sont venues… dans les ténèbres. Nous creusons toujours des puits dans notre esprit. Et, au-dessus de ces puits, vont et viennent des oiseaux.
Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973, p. 257.
Pendant son adolescence, fort mélancolique, Hartfield n’eut pas le moindre ami ; tout son temps libre, il le passait à lire des bandes dessinées ou des magazines populaires, des histoires de détectives ou de science-fiction, et à dévorer les cookies de sa mère. […] Il y a beaucoup de choses que Derek Hartfield a détestées. La poste, le lycée, les éditeurs, les carottes, les femmes, les chiens… On n’en finirait pas de tout énumérer. Mais il n’y a que trois choses qu’il a aimées : les armes, les chats et les cookies de sa mère.
Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973, p. 146-147.
Il s’avança à pas de loup jusqu’à la porte de la chambre, l’ouvrit tout doucement, alluma la lampe de poche, dirigea aussitôt le faisceau vers le cadavre du vieil homme. C’est de là que provenait, sans aucun doute possible, l’étrange bruit de frottement. La lumière éclaira une chose blanche, longue et fine, dont la forme faisait penser à une calebasse, qui sortait en ondulant de [sa] bouche.
Kafka sur le rivage, 10/18, p. 617.
Éri Assaï continue de dormir.
Mais l’homme-sans-visage qui, tout à l’heure, assis sur une chaise, observait Éri, cet homme a disparu. La chaise aussi. Sans laisser de traces. Pour cette raison, la pièce, davantage encore qu’auparavant, est silencieuse et déserte. À peu près au centre, le lit, sur lequel est allongée Éri. On dirait quelqu’un qui dérive seul sur une mer calme dans un canot de sauvetage. Nous, de notre côté, dans la chambre réelle d’Éri, nous observons cette scène à travers l’écran de la télévision.
Le passage de la nuit, 10/18, p. 121.
S’il vous arrivait d’apercevoir des TV People, vous ne remarqueriez peut-être pas d’emblée leur petite taille. Mais ils vous laisseraient probablement comme une étrange impression. Irais-je jusqu’à dire : un certain malaise ? Vous vous diriez sûrement qu’il y a là quelque chose d’incongru. Puis vous les considéreriez à nouveau. Au premier coup d’œil, pourtant, tout est naturel, et ça l’est donc d’autant moins : car la petitesse des TV People diffère totalement de celle des enfants ou des nains.
« TV People », L’éléphant s’évapore, 10/18, p. 242-243.











