Dramaturge franco-manitobain à la langue explosive et colorée, Marc Prescott est l’une des plumes les plus mordantes, les plus cocasses, les plus ingénieuses de la scène théâtrale canadienne-française.
Auteur, metteur en scène, traducteur, adaptateur, Prescott a, outre quelques œuvres majeures (toutes publiées aux éditions du Blé), écrit de nombreuses pièces brèves dans lesquelles une seule scène peut faire toute une histoire1. Il y a aussi de la provocation chez cet écrivain qui se dit « franco-bilingue », qui aime exacerber les situations et entrelacer dans une seule trame la réalité la plus crue et une fabulation absurde, qui nage entre le désopilant et l’inquiétant, comme dans Bullshit, une pièce créée par le Cercle Molière de Saint-Boniface en 2001. La question identitaire est inévitablement centrale dans ses pièces, ne serait-ce que par le « franglais » des personnages, posture linguistique fatalement agressive mais aussi porteuse d’une charge émotive saisissante.
Il y a trois petits chefs-d’œuvre de langage dramaturgique chez Prescott : Sex, lies et les Franco-Manitobains, L’année du Big-Mac et Encore. La pièce Fort Mac, créée en 2007, est de moindre calibre.
La présomptueuse légèreté de l’être bilingue

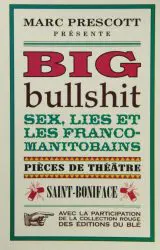 Prescott frappe fort avec sa première pièce, Sex, lies et les Franco-Manitobains, créée au Collège universitaire de Saint-Boniface2 en 1993. La veille de Noël, un voleur s’est infiltré chez une jeune francophone, enseignante de français dans une école d’immersion et engagée dans le milieu culturel franco-manitobain. Elle l’a frappé avec un poêlon, puis l’a attaché sur une chaise en attendant en vain l’arrivée de la police ; celle-ci ne l’a pas prise au sérieux avec son français trop énergique. Mais ce voleur n’est pas méchant, seulement un peu paumé et un peu trop pauvre, et surtout assez bavard. Elle a beau vouloir ne pas l’écouter et se taire, elle ne peut s’empêcher de réagir à ses propos, de s’indigner de la langue bâtarde par laquelle il l’interpelle. Car il s’exprime aussi mal qu’elle parle bien et, dans sa langue colorée et vulgaire, ponctuée de jurons, de solécismes et d’anglicismes, il ne cesse de discuter ses idées, d’attaquer ses convictions, de se moquer tout en la provoquant. Le clou de la pièce survient lorsqu’il met en doute sa fierté de la langue française et prétend que le français est mort, parce que l’élite francophone est repliée sur elle-même et cherche à préserver une culture et une histoire folklorisées qui l’empêchent d’évoluer et de s’ouvrir aux autres. Elle a beau riposter, elle n’est guère convaincante, inévitablement, Prescott ayant choisi d’épouser le point de vue du voleur, de provoquer, de scandaliser. « Va expliquer ça à un Africain que pour être un bon Franco-Manitobain, y faudrait qu’y s’identifie à l’histoire d’une pognée de gens pognés. » Évidemment, dit comme ça, par la lorgnette du multiculturalisme bien-pensant, l’argument décoiffe la pauvre fille. Dans cette société francophone profondément vulnérable, Prescott ne contextualise la question de l’assimilation que pour mieux la dédramatiser, idéalement la dépasser. Difficile ici de faire la part des choses entre l’auteur et son personnage, lequel est cependant trop sympathique pour ne pas être un peu suspect ; et la fin de la pièce, où la fille tombe dans les bras de son voleur, se colore d’une certaine désinvolture légèrement insolente. Un regard plus scrupuleux sur cette pièce qui fait semblant de ne pas vouloir être prise au sérieux conduira le lecteur à se demander si, finalement, ce que ce pseudo voleur va lui prendre, à cette fille trop inexpérimentée, ce n’est pas son identité plutôt que sa virginité (eh oui ! car elle est vierge en plus). Mais qu’est-ce que l’identité, justement ?
Prescott frappe fort avec sa première pièce, Sex, lies et les Franco-Manitobains, créée au Collège universitaire de Saint-Boniface2 en 1993. La veille de Noël, un voleur s’est infiltré chez une jeune francophone, enseignante de français dans une école d’immersion et engagée dans le milieu culturel franco-manitobain. Elle l’a frappé avec un poêlon, puis l’a attaché sur une chaise en attendant en vain l’arrivée de la police ; celle-ci ne l’a pas prise au sérieux avec son français trop énergique. Mais ce voleur n’est pas méchant, seulement un peu paumé et un peu trop pauvre, et surtout assez bavard. Elle a beau vouloir ne pas l’écouter et se taire, elle ne peut s’empêcher de réagir à ses propos, de s’indigner de la langue bâtarde par laquelle il l’interpelle. Car il s’exprime aussi mal qu’elle parle bien et, dans sa langue colorée et vulgaire, ponctuée de jurons, de solécismes et d’anglicismes, il ne cesse de discuter ses idées, d’attaquer ses convictions, de se moquer tout en la provoquant. Le clou de la pièce survient lorsqu’il met en doute sa fierté de la langue française et prétend que le français est mort, parce que l’élite francophone est repliée sur elle-même et cherche à préserver une culture et une histoire folklorisées qui l’empêchent d’évoluer et de s’ouvrir aux autres. Elle a beau riposter, elle n’est guère convaincante, inévitablement, Prescott ayant choisi d’épouser le point de vue du voleur, de provoquer, de scandaliser. « Va expliquer ça à un Africain que pour être un bon Franco-Manitobain, y faudrait qu’y s’identifie à l’histoire d’une pognée de gens pognés. » Évidemment, dit comme ça, par la lorgnette du multiculturalisme bien-pensant, l’argument décoiffe la pauvre fille. Dans cette société francophone profondément vulnérable, Prescott ne contextualise la question de l’assimilation que pour mieux la dédramatiser, idéalement la dépasser. Difficile ici de faire la part des choses entre l’auteur et son personnage, lequel est cependant trop sympathique pour ne pas être un peu suspect ; et la fin de la pièce, où la fille tombe dans les bras de son voleur, se colore d’une certaine désinvolture légèrement insolente. Un regard plus scrupuleux sur cette pièce qui fait semblant de ne pas vouloir être prise au sérieux conduira le lecteur à se demander si, finalement, ce que ce pseudo voleur va lui prendre, à cette fille trop inexpérimentée, ce n’est pas son identité plutôt que sa virginité (eh oui ! car elle est vierge en plus). Mais qu’est-ce que l’identité, justement ?
D’une certaine manière, cette pièce équivoque annonce L’année du Big-Mac, autre charge, franchement virulente, contre un certain état de société, et Encore, qui approfondit le huis clos dans lequel se trouve un couple.
Quand la réalité dépasse…
 L’année du Big-Mac a été créée alors que Prescott était finissant de l’École nationale de théâtre du Canada (ENT), à Montréal, en 1999. La famille américaine qui s’y trouve mise en scène, au nom emblématique de Prozac, est complètement dysfonctionnelle. Un père « légume » cloué dans un fauteuil roulant. Une mère fraîchement libérée de l’asile où elle était internée, qui ne peut se passer de Rover, un chien imaginaire ; elle croit encore qu’elle est « une grande vedette de publicité » et s’exprime en slogans publicitaires. William, le cadet des enfants, est un paresseux chronique, qui passe ses journées à regarder la télé ; sa copine, Mary, est mue par une idée fixe : être épousée par William. Seul l’aîné, Henry, est conscient de leur médiocrité, et il ne se prive pas de le dire. C’est d’ailleurs parce qu’il a traité son frère de loser que William réagit et décide subitement de se lancer dans la course à la présidence des États-Unis. Pour atteindre l’équilibre budgétaire, il propose de vendre les droits de l’année en cours à une multinationale, par exemple McDonald’s. Après tout, les grandes entreprises ont déjà leurs noms sur les immeubles dont ils financent la construction, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Cependant, à la fin de la pièce, et tandis que William peut espérer remporter la présidence, la mère, dans un excès de folie, tue tout le monde sauf Henry, lequel viendra témoigner des événements sur un plateau de télévision et « démythifier » l’histoire de son frère.
L’année du Big-Mac a été créée alors que Prescott était finissant de l’École nationale de théâtre du Canada (ENT), à Montréal, en 1999. La famille américaine qui s’y trouve mise en scène, au nom emblématique de Prozac, est complètement dysfonctionnelle. Un père « légume » cloué dans un fauteuil roulant. Une mère fraîchement libérée de l’asile où elle était internée, qui ne peut se passer de Rover, un chien imaginaire ; elle croit encore qu’elle est « une grande vedette de publicité » et s’exprime en slogans publicitaires. William, le cadet des enfants, est un paresseux chronique, qui passe ses journées à regarder la télé ; sa copine, Mary, est mue par une idée fixe : être épousée par William. Seul l’aîné, Henry, est conscient de leur médiocrité, et il ne se prive pas de le dire. C’est d’ailleurs parce qu’il a traité son frère de loser que William réagit et décide subitement de se lancer dans la course à la présidence des États-Unis. Pour atteindre l’équilibre budgétaire, il propose de vendre les droits de l’année en cours à une multinationale, par exemple McDonald’s. Après tout, les grandes entreprises ont déjà leurs noms sur les immeubles dont ils financent la construction, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Cependant, à la fin de la pièce, et tandis que William peut espérer remporter la présidence, la mère, dans un excès de folie, tue tout le monde sauf Henry, lequel viendra témoigner des événements sur un plateau de télévision et « démythifier » l’histoire de son frère.
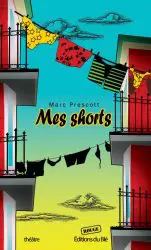 On rigole, en lisant cette pièce, mais le rire n’a pas une très belle couleur, il est jaune mélasse, une couleur visqueuse dans laquelle on ne voudrait pas mettre les pieds de peur de s’y enfoncer. Le propos donne un peu froid dans le dos, mais il est malheureusement bien d’aujourd’hui. C’est l’ère Trump quinze ans avant le temps, sauf que Prescott s’était gardé une petite gêne dans ce portrait d’une société complètement abrutie par les discours télévisuels et publicitaires, où tout est loufoque sauf la fin : William ne gagne pas, il ne peut quand même pas gagner, il y a des limites à l’invraisemblance. Le réalisateur n’avait encore rien vu… Il est remarquable aussi que Prescott ait donné à ce drame comique une forte portée médiatique. D’ailleurs, la pièce alterne trois types de scènes : l’échange entre Henry et l’animatrice de télévision, les pauses publicitaires de l’émission et la mise en scène de ce que Henry raconte. Les pauses publicitaires sont à l’image du reste, et elles poussent l’absurde jusqu’à normaliser ce qui devrait en principe choquer : cela va d’une pub de barre de chocolat qui goûte tellement mauvais qu’il faut l’essayer à celle d’une université où le principe n’est pas d’apprendre mais de faire le party, en passant par une pub policière qui suggère aux violeurs de mettre un condom pour ne pas être contaminés par les séropositives qu’ils agressent. On voit que le discours décapant de Prescott fait d’une pierre deux coups : ces pubs idiotes sont l’exact reflet d’une société qui a complètement perdu toute dignité et tout sens des valeurs.
On rigole, en lisant cette pièce, mais le rire n’a pas une très belle couleur, il est jaune mélasse, une couleur visqueuse dans laquelle on ne voudrait pas mettre les pieds de peur de s’y enfoncer. Le propos donne un peu froid dans le dos, mais il est malheureusement bien d’aujourd’hui. C’est l’ère Trump quinze ans avant le temps, sauf que Prescott s’était gardé une petite gêne dans ce portrait d’une société complètement abrutie par les discours télévisuels et publicitaires, où tout est loufoque sauf la fin : William ne gagne pas, il ne peut quand même pas gagner, il y a des limites à l’invraisemblance. Le réalisateur n’avait encore rien vu… Il est remarquable aussi que Prescott ait donné à ce drame comique une forte portée médiatique. D’ailleurs, la pièce alterne trois types de scènes : l’échange entre Henry et l’animatrice de télévision, les pauses publicitaires de l’émission et la mise en scène de ce que Henry raconte. Les pauses publicitaires sont à l’image du reste, et elles poussent l’absurde jusqu’à normaliser ce qui devrait en principe choquer : cela va d’une pub de barre de chocolat qui goûte tellement mauvais qu’il faut l’essayer à celle d’une université où le principe n’est pas d’apprendre mais de faire le party, en passant par une pub policière qui suggère aux violeurs de mettre un condom pour ne pas être contaminés par les séropositives qu’ils agressent. On voit que le discours décapant de Prescott fait d’une pierre deux coups : ces pubs idiotes sont l’exact reflet d’une société qui a complètement perdu toute dignité et tout sens des valeurs.
Le désir en abyme
 Avec Encore, créée par le Cercle Molière en 2003, on change de registre, même si l’écriture est une fois de plus solidement ancrée dans l’absurde. La pièce met en scène une femme et son mari dans le bar d’un hôtel. Chaque année, à partir de leur premier anniversaire de mariage, ils rejouent la scène de leur première séduction. Cette idée est de la femme, qui a écrit le texte de leur rencontre pour se rappeler les raisons qui lui ont fait épouser son mari et éviter de devenir blasée. C’est une sorte de fantasme faustien, où il s’agit d’aimer toujours comme la première fois. La pièce défile six actes, chacun célébrant un moment clé de l’union du couple, depuis le premier anniversaire jusqu’aux noces d’or de leur cinquantième. D’une fois à l’autre, la scène est invariablement cahoteuse, et les personnages, en dehors de leurs « rôles », tiennent aussi un discours parallèle, ce qui crée de savoureux quiproquos mais ajoute aussi à la profondeur de leur relation. Dans ces dissonances entre la situation du couple dans la vie et la scène qu’ils s’imposent, et plus encore à l’intérieur de la scène, toujours égale à elle-même par ses ratés plutôt que par sa réussite, Prescott suggère habilement les drames et les petites déceptions, le ravage du temps. Si le temps file droit, l’expérience qu’ils tentent est quant à elle redondante, circulaire ; le langage, comme l’existence peut-être, tourne en rond, et cette façon de tirer parti des décalages de sens générés par le mélange des répliques a quelque chose qui rappelle irrésistiblement le Ionesco de La cantatrice chauve3.
Avec Encore, créée par le Cercle Molière en 2003, on change de registre, même si l’écriture est une fois de plus solidement ancrée dans l’absurde. La pièce met en scène une femme et son mari dans le bar d’un hôtel. Chaque année, à partir de leur premier anniversaire de mariage, ils rejouent la scène de leur première séduction. Cette idée est de la femme, qui a écrit le texte de leur rencontre pour se rappeler les raisons qui lui ont fait épouser son mari et éviter de devenir blasée. C’est une sorte de fantasme faustien, où il s’agit d’aimer toujours comme la première fois. La pièce défile six actes, chacun célébrant un moment clé de l’union du couple, depuis le premier anniversaire jusqu’aux noces d’or de leur cinquantième. D’une fois à l’autre, la scène est invariablement cahoteuse, et les personnages, en dehors de leurs « rôles », tiennent aussi un discours parallèle, ce qui crée de savoureux quiproquos mais ajoute aussi à la profondeur de leur relation. Dans ces dissonances entre la situation du couple dans la vie et la scène qu’ils s’imposent, et plus encore à l’intérieur de la scène, toujours égale à elle-même par ses ratés plutôt que par sa réussite, Prescott suggère habilement les drames et les petites déceptions, le ravage du temps. Si le temps file droit, l’expérience qu’ils tentent est quant à elle redondante, circulaire ; le langage, comme l’existence peut-être, tourne en rond, et cette façon de tirer parti des décalages de sens générés par le mélange des répliques a quelque chose qui rappelle irrésistiblement le Ionesco de La cantatrice chauve3.
Mais sur cette scène est aussi représenté un théâtre intime, celui du désir. Cette fois-ci, on songe aux théories du psychanalyste Jacques Lacan, qui enseignait qu’« il n’y a pas de rapport sexuel ». Lacan entendait par cette formule subversive que le désir, comme volonté de complétude mutuelle, ne peut jamais être comblé, que nous sommes ainsi condamnés à refaire l’amour encore et encore. Encore, c’est à la fois le titre du séminaire de Lacan4 sur cette question, en 1972-1973, et celui de la pièce de Prescott, trente ans plus tard. On imagine ici qu’il n’y a pas de hasard, faute de rapport sexuel. Mais allez savoir, avec un auteur comme ça, si original, si indépendant.
1. Une quinzaine de ces pièces ont été réunies dans Mes shorts.
2. Devenu l’Université de Saint-Boniface en 2011.
3. Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, Gallimard, coll. « Folio théâtre », 1993.
4. Jacques Lacan, Encore, Seuil, coll. « Points/Essais », 2016.
Ouvrages de Marc Prescott
Big, Bullshit, Sex, lies et les Franco-Manitobains, Du Blé, 2001. Chez le même éditeur dans la collection « Rouge » : Encore (2003), L’année du Big-Mac (2004), Mes shorts (2011), Sex, lies et les Franco-Manitobains (2013), Fort Mac (2014).
EXTRAITS
Je veux dire, moé je suis bilingue pis tous les Franco-Manitobains que je connais sont bilingues. Cossé tu veux ? L’anglais, icitte, ça s’attrape comme un rhume. Mais quand un ostie d’anglophone apprend le français, on se plie le cul en quatre pour le féliciter. Moé, parsonne me félicite pour avoir appris le français. Au contraire, je me fais chier dessus par les anglophones parce que je suis Franco pis je me fais chier dessus par les Francos parce que je parle mal.
Sex, lies et les Franco-Manitobains, p. 50-51.
Pour mettre. Fin aux sentiments nationaux, au zèle des fondamentalistes et fin à la discorde qu’engendre. La division raciale, aux États-Unis, je propose qu’on. Exige de la population entière de se marier et de faire des enfants. Avec des gens qui ne sont pas de leur propre ethnie et/ou. Groupe culturel et/ou. Religion et/ou. Nationalité de cette façon, dans deux générations, il n’existera plus. D’ethnies distinctes, aux États-Unis. Mettons ! Fin à l’ethnocentrisme et vive ! Le melting pot, merci !
L’année du Big-Mac, p. 85.











