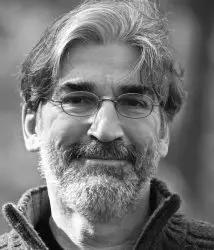« Moi, c’est moralement que j’ai mes élégances », disait Cyrano. Comme lui, Jean Lemieux pourrait user du pluriel s’il consentait à vanter ses propres mérites.
Tôt tenté par l’écriture, il manifesta avec la même précocité un penchant pour la musique, tout en menant à terme les études de médecine qui fondent aujourd’hui sa pratique professionnelle. Comme si ces divers appétits ne suffisaient pas, les voyages ont prélevé eux aussi leur tribut sur son agenda. Lemieux enchevêtre d’autant mieux les échos de ces multiples intérêts qu’il projette souvent ses personnages dans des avenues à distance de l’auteur.
Le versant policier
Plusieurs des livres de Lemieux racontent les enquêtes policières du sergent André Surprenant. Bien que ce type de littérature ne soit qu’une facette de la production de cet auteur, il est particulièrement révélateur de son regard sur le monde.
 L’enquêteur fétiche tient peu du Dirty Harry incarné par Clint Eastwood ou du défunt Kojak. Il ressemble plutôt aux héros vulnérables et hypothéqués dont s’est entiché jusqu’à l’obsession le polar moderne : situation familiale chaotique, résistance aléatoire à l’alcool, amours écliptiques, tendance contestataire… Comme pour plusieurs de ses collègues, l’atout d’André Surprenant, c’est le flair, l’intuition, l’aptitude à déborder les relevés cartésiens. Son talon d’Achille, c’est l’allergie aux patrons carriéristes, allergie propice aux raccourcis, aux imprudences, au contournement des règles. Du coup, le roman policier racontera ici aussi bien l’enquête elle-même que les démêlés de Surprenant avec sa hiérarchie. Lemieux avivera les braises en faisant de Surprenant un être privé d’enracinements : il travaille aux Îles-de-la-Madeleine sans faire partie des descendants et son passage de la Sûreté du Québec à la police de Montréal (SPVM) fera de lui un apatride par rapport à un milieu marqué par la paranoïa et l’esprit de clocher. Parmi les hérésies chères à Surprenant, celle-ci jouit, on le comprendra, d’un anathème véhément de la part de la confrérie policière : « Son honnêteté foncière [celle de la policière Geneviève] constituait même un handicap aux yeux de Surprenant, qui croyait qu’un bon policier devait posséder, au moins en partie, une âme de délinquant » (Le mort du chemin des Arsène). Ajout presque sadique, l’auteur loge les enquêtes de Surprenant aux Îles-de-la-Madeleine dans les ultimes moments de son appartenance à la SQ dont il se sépare : une gaffe lui vaudrait honte et disqualification. En devient-il plus prudent ? Surtout pas.
L’enquêteur fétiche tient peu du Dirty Harry incarné par Clint Eastwood ou du défunt Kojak. Il ressemble plutôt aux héros vulnérables et hypothéqués dont s’est entiché jusqu’à l’obsession le polar moderne : situation familiale chaotique, résistance aléatoire à l’alcool, amours écliptiques, tendance contestataire… Comme pour plusieurs de ses collègues, l’atout d’André Surprenant, c’est le flair, l’intuition, l’aptitude à déborder les relevés cartésiens. Son talon d’Achille, c’est l’allergie aux patrons carriéristes, allergie propice aux raccourcis, aux imprudences, au contournement des règles. Du coup, le roman policier racontera ici aussi bien l’enquête elle-même que les démêlés de Surprenant avec sa hiérarchie. Lemieux avivera les braises en faisant de Surprenant un être privé d’enracinements : il travaille aux Îles-de-la-Madeleine sans faire partie des descendants et son passage de la Sûreté du Québec à la police de Montréal (SPVM) fera de lui un apatride par rapport à un milieu marqué par la paranoïa et l’esprit de clocher. Parmi les hérésies chères à Surprenant, celle-ci jouit, on le comprendra, d’un anathème véhément de la part de la confrérie policière : « Son honnêteté foncière [celle de la policière Geneviève] constituait même un handicap aux yeux de Surprenant, qui croyait qu’un bon policier devait posséder, au moins en partie, une âme de délinquant » (Le mort du chemin des Arsène). Ajout presque sadique, l’auteur loge les enquêtes de Surprenant aux Îles-de-la-Madeleine dans les ultimes moments de son appartenance à la SQ dont il se sépare : une gaffe lui vaudrait honte et disqualification. En devient-il plus prudent ? Surtout pas.
Lemieux se lance ainsi à lui-même un défi abrupt : il devra exiger de son malcommode enquêteur une rigueur scrupuleuse. Surprenant ne l’emportera sur le conformisme et la bêtise que s’il bétonne sa preuve. Pas d’affirmation sans étai, pas de deus ex machina, par de hasards bienveillants. Que du vérifiable. Il devra prouver qu’il a vu un réel ignoré des concurrents, pagayer à contre-courant, démolir brique par brique les accusations portées contre des innocents. Défi relevé.
Le climat des Îles
En situant plusieurs de ses romans policiers aux Îles-de-la-Madeleine, Jean Lemieux créait les liens entre ses lecteurs et André Surprenant. Les Madelinots sont et se sentent isolés de ce qu’ils appellent – comme les Britanniques – le continent. De là à présumer de la part de leurs lointains compatriotes une blessante condescendance à leur endroit, il n’y a même pas le pas traditionnel ; que cette conviction soit fondée ou pas, le lecteur sympathisera plus volontiers avec le laissé-pour-compte local qu’avec les surdoués du continent. Comme Jean Lemieux a vécu aux Îles-de-la-Madeleine suffisamment longtemps pour ne pas les voir en touriste épidermique (de 1980 à 1982, avant d’y revenir en 1984), il peut nourrir Surprenant d’une inaltérable empathie avec les Madelinots ; le lecteur en profite.
Cette osmose, l’auteur la transmet à ses personnages : « Trois années d’enquête aux Îles lui avaient appris que les Madelinots ne reculaient devant rien, surtout pas devant le malheur, quand il était question de rire. […] ils traitaient l’adversité avec un mépris d’autant plus souverain qu’ils étaient le plus souvent pauvres comme des rats » (Le mort du chemin des Arsène). Sans surprise, cet ouvrage, le plus immergé dans le terroir des Îles, regorge d’expressions propres à cet univers clos. Aux Îles, on n’est pas « fou à lier », mais « fou amarrable ». On ne quitte pas les Îles, on « dégolfe ». La presse des Îles ? Elle s’incarne dans le « président-fondateur-éditeur-trésorier-journaliste du Fanal ».
Même l’atmosphère des romans remplis de la présence de Surprenant se ressent de l’exiguïté du décor. Isolées, boudeuses, fières de leurs différences, les Îles ne pouvaient qu’aider à la réussite d’un auteur lié à elles : les meurtres ont beau être rares aux Îles, même les Madelinots doivent confesser qu’ils sont imputables à un familier. D’où un climat qui rappellerait Les dix petits nègres. « […] nous possédons un avantage sur ces gars-là : nous connaissons le milieu » (On finit toujours par payer).
Personnages à distance
 Si, de l’aveu même de l’auteur, une parenté existe entre le médecin et le détective, on cherche en vain les ressemblances entre les autres personnages et leur père littéraire. Certes, François Robidoux, le héros de La lune rouge, est médecin comme Lemieux, mais le Jacques de La marche du fou étudie l’histoire plutôt que la littérature et connaît mieux les rivalités de la piscine olympique que les touches du piano. On retrouve un médecin dans L’homme du jeudi, mais les leviers de commande lui sont arrachés par une mère vengeresse. Dans Prague sans toi, Patrick Robillard semble avoir oublié ses rêves littéraires et se satisfait, au grand dam d’Eva, d’enseigner et de se pencher sur les robinets qui fuient. En faut-il davantage pour apprécier chez Lemieux une fascinante aptitude à revêtir d’autres peaux que la sienne et à façonner des existences à distance de ses identités personnelles pourtant plurielles.
Si, de l’aveu même de l’auteur, une parenté existe entre le médecin et le détective, on cherche en vain les ressemblances entre les autres personnages et leur père littéraire. Certes, François Robidoux, le héros de La lune rouge, est médecin comme Lemieux, mais le Jacques de La marche du fou étudie l’histoire plutôt que la littérature et connaît mieux les rivalités de la piscine olympique que les touches du piano. On retrouve un médecin dans L’homme du jeudi, mais les leviers de commande lui sont arrachés par une mère vengeresse. Dans Prague sans toi, Patrick Robillard semble avoir oublié ses rêves littéraires et se satisfait, au grand dam d’Eva, d’enseigner et de se pencher sur les robinets qui fuient. En faut-il davantage pour apprécier chez Lemieux une fascinante aptitude à revêtir d’autres peaux que la sienne et à façonner des existences à distance de ses identités personnelles pourtant plurielles.
Médecine présente et discrète
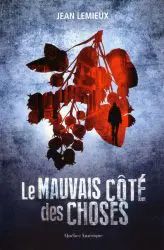 Peut-être dans cet esprit, l’auteur n’insiste guère sur ses études en médecine. Sa compétence médicale est quand même manifeste. Quand Diane exerce sa vengeance sur le médecin qu’elle soupçonne d’avoir heurté mortellement son fils, c’est en technicien que la cible analyse sa torture : « Ce qui l’embêtait, c’était les menottes. / Si ses poignets avaient été liés par des cordes, il aurait pu se laisser pendre de temps à autre et accorder à ses jambes un peu de repos. Les quadriceps lui cuisaient, mais la morsure de l’acier et la crainte de s’infliger des blessures permanentes le forçaient à demeurer debout » (L’homme du jeudi). Policière, Geneviève bénéficie par ricochet des connaissances médicales et psychologiques de l’auteur. Au lieutenant qui objecte ceci : « Il n’a pas d’alibi. Il a un peu le profil du tueur en série, solitaire, un peu bizarre, mais… », elle réplique : « Il est psychotique, pas psychopathe. / C’est à peu près ça. Remarque que je le trouve pas mal organisé pour un gars qui a fait deux psychoses » (Le mauvais côté des choses). Échange, soit dit sans méchanceté, plutôt rare dans une conversation entre policiers. Loin d’en être gêné, Lemieux rétorquerait que certaines parentés existent entre les métiers de policier et de médecin : « Police ou médecine, c’est pareil : on empêche les gens de s’amuser » (La lune rouge). Plus sérieusement, c’est le voyeurisme qu’il transformera plus loin en dénominateur commun entre les deux professions. Chose certaine, la médecine, dans ce qu’elle peut et doit avoir d’attentif aux personnes et à leurs secrets, explique la finesse et la minutie avec lesquelles l’enquêteur créé par le médecin Lemieux pratique l’écoute.
Peut-être dans cet esprit, l’auteur n’insiste guère sur ses études en médecine. Sa compétence médicale est quand même manifeste. Quand Diane exerce sa vengeance sur le médecin qu’elle soupçonne d’avoir heurté mortellement son fils, c’est en technicien que la cible analyse sa torture : « Ce qui l’embêtait, c’était les menottes. / Si ses poignets avaient été liés par des cordes, il aurait pu se laisser pendre de temps à autre et accorder à ses jambes un peu de repos. Les quadriceps lui cuisaient, mais la morsure de l’acier et la crainte de s’infliger des blessures permanentes le forçaient à demeurer debout » (L’homme du jeudi). Policière, Geneviève bénéficie par ricochet des connaissances médicales et psychologiques de l’auteur. Au lieutenant qui objecte ceci : « Il n’a pas d’alibi. Il a un peu le profil du tueur en série, solitaire, un peu bizarre, mais… », elle réplique : « Il est psychotique, pas psychopathe. / C’est à peu près ça. Remarque que je le trouve pas mal organisé pour un gars qui a fait deux psychoses » (Le mauvais côté des choses). Échange, soit dit sans méchanceté, plutôt rare dans une conversation entre policiers. Loin d’en être gêné, Lemieux rétorquerait que certaines parentés existent entre les métiers de policier et de médecin : « Police ou médecine, c’est pareil : on empêche les gens de s’amuser » (La lune rouge). Plus sérieusement, c’est le voyeurisme qu’il transformera plus loin en dénominateur commun entre les deux professions. Chose certaine, la médecine, dans ce qu’elle peut et doit avoir d’attentif aux personnes et à leurs secrets, explique la finesse et la minutie avec lesquelles l’enquêteur créé par le médecin Lemieux pratique l’écoute.
Wolfgang et Ferron
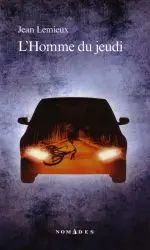 Brouillant toujours les pistes, Lemieux se montre discret sur ses relations avec la musique et disert en créant et en animant le personnage d’un nageur d’élite dans La marche du fou. L’auteur a pourtant fréquenté la guitare, le piano, la basse depuis son adolescence et jusqu’au présent, alors que les exploits athlétiques n’affleurent guère dans son curriculum.
Brouillant toujours les pistes, Lemieux se montre discret sur ses relations avec la musique et disert en créant et en animant le personnage d’un nageur d’élite dans La marche du fou. L’auteur a pourtant fréquenté la guitare, le piano, la basse depuis son adolescence et jusqu’au présent, alors que les exploits athlétiques n’affleurent guère dans son curriculum.
Mozart règne sur l’univers musical de Lemieux. S’il signe de façon très protocolaire Wolfgang Amadeus Mozart l’exergue de La lune rouge, le compositeur devient bientôt, plus familièrement, Amadeus ou même « le copain Wolfie » (Prague sans toi). De façon gentille mais présomptueuse, l’auteur prêtera d’ailleurs sa culture musicale à ses lecteurs en ponctuant son texte pragois de phrases musicales ; aux incultes de mon genre d’imaginer la mélodie…
Côté littéraire, Jacques Ferron bénéficie d’un culte particulier. On en a la preuve dans Le mauvais côté des choses, le plus récent roman de Lemieux. Le titre lui-même renvoie sans ambages à la conception contrastée que la jeune Tinamer de Portanqueu se fit d’abord de la vie : « Mes années d’insouciance ont coulé comme l’eau. L’arrière-goût m’en est venu plus tard. Il n’y avait plus de bon ou de mauvais côté aux choses » (L’amélanchier, Du Jour, 1970, p. 149). Les branches d’amélanchier dont le criminel de ce roman signe ses crimes sont plus qu’un clin d’œil ; un hommage. Les fréquentations littéraires et musicales de Lemieux sont si riches que ses préférences emporteront l’adhésion du grand nombre.
Ouvrages évoqués dans cet article :
Prague sans toi, Québec Amérique, 2013 ; Le mauvais côté des choses, Québec-Amérique, 2015 ; Le mort du chemin des Arsène, Québec Amérique, « Nomades », 2016 (La courte échelle, 2009) ; On finit toujours par payer, Québec Amérique, « Nomades », 2016 (La courte échelle, 2009) ; La lune rouge, Québec Amérique, « Nomades » (La courte échelle, 2009) ; La marche du fou, Québec Amérique, « Nomades », 2016 (La courte échelle, 2009) ; L’homme du jeudi, Québec Amérique, « Nomades », 2016 (La courte échelle, 2012).
EXTRAITS
Juliette Rossi avait joué avec sa bague, perplexe. Surprenant l’observait. Tinamer de Portanqueu, l’enfant qui vit du bon côté des choses, ce n’était pas Amélie, c’était elle.
Le mauvais côté des choses, p. 357.
Les deux fils étaient accrochés côte à côte, l’un grand et musculeux, l’autre malingre. On les voyait bébés, puis à huit ans, impeccables devant un paysage de photographe. Le plus jeune réapparaissait à l’adolescence, pâle et la bouche de travers, un Rimbaud à combustion lente.
La lune rouge, p. 226-227.
Roméo vaut combien ?
Roméo était en avant de sa bouée à trente ans. Aujourd’hui, il est millionnaire. Dans le moins des moins.
On finit toujours par payer, p. 88.
Ce qui, une première fois, provoquait chez moi un malaise, c’était que la musique semblait être pour elle un besoin absolu, primordial, derrière lequel notre relation devait s’effacer.
Prague sans toi, p. 40.